Cynthia Fleury : « Le ressentiment contemporain menace la démocratie » (La Croix)

Dans son dernier essai, Cynthia Fleury dissèque la notion de « ressentiment », ce mécontentement sourd qui gangrène nos existences et menace la société tout entière. Pour la philosophe et psychanalyste, résister à ce sentiment constitue l’un des grands défis à venir.
La Croix L’Hebdo : Vous consacrez votre dernier ouvrage (1) au ressentiment contemporain. Comment le définiriez-vous ?
Cynthia Fleury : Être dans le ressentiment, c’est se sentir offensé et devenir captif de cette vision des choses. Max Scheler parle d’auto-empoisonnement. On pourrait aussi le définir comme une maladie auto-immune, une forme d’emprisonnement où le sujet devient son propre geôlier : le ressentiment empêche l’individu, il l’enlise, l’amène à une rumination sans fin. Il devient le filtre au travers duquel l’individu voit tout.
Ce mécontentement sourd qui gangrène l’existence trouve son origine dans une faille inaugurale (celle de l’abandon, de l’incertitude, du désir infantile de protection), et s’y greffent ensuite – chez certains – le sentiment de ne pas être reconnu à sa juste valeur et celui d’être victimes d’injustice. Dans ce contexte, certains individus vont céder à leur pulsion ressentimiste et verser dans un délire victimaire qui les ronge et les consume. Leur identité même va alors s’articuler et se consolider autour de ce ressentiment. Cette mésestime de soi va, ensuite, être dirigée contre l’autre.
Distinguez-vous le ressentiment de la colère qui, elle, peut parfois se révéler tout à fait salutaire ?
C. F. : Face à des situations inacceptables, la colère joue un rôle fondamental et légitime, de refus et de dénonciation. Mais elle ne peut tourner à vide, elle doit déboucher sur autre chose qu’elle-même. La colère peut déboucher sur l’action, la fixation dans la colère jamais, elle ne débouche que sur la ré-action.
Vous êtes critique du système capitaliste et de la société de consommation. En quoi sont-ils tous les deux des vecteurs de frustration ?
C. F. : L’individu est souvent soumis à toute une série d’injonctions dans le monde du travail : il est précarisé, pressuré, placardisé, harcelé, etc. Il devient, par ailleurs, de plus en plus remplaçable. Tout cela concourt à le « dé-narcissiser ». Et puis, à l’autre bout de la chaîne, l’univers de la consommation le « re-narcissise » au contraire, en lui proposant le dernier produit culturel à la mode. L’individu désire ce qu’il croit nécessaire pour être reconnu comme sujet. Ce que le « génial » slogan de L’Oréal avait parfaitement compris : « Parce que je le vaux bien. » En réalité, la consommation n’est nullement une éthique de la reconnaissance, elle illusionne le sujet en lui faisant désirer des objets addictogènes qui le font entrer dans un régime de frustration permanente.
À vous lire, la démocratie favoriserait, elle aussi, le ressentiment. Pourquoi ?
C. F. : Parce que l’objectif, en démocratie, c’est l’égalité et que, sur ce point, le système faillit. Et il ne peut que faillir. On est tous distincts, on a toutes des doléances différentes et l’on peut tous, à un égard ou à un autre, s’estimer lésés et vouloir réclamer notre dû. L’État de droit se trouve nécessairement mis en défaut. Au fond, la promesse de départ en démocratie (l’égalité entre citoyens) ne peut jamais pleinement être honorée. Tocqueville analysait très bien, d’ailleurs, ce ressentiment spécifique au régime démocratique : lorsqu’un système prône l’égalité, « la plus petite inégalité blesse l’œil ». Autrement dit, nous ne pouvons confier exclusivement à la démocratie le soin d’endiguer le ressentiment, même si les institutions doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour ne pas produire les conditions objectives du ressentiment. C’est ce paradoxe-là qu’il n’est pas aisé à comprendre et à accepter.
Comme se départir de son statut de victime et tourner le dos au ressentiment ?
C. F. : La prise de conscience est un préalable à tout : Il s’agit, d’abord, de reconnaître qu’on est dans le ressentiment. Et cela suppose un vrai travail sur soi, un effort considérable même. En tant que psychanalyste, je constate tous les jours combien les individus sont attachés à leur pulsion ressentimiste. Ils se considèrent comme victimes et vivent cela comme un fait incontestable, une vérité objective. Or, on ne se « sépare » pas d’une vérité... Le travail d’analyse consiste donc à leur faire comprendre que ce qu’ils vivent est, certes, inique voire douloureux mais qu’il n’en reste pas moins possible de « jouer » avec cette réalité, de s’en distancier.
Tout est, ensuite, une question de sublimation, de transformation. Il y a des occasions à saisir partout : pour certains, cela passera par l’écriture, pour d’autres par l’engagement, par le sport, etc. Tout dépend de la trajectoire, de l’âge, de la culture de chacun. L’enjeu, au fond, sera de faire advenir un sujet inédit à nouveau capable d’agir, de créer et d’orienter son énergie vers de nouveaux projets, de faire émerger d'autres possibles. Il faut comprendre que la vérité « objective », historique, éventuellement juridique n’est pas la vérité « psychique » : un sujet peut être objectivement victime, cependant s’il s’essentialise comme victime, il est psychiquement en danger et met en danger les autres.
Cette mésestime de soi et ce sentiment d’infériorité découlent parfois d’inégalités ou de discriminations bien réelles appelant des réponses collectives. Demander à chacun de ne pas céder au ressentiment, n’est-ce pas dépolitiser la souffrance ?
C. F. : Je ne dépolitise précisément pas ! Il faut, selon moi, bien dissocier la souffrance réelle du ressentiment découlant de cette souffrance (le second n’étant qu’une excroissance toxique de la première). La souffrance doit être repositionnée dans l’espace public, elle doit être politisée et être même clairement objectivée. Via, notamment, un chiffrage précis des inégalités. Combattre ces injustices doit être une priorité pour l’État. Il se doit d’autant plus d’être au rendez-vous que ces injustices risquent, ensuite, d’être le ferment de la victimisation. Pour moi, il s’agit de politiser la souffrance, pas le ressentiment.
Dans les faits, que constatons-nous ? Que l’État se défausse trop souvent en renvoyant les individus à leur propre responsabilité. Mais les citoyens se défaussent, eux aussi, en se considérant victimes, en se contentant d’exiger leur « dû ». Les deux, État comme citoyens, ont l’obligation d’agir à leur niveau... et les deux se défaussent. In fine, lorsque l’État social n’assume pas son rôle, c’est selon moi au sujet – en dernière instance – de résister malgré tout au ressentiment en élaborant les possibilités de son action dans le monde.
N’est-ce pas une lourde charge que vous faites pesez là sur les épaules de chacun ?
C. F. : On peut voir les choses ainsi mais, pour ma part, je considère le sujet comme capable de ce sursaut. C’est un postulat, je le reconnais… Nous voyons tous les jours des êtres qui ne sont pas au rendez-vous mais cela n’invalide pas pour autant, à mes yeux en tout cas, l’idée régulatrice selon laquelle le sujet est libre et responsable. Dire cela, est-ce lui faire peser une trop lourde charge sur les épaules ? Je ne le pense pas.
Je suis même persuadée de l’inverse. Car si on ne pose pas cela, c’est la fin de tout... Partir du principe que l’homme ne peut pas, c’est en réalité s’aventurer sur une pente très dangereuse. Faire fi de la liberté, et de la responsabilité individuelle, reviendrait à remettre en question l’État de droit, voire à terme valider un régime dictatorial… Ainsi, sous-couvert d’être plus clément pour l’homme, c’est un danger absolu. Postuler que l’individu est libre constitue, certes, une charge (et une fiction) mais elle se révèle bien plus légère et régulatrice que ce qui pourrait s’abattre sur lui si on lui ôtait toute responsabilité.
Dans votre ouvrage, vous disséquez les ressorts du fascisme, la « vengeance du faible » dites-vous et prédisez : « Il existera à nouveau. » Pourquoi cette certitude ?
C. F. : Le fascisme existera à nouveau car il ne relève pas, selon moi, d’un moment historique mais correspond à une situation psychique. C’est un « idéal de rétrogradation » qui peut envenimer toute âme dès lors qu’elle renonce à se guérir et préfère opter pour le côté victimaire de la force. Or, les conditions socio-économiques actuelles, et la dynamique globale d’incertitude, viennent réactiver chez certains des pulsions très archaïques. Ces postures se trouvent, par ailleurs, légitimées par certains leaders répétant à la foule qu’elle est dans le juste. Tout est réuni... Et ce d’autant que les jeunes générations – en Occident en tout cas – ne portent plus en elles la réminiscence de la guerre. Voilà plus de soixante-dix ans qu’elles n’ont plus été confrontées au réel de la mort. C’était un garde-fou capable de contrebalancer nos pulsions.
Aujourd’hui, le ressentiment contemporain menace la démocratie. Et le rempart ultime, je le répète, reste la psyché individuelle. C’est en refusant, individuellement, de céder à cette pulsion que nous nous protégeons nous-mêmes en tant que sujets et que nous protégeons la société tout entière. Ce qui ne veut pas dire – je le répète là aussi – qu’il ne faille pas lutter contre toutes les injustices alimentant ce sentiment.
Vous déplorez notre grande « immaturité psychique » collective. Que voulez-vous dire par là ?
C. F. : La population connaît très mal le psychisme humain. C’est comme si on avait mis toute notre ingénierie dans le rationalisme et dans la logique en oubliant la part d’intelligence qui vient structurer notre psyché. Or, elle doit, elle aussi, être éduquée et étudiée... au même titre que les mathématiques. Les grands ressorts psychiques sont très mal connus de la population. Or, comment maîtriser ce qu’on ne connaît pas ? À voir la psyché humaine comme un non-sujet, on se désarme nous-mêmes. Regardez la difficulté rencontrée par certains parents, ou certains enseignants, au moment de gérer la frustration des plus jeunes…
Je me demande sérieusement s’il ne faudrait pas y dédier un cours à l’école. Il existe, en effet, des lois psychiques structurelles qui mériteraient d’être mieux connues, mieux comprises. On gagnerait tous à entrer de façon compétente et rigoureuse dans ces sujets. Il ne s’agirait évidemment pas de s’immiscer dans l’intimité de chacun, mais d’enseigner aux jeunes générations ce que sont les grands invariants de la psyché humaine. Produire des sociétés différentes passe, aussi, par cela.
(1) Ci-gît l’amer. Guérir du ressentiment, Cynthia Fleury, Gallimard, 312 p., 21 €.
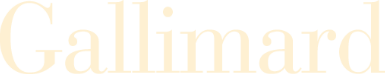
Cynthia Fleury est professeure titulaire de la chaire Humanités et Santé au Conservatoire national des arts et métiers


