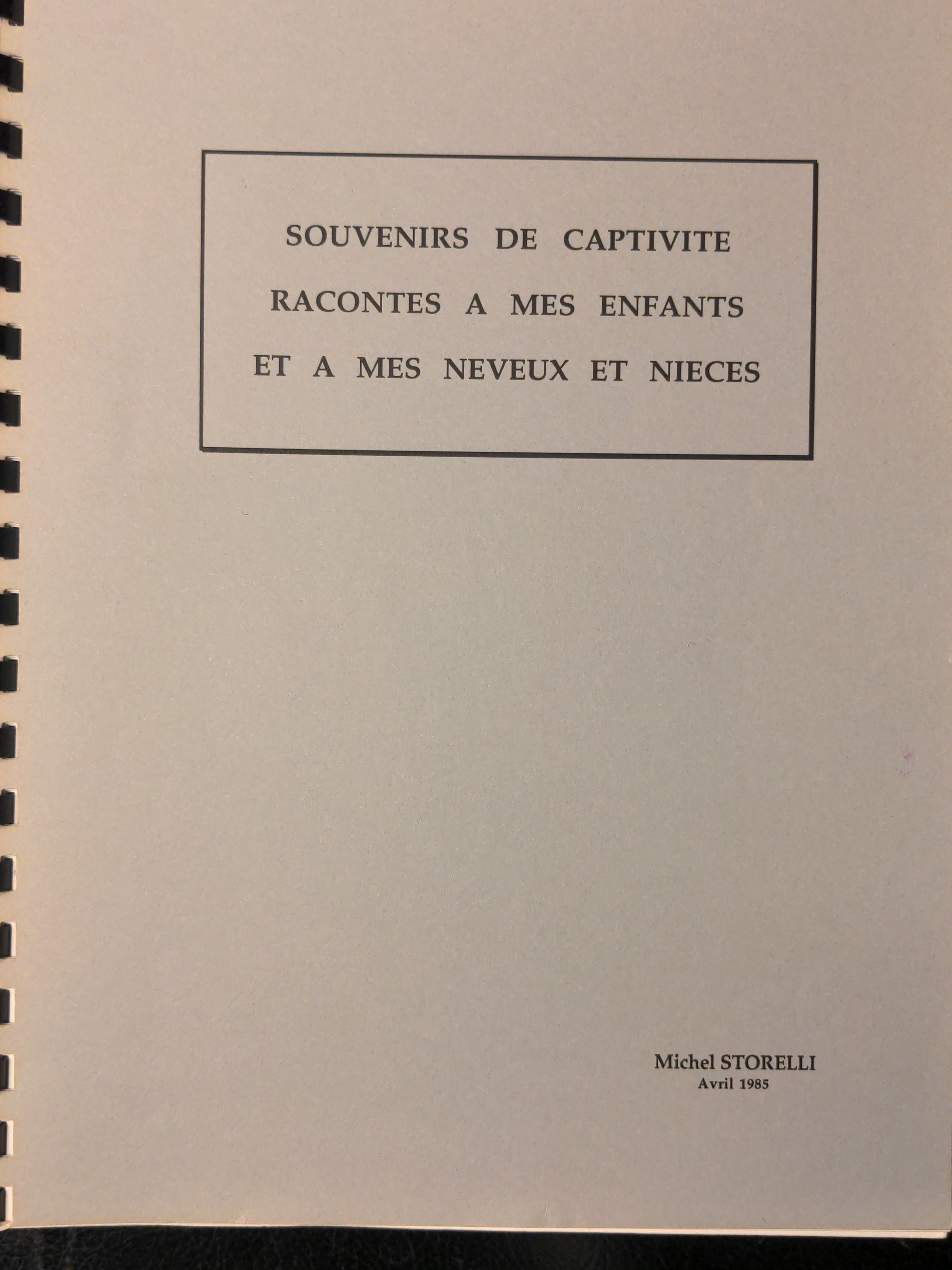Souvenirs de captivité (Michel Storelli)

…racontés à mes enfants et à mes neveux et nièces – 1985
Ce jour, nous commémorons la capitulation de l'Allemagne à la fin de la Seconde Guerre Mondiale, dont c'est le 78e anniversaire. Je saisis cette occasion pour numériser et publier les mémoires de captivité de mon grand père paternel Michel Storelli (1918-1998), qu'il avait écrits et partagés dans le cercle familial en 1985.
Fait prisonnier en 1940, il est envoyé en Bavière aux travaux forcés autour du Stalag XIII-C. Il tente une évasion en 1942 mais se fait prendre à Karlsruhe. Il est alors déporté dans le camp disciplinaire de Rawa-Ruska, tristement célèbre Stalag 325, dans le territoire actuel de l'Ukraine. Il est ensuite envoyé en Poméranie (actuelle Pologne) dans le Stalag II-B, assigné quelques mois à un Kommando de redressement, avant de pouvoir retrouver un Kommando plus vivable. Il y restera jusqu'à la libération par l'Armée rouge en 1945 et, après quelques mois de pérégrinations, pourra enfin retrouver sa famille en Périgord.
C'est une histoire parmi tant d'autres, écrites ou perdues, mais bien saisissante tant l'univers décrit paraît loin de notre quotidien. Mais l'histoire est un éternel recommencement, dit-on. Accomplissons notre devoir de mémoire et travaillons pour la paix.
Morceaux choisis :
Les prisonniers, même s'ils n'ont pas réussi leur évasion, ont certainement le moral plus haut que les autres qui n'ont pas essayé. Par leur geste, ils se sont prouvés à eux-mêmes et ils ont montré aux Allemands qu'ils ne s’avouaient pas vaincus et que s'ils étaient forcés de travailler pour leur vainqueur, c'était contre leur gré.
La soupe est moins consistante qu'à Trembowla. Par contre, on peut manger du rat. Tous les jours, des débrouillards circulent le long des travées, présentent sur une planchette un gros rat déjà écorché et vidé en disant : "À échanger contre deux barres de chocolat ou un paquet de cigarettes". Et ils ne manquent pas d'acquéreurs.
J'ai éditorialisé le récit en l'agrémentant de cartes et illustrations diverses. L'ouvrage original ne comportait que du texte.

AVANT-PROPOS
Le 1er juin 1940, dans la matinée, nous avons débarqué à la gare de Mouy, dans le département de l'Oise, venant du front de Lorraine où il ne se passait rien à l'époque. Nous avons pu voir, pendant le voyage dans nos wagons à bestiaux, les dégâts causés par les bombardements aériens allemands, à Vitry-le-François principalement.
A Mouy, il fut très difficile de trouver un bistrot ouvert car la petite ville était déserte, ce qui nous a fortement étonnés et inquiétés : on ne savait pas que les choses allaient si mal.
Nous avons marché pendant trois ou quatre jours vers le Nord, à raison de 30 kilomètres par jour environ. C'était l'allure de l'infanterie car notre Division, la 24ème, n'était pas motorisée. Nos canons de 155 courts, qui pesaient plus de 3,5 tonnes chacun, ainsi que tous nos véhicules, charriots pour le fourrage des chevaux, fourgons, caissons, cuisine roulante, étaient montés sur roues en bois cerclées de fer et ne pouvaient aller plus vite. Tout ce matériel, même les armes individuelles, mousquetons, mitrailleuse (il n'y en avait qu'une par batterie, modèle Saint-Étienne 1912) était déjà en service en 14-18. Personnellement, j'avais un revolver à barillet modèle 1871, calibre 11 mm.
Il faisait très beau temps. Dans la cour des fermes abandonnées, on voyait les vaches errer et beugler lamentablement car elles n'étaient pas traites depuis déjà plusieurs jours sans doute.
Vers le 4 juin, nous avons mis nos canons en batterie à la lisière d'un petit bois situé à environ 1 kilomètre à l'ouest d'un village : Hallivillers, sous La Warde, dans la Somme. Les chevaux étaient camouflés dans un autre bois, à 2 kilomètres en arrière, près d'un point d'eau, étang ou petite rivière. Entre les canons et les chevaux se trouvait l'échelon intermédiaire : cuisine roulante, ravitaillement, transmissions. C'est là que j'étais car j'étais agent de liaison. Et c'est là que j'ai creusé mon trou, dans un petit boqueteau. Il y avait, déjà préparées, quelques tôles ondulées en métal épais, qu'on mettait par-dessus le trou et le bonhomme, quand le besoin s'en faisait sentir, ce qui est bien arrivé en effet les jours suivants.
Le 6 juin, on m'a envoyé, ainsi qu'une dizaine d'autres, essayer de trouver des agents de la 5ème colonne, habillés en général en uniformes français, qui espionnaient et mettaient la pagaille derrière notre ligne. Tout le monde avait peur de cette 5ème colonne qui existait bien réellement en effet, mais nous n'avons rien trouvé d'anormal.
Jusque là, nous n'avions rien vu, rien entendu sauf quelques bombardements lointains causés par des avions allemands qui passaient assez haut et ne s'intéressaient pas à nous.
Le spectacle de ces avions, on ne savait pas encore qu'ils s'appelaient "Stukas", se laissant tomber comme des pierres les uns après les autres dans des hurlements de sirène, en lâchant leurs bombes en fin de course, était très impressionnant, et nous plaignions les camarades qui étaient dessous. Peu après, nous avons vu arriver les rescapés, en désordre et sans armes, complètement abrutis et ne comprenant pas la colère de notre commandant qui parlait de les faire passer en conseil de guerre pour avoir abandonné leur poste.
Le lendemain 8 juin, on fut réveillé par le bruit de tous nos canons ouvrant le feu en même temps: canons de tous calibres, même les mitrailleuses de l'infanterie. La 24ème Division toute entière probablement donnait le maximum. Et comme les autres en face tiraient aussi, cela faisait un beau vacarme. C'était vraiment pour nous le début de la guerre, bien qu'elle eût commencé depuis plus de 9 mois. Et je pensais à mon père qui m'avait souvent raconté ses souvenirs de 14-18.
Tapi au fond de mon trou et la tôle au-dessus de moi, je n'en menais pas large. A chaque sifflement d'obus, on croit qu'il vous est destiné, et les minutes sont très longues. C'était des obus fusants qui éclataient au-dessus du sol. Plusieurs fois la tôle a vibré atteinte par des éclats de branches ou de métal. On entendait le bruit sourd du départ 2 secondes environ après l'aboiement brutal de l'éclatement de l'obus, ce qui prouvait que les chars allemands n'étaient pas loin.
Vers midi, accalmie. Le lieutenant Richer, à la batterie, donna l'ordre par téléphone d'en profiter pour apporter la soupe, les vivres et le vin aux canonniers qui avaient faim et soif. C'était à moi de faire ce travail. Mes camarades attelèrent un cheval à une petite carriole à 2 roues, légère et maniable, que nous avions trouvée chez un paysan des environs. Le pain, les percolateurs, les bouteillons furent entassés dessus, et je partis un peu inquiet à cause d'un petit avion d'observation allemand se baladant tranquillement à 200 mètres de haut environ. Cet avion, appelé "Storch", autrement dit "la cigogne", était blindé par-dessous et ne craignait pas les mitrailleuses ordinaires.
Il fallait donc prendre des chemins détournés en longeant les petits bois, les haies, etc, ce que j'ai fait. Je suis arrivé sans encombre à la batterie où j'ai été bien accueilli par le lieutenant Richer. Il m'a offert un verre de vin et m'a demandé si tout allait bien. Il m'a montré les chars allemands qu'on devinait embusqués à la lisière d'un bois à 1 kilomètre environ, et m'a dit qu'il en avait fait sauter au moins trois par des coups au but. Nos canons de 155 étaient très bons pour la guerre de tranchée ou démolir des blockhaus, mais n'étaient évidemment pas conçus pour tirer contre des chars, et de si près. Il fallait mettre les tubes presque à l'horizontale et régler les fusées d'ogive à 0. Il faut dire que chez nous il n'y a pas eu de panique et tout le monde a fait son devoir, tout en ayant très peur, et ceci en grande partie grâce à notre lieutenant qui, officier de réserve pourtant, s'est montré remarquable de calme et de courage. Il ne daignait même pas se mettre à l'abri quand les bombes ou les obus tombaient.
En revenant avec ma carriole vide, j'ai longé un élément de ligne tenu par des fantassins de notre Division qui n'avaient que des canons de 37mm et des mitrailleuses. Eux aussi paraissaient décidés à faire leur devoir, mais la fragilité de notre dispositif devant la puissance terrestre et aérienne des adversaires n'était pas tellement rassurante.
Pendant l'après-midi et la soirée, je suis souvent resté dans mon abri, mais les bombardements n'étaient qu'intermittents et peu fournis, sur nous tout au moins. Nous vîmes une formation de bombardiers arriver qui n'étaient pas des Stukas. Nous eûmes une seconde l'espoir que c'était des Français, puis nous distinguâmes parfaitement les chapelets de bombes qu'ils lâchèrent juste au-dessus de nous. Ces bombes font une sorte de hululement particulier, et on a l'impression qu'elles vont vous tomber dessus, mais ce n'était pas nous qui étions directement visés: c'était des camarades à notre droite et pas très loin car nous sentions le sol trembler au fond de notre trou. Enfin le soir et l'obscurité arrivèrent, et la nuit se passa dans un calme relatif troublé par des rafales d'armes automatiques et des fusées éclairantes, mais pas de bombardements si mes souvenirs sont exacts.
Le 9 juin, les tirs reprirent de tous côtés; mais les nerfs commençaient à se fatiguer et tout le monde se demandait si on pourrait tenir le coup longtemps. En effet, l'ordre arriva d'aller chercher les attelages des canons à l'échelon arrière. Je devais prendre mon cheval pour cette mission, mais il avait failli me désarçonner une fois en faisant un écart devant le cadavre d'un autre cheval. Comme je ne suis pas très bon cavalier, j'ai préféré prendre un vélo. Il était environ midi et il faisait un temps magnifique. J'étais en manches de chemise sans aucune marque distinctive apparente.
Peu avant le village d'Hallivillers, il y avait un croisement. Il fallait prendre un chemin de terre qui se perdait entre les champs et les haies jusqu'au bois où se trouvaient les chevaux. Le petit avion d'observation "Storch" était toujours là naturellement.
Arrivé à l'échelon, je vis l'adjudant Barry qui le commandait et qui, déjà prévenu par téléphone, avait fait préparer les chevaux et les conducteurs qui les montaient. Les chevaux allaient par paires: un "porteur" monté par son cavalier qui tenait à sa droite par une longe passée dans la bride l'autre cheval appelé "Sous verge". Pour traîner les canons et les chariots de munitions, il fallait environ une vingtaine de paires de chevaux, ce qui n'aurait pas manqué d'être vu par l'avion ennemi, surtout avec la poussière produite. La consigne était donc de laisser un intervalle d'au moins 20 mètres entre chaque attelage, pour limiter les dégâts s'il devait y en avoir.
Je partis devant sur mon vélo. Au début, tout alla bien. Mais arrivé au croisement près d'Hallivillers, je fus arrêté par un capitaine d'infanterie complètement hors de lui qui braqua sur moi son revolver, et il aurait certainement tiré si je ne lui avais pas dit le numéro de ma batterie, de mon régiment, de ma Division, le nom de mon lieutenant, etc... Il ne me croyait toujours pas et me dit d'un air soupçonneux: "Où allez-vous par là, il n'y a plus personne, que des Allemands". A ce moment-là arriva heureusement le premier attelage haut-le-pied qui me suivait, et il rengaina son revolver. Il faut dire pour l'excuser qu'on voyait plusieurs cadavres de ses hommes ainsi que des blessés étendus que deux ambulances qui arrivaient juste et à toute allure ont emmenés aussitôt.
Arrivé à mon échelon, j'appris que les canons ne devaient être attelés que la nuit suivante: c'était plus prudent en effet.
Le 10 au matin, nous avons décroché dans l'obscurité et même à l'abri d'un épais brouillard. Je n'ai jamais su si ce brouillard était artificiel ou non. Nous ne fûmes pas inquiétés ni bombardés. Il était malheureusement probable que la ligne française avait décampé et que les Allemands s'engouffraient déjà par la brèche qu'ils avaient creusée la veille.
Le premier jour de la retraite, nous marchâmes sans arrêt. C'est à peine si l'on prenait le temps de faire la pause dix minutes pour donner un peu de foin et d'eau aux chevaux. La nuit tomba et nous continuâmes à marcher. Les Allemands lançaient beaucoup de fusées de toutes les couleurs, sans doute pour se repérer entre eux. Nous avions l'impression d'être au milieu d'eux et craignions d'être faits prisonniers à tout moment. Le lendemain matin, nous mîmes nos canons en batterie et tirâmes nos derniers obus. C'était à la demande d'un capitaine de chasseurs à pied qui, bien enterré avec ses hommes et ses mitrailleuses, avait décidé de ne plus reculer. Nullement impressionné par le fracas des bombes qui tombaient non loin de nous, on le sentait décidé à mourir sur place. Mais notre commandant donna l'ordre de continuer la retraite. Je me souviens du ton un peu méprisant avec lequel ce capitaine nous dit en nous voyant atteler de nouveau: "Alors les artilleurs, vous partez ?". Puis il dit à ses hommes qui n'étaient certainement pas tous d'accord avec lui, et je les comprends: "Nous, nous restons".
Peu après, le lieutenant Richer me fit appeler et me dit: "Le maréchal des logis X a disparu. Il a probablement déserté. Vous le remplacerez au commandement de la 4ème pièce". Par esprit de discipline et aussi par amour propre je dis: "Bien mon lieutenant", mais je ne dis pas que je me sentais complètement incapable de faire ce travail. J'avais été depuis le début de la guerre soit au ravitaillement où je conduisais un camion léger, soit aux transmissions.
Comme agent de liaison, je me sentais capable de "faire des commissions", même au péril de ma vie. Mais surveiller et commander la manœuvre d'un canon servi par six hommes -pointeur, chargeurs, tireur, artificier, tous plus âgés et plus au courant que moi-, cela m'inquiétait beaucoup. Je mis mon cheval à la hauteur de la 4ème pièce avec un certain sentiment de fierté néanmoins. J'avais décidé que s'il fallait tirer, et pour l'instant c'était improbable pour beaucoup de raisons, je regarderais mes hommes sans me mêler de la manœuvre. Et dire que j'avais été nommé sous-officier le 1er juin précédent!
Malheureusement en effet, il ne fut plus jamais question de remettre en batterie. La vraie débâcle commençait... Au début, nous avions l'espoir de trouver une ligne de résistance organisée, sur l'Oise, puis sur la Seine. Mais l'Oise fut passée à Pont Saint Maxence avec difficulté d'ailleurs car les Allemands mitraillaient le pont. Il en fut de même de la Seine, je ne me rappelle plus à quel endroit.
Le désordre et la désolation augmentaient tous les jours. Ce n'était le long des routes que carcasses de colonnes militaires incendiées, civils de plus en plus nombreux, en majorité Belges ou Français du Nord qui s'étonnaient de nous voir fuir. Comme il n'y avait plus de ravitaillement, il fallait piller les épiceries pour se nourrir. Les chevaux mangeaient leur avoine en marchant, dans le petit sac qu'on suspendait à leur tête, et les conducteurs leur ramassaient en vitesse du foin dans les champs le long de la route.
En pensant aux souvenirs glorieux de la guerre 14-18 que mon père m'avait racontés, j'étais à la fois honteux et furieux de voir un désastre pareil. Abandonner ainsi aux Allemands ces contrées si riches et sous un soleil radieux, ces milliers de maisons entourées de jardins pleins de fleurs!
Je pris un mousqueton et tirai sur un des avions qui piquaient sur nous. La plupart du temps uniquement pour s'amuser à voir l’affolement produit. Notre mitrailleuse ne tirait pas, peut-être enrayée je ne sais pas. Dans ces cas-là, tout le monde descendait se camoufler dans les fossés. Seul le lieutenant Richer restait imperturbable sur son cheval, et pourtant il ne fut pas touché. Il est vrai que ces bombardiers légers lâchaient juste quelques rafales de mitrailleuse en passant, sans se détourner de leur route. Ils étaient sans doute pressés de refaire leur plein de bombes et de continuer leur œuvre de destruction et de démoralisation à l'intérieur. Perdre du temps à démolir quelques chevaux et des soldats mal équipés et déjà virtuellement prisonniers ne les intéressait pas.
Le 17 juin, on approchait de la Loire qu'on devait traverser au pont de Sully. Ce pont étant pris par les Allemands ou démoli, on obliqua vers Gien qui se révéla impraticable lui aussi car toutes ces colonnes de militaires et de civils enchevêtrées s'arrêtèrent.
Pour moi comme pour beaucoup, la stupeur et la fatigue se mélangeaient à la honte. Jamais dans son histoire, une armée française n'avait subi un désastre pareil, mais quelque chose me disait au fond de moi-même que cette guerre, qui serait probablement planétaire, n'était peut-être pas perdue pour autant.
PREMIÈRE PARTIE - MONTEREAU ET BAVIÈRE DU NORD
17 JUIN 1940 - 28 MARS 1942
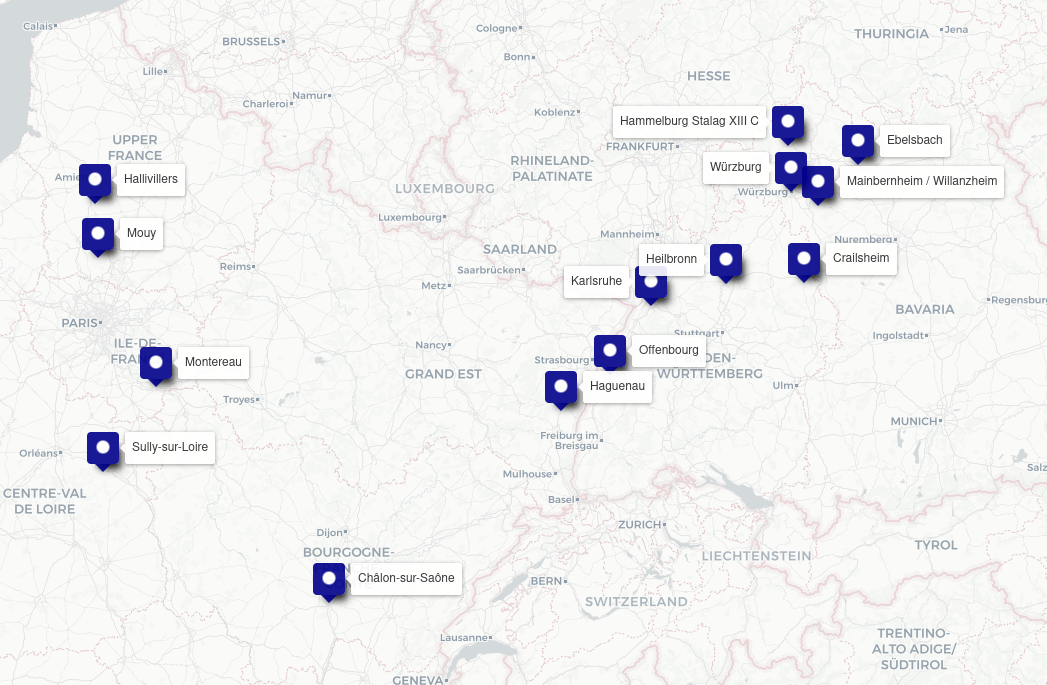
1. PRISONNIER EN FRANCE
Au soir du 17 juin 1940, cela fait maintenant sept jours que le 221ème régiment d'artillerie divisionnaire recule. Souvent mélangé aux civils, quelquefois mitraillé, mais pas sévèrement. Il est maintenant dans une forêt. La colonne avance de plus en plus lentement et par à-coups. Puis s'arrête. Définitivement. La 17ème batterie, comme bien d'autres, est bloquée sur cette route, entre Sully-sur-Loire et Gien. On entend quelques détonations dans le lointain, quelques rafales de mitraillettes dans les sous-bois. On ne voit pas d'ennemis. La nuit tombe. Michel se couche dans le fossé à côté de son canon. Tout le monde en fait autant. Le matériel est au complet et en ordre, mais il n'y a pas d'obus dans les caissons : on a tout tiré à Hallivillers-sous-La-Warde (Somme). Sur les cent dix hommes environ de la Batterie, il n'en manque que trois ou quatre : un tué, deux blessés et un déserteur. Tout espoir d'arrêter l'ennemi est perdu. Le miracle de la Marne n'aura pas lieu.
Le 18 juin au petit matin, un mot d'ordre circule: un accord est intervenu en haut lieu; ils sont donc prisonniers. Michel prend son quart dans sa musette pour chercher son jus à la roulante. Un timbre de vélo derrière lui... Il se retourne... Sur le vélo, un type avec un casque couvert de feuillage; comme lui, le teint noir de quelqu'un qui ne s'est pas lavé depuis longtemps, vingt à vingt-deux ans comme lui. Devant l'air ahuri de Michel, il dit poliment : "Vorsehen" (littéralement : regarder devant, attention) et passe, suivi d'une douzaine de ses camarades. Tout est très calme. On saura plus tard que le Commandant Boy, chef du cinquième groupe du 221ème n'a pas obéi aux ordres. Il a abattu avec son revolver les deux premiers Allemands qu'il a vus au milieu de la route, avant d'être abattu à son tour. Les Allemands ont fait rendre les honneurs militaires à son corps. Mais maintenant tout le monde dépose les armes... et les casques. C'est un moment pénible. Les officiers sont séparés des hommes. Une charrette de paysan est réquisitionnée pour les officiers les plus âgés, spectacle humiliant; on comprend le Commandant Boy. Les soldats -qui ne sont plus que des prisonniers- prennent la route, bien encadrés par les vainqueurs qui ne se gênent pas maintenant pour hurler des ordres et des menaces : "Los, los, Menschen” ("Vite vite, être humains"; en français on dit les hommes). L'un d'eux prend un casque français, le cogne violemment contre le sien, fait remarquer que c'est le casque français qui est cabossé et dit avec mépris: "Kamelotte". Oui, on est bien battus...
Il faudra marcher toute la journée. Dans les villages, des civils compatissants remplissent les bidons d'eau. La colonne est longue et s'étire malgré les "Los, los". Parfois, lorsqu'on longe un bois, un débrouillard plonge dans les fourrés, la plupart du temps, il est vu; coups de fusils ou de mitraillettes, vociférations. La colonne continue sans s'arrêter. Michel n'a pas de provisions dans sa musette. Il a juste un bidon, un plat de gamelle, un quart et des couverts. Il a jeté dans le fossé sa valise contenant des lainages, du linge, etc... Il n'a gardé que son manteau, du savon et un rasoir. On traverse un village, Michel rase les murs, ouvre une porte à tout hasard et entre dans la maison : personne ne l'a vu, semble-t-il. Il se trouve dans une cuisine, une jeune femme est là, terrorisée. C'est manifestement une fermière, on entend des vaches dans la cour. Michel lui demande poliment si elle a du lait à vendre. La femme lui remplit son bidon, accepte l'argent mais ne lui offre pas de rester. Il part donc et rejoint la colonne bien content d'avoir du lait.
À la nuit tombante, ils arrivent à l'entrée d'un château entouré d'un grand parc. La colonne prend l'avenue. Une cuisine roulante française est à l'entrée. Chaque prisonnier, en passant, tend sa gamelle et reçoit une bonne louche d'un litre de soupe. Michel n'a que son couvercle qui contient seulement un quart de litre. Tant pis pour lui !
Les prisonniers sont dirigés vers le jardin potager, clos de murs. Les sentinelles resteront là, bien sûr, toute la nuit, à surveiller. Michel se couche entre deux sillons de pommes de terre et dort d'une traite jusqu'au petit matin, alors réveillé par un concert de hurlements gutturaux; il est évident qu'il faut se lever. Pas de petit déjeuner, pas d'eau pour se laver. On reprend la route. Un peu de pain et d'eau de temps en temps, offerts par les habitants des villages traversés. On marchera six jours. Quelques débrouillards trouvent à manger, ou ont des provisions. Michel n'est pas débrouillard... Il trouve seulement une boîte de conserve vide, un peu rouillée, mais contenant un litre, pour la distribution de la soupe, chaque soir.
Après avoir couché à Montargis, Beaune-la-Rolande, Château-Landon, Nemours, ils arrivent à Montereau. C'est là qu'ils vont rester jusqu'à leur départ pour l'Allemagne, enfermés dans une grande usine de câbles électriques. Mais ils ne le savent pas encore. Pour l'instant, les bruits les plus fantaisistes circulent : c'est ce qu'on appelle les "bouteillons" (du même mot que les récipients venant des cuisines et servant à transporter la soupe) : "on va être tous libérés pour le 14 juillet : inutile de chercher à s'évader", ou bien: "la France va déclarer la guerre à l'Angleterre" (c'était au moment de Mers-el-Kébir).
Une chose est certaine, c'est qu'on demande des volontaires pour aller faire la moisson dans les fermes des environs: beaucoup se présentent dans l'espoir de se remplir l'estomac, car ici c'est toujours le même régime... presque rien à manger. Au bout de quelques jours, un semblant de ravitaillement s'organise et chacun reçoit... juste ce qu'il faut pour ne pas mourir de faim. Il fait toujours beau temps. On ne fait rien d'autre que dormir et s'épouiller. Michel a écrit à tout hasard à La Closerie et à Pezay, donnant de ses nouvelles et indiquant le lieu où il se trouve. La lettre est partie par une corvée travaillant à l'extérieur. Les Allemands ne savent pas encore le nombre exact de leurs prisonniers; on raconte qu'il serait relativement facile de se joindre à une corvée et de ne pas revenir.
Vers la fin de juillet, un homme de corvée fait passer à Michel un bout de papier sur lequel est griffonné: "Je serai près de la rivière demain matin. Maman". En effet, le lendemain, Michel peut voir sa mère de loin; il lui fait de grands signes. Elle a fait le difficile voyage depuis le Périgord, pour le voir On est beaucoup trop loin pour se parler, d'autant qu'il y a une trentaine de prisonniers qui hurlent et font de grands gestes. Puis on apprend qu'il y a eu trop d'évasions; les corvées sont supprimées ou très surveillées.
Michel reçoit un kilo de haricots secs que sa mère a pu lui faire passer. Il recevra aussi un colis de Pezay. C'est alors que se montent les petites "popotes"; les prisonniers s'agglutinent par petits groupes de deux, trois ou quatre, mettent en commun leurs ressources et mangent ensemble. Il en sera ainsi pendant toute la captivité, et dans tous les camps. Michel fera popote à Montereau avec deux camarades de son régiment: R. Saivres et G. Marchandou. Le premier plat qu'ils se feront cuire sera du riz au chocolat; même sans lait, quel régal!
Après trois semaines de jeûne, son estomac commençant à se rétrécir, Michel a un peu moins faim qu'au début où il a souffert un vrai martyre. Surtout en voyant un camarade manger sous ses yeux : cela décuple la souffrance. Le supplice de Tantale n'est pas un vain mot. Ses fonctions digestives se sont automatiquement presque entièrement arrêtées. Heureusement, il fait beau, on n'a pas d'effort physique à faire, et le fait d'avoir deux camarades remonte le moral. Maintenant, un vague pain noir par jour et il y a une soupe très claire. Le mois d'août commence dans ces conditions. On parle toujours de la libération des prisonniers, mais on commence à en douter. Une chose est sûre, c'est que les Allemands les ont comptés et répertoriés. Chacun reçoit une plaque en carton avec un numéro matricule. Il y a maintenant un bureau, des papiers, des comptables, etc... tous français, mais supervisés par les "Chleuhs". Ceux-ci se montrent plutôt courtois, pour des vainqueurs. Ils s'excusent presque de ne pas donner assez à manger: le ravitaillement n'arrive pas, les ponts sont coupés, les voies détruites. Ils font aussi un peu de politique : "Les Anglais sont des traîtres qui vous ont tiré dessus". Néanmoins, les consignes sont les consignes et celui qui sort des limites est sûr de son affaire. Plusieurs en ont fait l'expérience à leurs dépens.
2. DÉPART POUR L'ALLEMAGNE
Le 1er septembre au matin, un grand train de marchandises se range sur la voie ferrée qui longe l'usine. Les portes en sont ouvertes, laissant voir une botte de paille fraîche par wagon. Le spectacle ne trompe pas : on embarque. Mais pour quelle direction ? Au moment de monter dans le wagon, chaque prisonnier reçoit une boule de pain noir, une boîte de bœuf, un pain de margarine. C'est pour le voyage. On en déduit qu'il sera long. La destination est donc facile à deviner. Michel et ses deux camarades montent dans le même wagon. La porte est attachée avec du fil de fer, les fenêtres sont grillagées. Il y a des vigies armées. Le train démarre. Il semble qu'on aille vers l'Est. On roule assez régulièrement.
La vie semble normale, les employés sont dans les gares, mais très peu de monde dans les champs et dans les villages. Dans une belle propriété privée, deux hommes en pantalon de flanelle blanche impeccable jouent au tennis; cela fait un petit pincement au cœur quand même. Finalement, il rejoint ses camarades et se met à jouer aux cartes avec eux. Dans une grande gare on demande à un employé où on est : "Chalon-sur-Saône". La nuit tombe. Le train repart, roule lentement. Depuis un moment, quatre occupants du wagon remuent la porte à glissière, dans le but d'user les fils de fer. Leur patience est couronnée de succès. Il fait nuit maintenant. Les quatre candidats à l'évasion se préparent et abandonnent à leurs camarades beaucoup de leurs effets militaires. L'un d'eux, un sous-officier du 221ème fait cadeau à Michel d'un très beau ceinturon fantaisie avec baudrier, en cuir très fin et boucle de cuivre qu'il a acheté à un officier espagnol émigré en France à la fin de la guerre civile. Ils profitent de ce que le train ralentit, en pleine campagne, pour une raison inconnue et sautent dans le fossé, l'un après l'autre, à dix mètres d'intervalle environ. Pas de coup de feu, aucune réaction. Tout le monde respire. Tous arriveront chez eux, sauf un qui se sera noyé dans la Saône. On n'est plus que trente six maintenant.
Chacun peut s'étendre sur la paille et dormir, bercé par le bruit des roues et le balancement du wagon, quand il roule, car les arrêts sont fréquents. Le lendemain matin, on s'arrête à une gare "Haguenau". Sur une banderole, une phrase en allemand qui veut dire à peu près ceci : "L'Alsace est heureuse de redevenir allemande", et des oriflammes rouges à croix gammée partout.
Les prisonniers sont enfermés maintenant depuis vingt quatre heures à peu près. Comme le wagon ne possède pas de tinette, ils se débrouillent pour uriner dans une boîte de conserve et jeter le contenu par une lucarne. Ce n'est pas très facile et tous n'y arrivent pas. Heureusement le train s'arrête en rase campagne et les prisonniers peuvent descendre. C'est une sorte de lande entourée de barbelés; il y a même des feuillées et de l'eau potable pour se débarbouiller et remplir les bidons. Un soldat allemand est responsable de chaque wagon et doit vérifier s'il a son compte. On se met en ligne par quatre. Il doit y avoir dix rangées de quatre hommes en face de chaque wagon. Mais à celui de Michel, le soldat en question ne trouve que neuf rangées. Il croit s'être trompé, recommence son compte : pas d'erreur, il manque quatre hommes. Rapport au sous-officier, hurlements de colère. Le long de la rame plusieurs scènes de ce genre se reproduisent. Cela fait beaucoup de bruit pendant dix minutes. Finalement, tout le monde est réintroduit dans les wagons avec force vociférations.
Le train repart. Une certaine tristesse se répand à l'intérieur du wagon. Maintenant, il n'y a plus d'illusions à se faire : on va en Allemagne. Et pour combien de temps ? Le Rhin sera passé pendant la nuit. On ne le verra pas. Ensuite, le train roule plus vite. Vers douze heures, il s'arrête dans la gare de marchandises d'une grande ville. Sur les pancartes on peut lire "Würsburg". Les prisonniers peuvent descendre comme la veille. Appel, cette fois, il ne manque personne. Le train repart. Les prisonniers passeront une troisième nuit dans le wagon.
Ils débarqueront le lendemain sur le quai d'une petite gare : "Hammelburg". Michel craignait d'atterrir dans un centre minier ou industriel. Non, le paysage est champêtre et même agréable. La longue colonne des prisonniers prend une petite route qui serpente à travers une campagne vallonnée. Les habitations sont très propres mais n'ont pas de volets aux fenêtres. Les champs sont petits et bien travaillés. On gravit maintenant une colline assez haute. Au sommet, un camp avec une grande pancarte au-dessus de la porte d'entrée : "Stalag XIII C". C'est un camp comme il y en aura des centaines en Allemagne et en Europe occupée, avec sa double enceinte de barbelés, ses miradors équipés de projecteurs avec son "Posten" bien armé en haut, et ses baraquements presque toujours en bois.
À l'arrivée, la colonne est divisée en plusieurs tronçons et chaque prisonnier est fouillé par un soldat allemand. Cela se fait sans brutalité, ni injure, mais la fouille est sévère. Pour Michel, impossible de sauver le beau ceinturon espagnol. Même le rasoir-couteau est pris; on lui donne à la place un rasoir mécanique. Un petit butin s'entasse aux pieds de chaque fouilleur. Ensuite, ils sont pris en charge par des militaires français, prisonniers comme eux, souvent des sous-officiers. Ceux-ci font partie de l'organisation permanente du camp : nourriture, habillement, courrier, propreté, discipline, etc... Au sommet de la hiérarchie se trouvent les chefs de Block, de baraques et de chambrée.
C'est évidemment l'équitable répartition de la nourriture qui est la chose la plus importante. Quand les boules de pain arrivent, on dit : "Mettez-vous par groupes de six, les gars”, si la boule est à six. Comment partager une boule de pain de un kilo huit en six parts rigoureusement égales et avec un canif, car les bons couteaux ont été pris à la fouille ? Pour cela, ils fabriquent des petites balances de fortune faites avec une baguette de la longueur de deux crayons à peu près, une ficelle au milieu et une ficelle terminée par une pointe à chaque extrémité. On fait le poids en ajoutant ou en retranchant des petits bouts à chaque morceau. Ceux-ci sont alignés côte à côte. Celui qui a partagé met la main sur un des morceaux et dit à un de ses camarades qui tourne le dos : "Pour qui celui-là ?", et ainsi de suite. Malgré ce luxe de précautions, chacun louche sur le morceau de son voisin, le trouvant plus gros que le sien.
En plus de ce morceau de pain, pain noir naturellement, on a droit à une cuillerée de confiture ersatz ou à vingt grammes de margarine suivant les jours. Le pain est souvent distribué le soir. Mais la soupe est à midi en général. Il faut aller la chercher aux cuisines avec le récipient adéquat; des baquets en bois contenant vingt ou trente litres, un litre par homme. Là, il faut veiller à ce que le cuisinier remue bien le contenu de sa grande marmite, pour ne pas avoir le dessus, c'est-à-dire de l'eau. Le matin au réveil, on touche un litre de "thé". Le prévoyants gardent toujours un bout de pain de la veille pour pouvoir le tremper dedans.
Presque tous les prisonniers sont couverts de poux. Ils vont donc passer aux douches et à la désinfection. Les cheveux sont passés à la tondeuse, les poils du corps sont rasés. Tous les uniformes et effets personnels restent dans des chambres closes et sont stérilisés à la vapeur pendant deux bonnes heures. Après, les prisonniers pourront rejoindre leur lieu de travail. Ces "Kommandos", comme on les appelle, peuvent être de cinq, dix, quarante hommes ou plus, suivant l'importance de l'exploitation industrielle ou agricole où ils sont employés.
3. NICHT ARBEIT, NICHT ESSEN (pas travailler, pas manger)
Vers le 10 septembre, Michel et ses deux camarades périgourdins plus dix-sept autres que le hasard a désignés, sortent du camp, accompagnés de deux soldats armés, et vont prendre le train à la gare de Hammelburg. Un train de voyageurs, cette fois. Le voyage dure quelques heures. Ils débarquent dans une gare située près d'une usine assez importante. Une odeur de caramel flotte dans la région. Sur l'usine, cette pancarte : "Lebkuken Bären-Schmidt" (Petits gâteaux Bären-Schmidt). Ils sauront bientôt qu'il s'agit d'une usine de petits beurre. Mais ce n'est pas là qu'on va travailler, sans doute, car on se dirige vers le village situé à 3 km environ.

Le pays est plat, verdoyant. Le village en question s'appelle : "Mainbernheim". C'est un gros bourg entouré de remparts moyenâgeux. Les maisons aux toits pointus et à colombage, avec souvent des enseignes en fer forgé sont très pittoresques. Les rues, assez étroites en général, sont pavées. On entre dans une cour; à gauche, une salle où sont une douzaine de lits à deux étages. Au fond, une étable pour les trois taureaux communaux; le village est essentiellement agricole. A droite, le logement du vacher et de sa famille. Un grand sous-officier allemand est là qui les attend, avec un soldat français qui servira d'interprète. Le discours de l'Allemand, traduit au fur et à mesure, se résume en quelques mots : "Arbeit, arbeit", et "nicht arbeit, nicht essen" (1), dits d'un air furieux, bien entendu. Il y a également un passage très important : "Ne pas toucher aux femmes allemandes sous peine de camp de discipline. Vous aurez le droit d'écrire chez vous deux fois par mois". Ensuite, chacun est prié de donner sa profession. Outre les cultivateurs, en majorité, il y a là un pharmacien, un peintre en bâtiment, un instituteur, un vendeur de journaux parisien, un mécanicien garagiste, un boucher breton et un ingénieur d'origine polonaise nommé Strozecki. Après avoir hésité, Michel dit qu'il est engagé volontaire.
Dès le lendemain, Michel va, comme ses camarades, mais lui c'est pour la première fois de sa vie, essayer de gagner son pain à la sueur de son front. Il est envoyé, en compagnie de l'instituteur périgourdin, chez un cultivateur des environs. La ferme n'est pas loin, elle est à l'intérieur des remparts. Au petit jour, le patron attelle ses chevaux et on part chercher de la verdure pour les vaches qui sont nourries à l'auge. En vitesse, on remplit la charrette de "Sonne Blumen" autrement dit tournesols. En rentrant, il faut les passer au hachoir mécanique et distribuer aux bêtes. Pause casse-croûte, l'Allemand n'est pas loquace. Puis tout le monde part arracher des pommes de terre, au moyen d'une sorte de bigot à trois dents. Un jeune Polonais, prisonnier aussi, mais en civil, est avec eux. On attaque le champ qui a bien 100 mètres de long.
A midi, l'Allemand et le Polonais sont arrivés au bout de leur sillon, les pommes de terre proprement rangées, impeccables. Les deux Français n'en sont qu'à la moitié et encore le travail est-il visiblement mal fait, beaucoup de pommes de terre entaillées par l'outil. L'Allemand mécontent, grommelle quelque chose. On rentre à la maison. Le déjeuner est plutôt frugal, à base de boulettes de pommes de terre. Et on recommence aussitôt après. Les deux Français font ce qu'ils peuvent, mais le résultat n'est pas magnifique. Le soir, ils sont morts de fatigue, ont droit à un peu de bouillon, un œuf sur le plat - Michel en aurait bien mangé deux - et quelques patates. Retour au Kommando, sommeil d'un trait jusqu'au lendemain matin.
Mais au départ, le grand sous-officier, sans doute alerté par le cultivateur mécontent, leur fait à tous les deux un petit discours où ils comprennent seulement le mot "Sabotage", cela se dit en allemand comme en français.
Retour à la ferme où l'on prend les outils mais ce n'est pas le fermier qui va les accompagner, c'est une sentinelle armée. On va dans un autre champ, plus petit, assez isolé. Le soldat dit : "Los, arbeit". Les deux Français, craignant le pire, se donnent un mal de chien. Mais le résultat n'est guère meilleur que la veille. L'Allemand, qui n'est probablement pas idiot, se rend compte qu'il a affaire à des maladroits plutôt qu'à des saboteurs et l'incident sera clos ainsi : le lendemain, plus question de retourner à la ferme, le grand sous-officier les confie tous les deux au chef cantonnier du bourg. Travail moins pénible. Bien ranger des pavés sur un lit de sable bien plat n'est pas désagréable. On a un peu l'impression de jouer aux cubes. Le chef cantonnier est un peu plus loquace. Il dit "Krieg, gross malheur, ya, ya" (La guerre, grand malheur, oui, oui), ou bien "Um Weihnachten zurük zuhaus ya, ya" (A Noël, retour à la maison, oui, oui.), et il leur donne un morceau de son casse-croûte.
Au bout de quelques jours, on commence à s'habituer les uns aux autres. Les Français donnent des surnoms aux Allemands, pour s'y reconnaître. Par exemple, ils appellent le chef cantonnier, qui est borgne, "Oeil de Lynx". Le grand sous-officier, c'est évidemment "Double mètre". Celui-ci, par contre, appelle les prisonniers par leur profession : "der Lehrer, der Mahler" (l'instituteur, le peintre): quand il appelle Michel, il dit : "der Bischof" (l'évêque). Sans doute il ne le prend pas pour un vrai "Beruf Soldat", ce en quoi il n'a pas tort. Le "Bischof" en question va maintenant casser des cailloux pendant une dizaine de jours, à l'extérieur du village.
Le travail n'est pas trop pénible. La massette qui est donnée aux deux Français n'est pas trop lourde. Il faut seulement faire attention de ne pas recevoir un éclat dans les yeux, ce qui a dû arriver à "Œil de Lynx". Ensuite, changement de décor : c'est la batteuse. Elle arrive, tirée par le tracteur communal et va, comme en France, de maison en maison. Si le travail est à peu près le même qu'en France, la nourriture et la boisson diffèrent. Pas de vin naturellement. Un peu de cidre, assez rarement, pour faire couler la poussière. A midi et le soir, une sorte de buffet assis où chacun se sert de pain et de beurre, jambon et café (malt) au lait. Mais les non cultivateurs ne suivront pas la batteuse très longtemps. Heureusement pour Michel qui en avait bien assez.
Un matin, au réveil, c'était au début novembre, ils sont mis à part dans la cour et en route pour l'usine de petits beurre. C'est là, qu'ils vont travailler désormais. Pour commencer, on les fait entrer au vestiaire où on donne à chacun une veste en toile bleue pour remplacer la vareuse d'uniforme trop chaude, et un tablier. Puis on les affecte un par un à leur poste de travail. L'usine fabrique toutes sortes de petits gâteaux, fourrés ou non, et même des bonbons, dont quelques-uns au chocolat. Michel est placé à la sortie de l'énorme four, long de trente mètres environ, traversé par des chaînes sur lesquelles sont placées les plaques chargées de gâteaux. La vitesse de ces chaînes est calculée pour que les gâteaux soient cuits à point à la sortie. Là, un ouvrier attrape les plaques au fur et à mesure, les débarrasse de leurs gâteaux en les frappant d'un coup sec avec un marteau au-dessus d'une vaste corbeille. Puis met les plaques vides sur une autre chaîne à sa portée. Il faut maintenant nettoyer ces plaques vides pour qu'elles puissent resservir. C'est Michel qui est chargé de ce travail. Il a un grattoir d'une main et un tampon d'huile de l'autre. Au début, tout va bien. Il fait bon dans l'usine; les ouvriers sont plutôt aimables. Parmi eux, beaucoup d'ouvrières en général assez jeunes. Mais elles ne regardent pas les prisonniers : on leur a fait la leçon certainement. Au bout d'une heure ou deux, Michel se rend compte que le travail est moins facile qu'on peut le penser au premier abord.
Si on a le malheur de perdre une seconde, il est presque impossible de rattraper le retard, même en gesticulant comme un forcené. La plaque mal nettoyée reviendra un quart d'heure plus tard un peu plus sale que la normale, il faudra plus de temps pour la rendre propre et c'est un cercle vicieux. Enfin, la journée se passe à peu près bien quand même. Le soir, au Kommando, chacun raconte ses impressions et le camelot parisien dit avec son accent faubourien : "Ah, dis donc, t'as pas vu Storelli avec ses plaques, on aurait dit Charlot dans les "Temps Modernes". Plutôt petit et malingre, ce camelot parisien, qu'on surnommait "Bébert", était plein de gouaille et de malice. Il arrivait à jouer des tours aux Allemands sans que ceux-ci ne s'en aperçoivent.
C'est ainsi qu'un dimanche matin, le vacher, qui habite en face d'eux dans la cour, demande deux hommes de corvée pour l'aider à descendre trois sacs de pommes de terre dans sa cave. Bébert et Michel sont désignés. Les deux premiers sacs ne sont pas trop lourds et les deux Français, en se mettant à deux par sac, arrivent à les descendre par l'escalier assez raide. Mais le troisième est énorme. Le sac est debout sur la marche du haut. Bébert dit : "T'en fais pas, tu vas voir". Et il pousse le sac qui bascule, rebondit dans l'escalier en bois qui gémit sous le choc. Deux tours de plus, le lien s'arrache et le "Chleuh" en bas est enseveli sous ses pommes de terre, ainsi que la bougie qui, du coup, est éteinte. Bébert se tord de rire en entendant les jurons sonores comme "Herr Gott Sacramento" (Sacré nom de Dieu), puis il fera semblant de s'excuser en disant que le sac nous a échappé.
Les journées se suivent, à l'usine, où l'on prend les repas à midi et le soir, même le dimanche. Ce jour là, l'usine ne tourne pas, mais les prisonniers sont souvent réquisitionnés pour des corvées de neige ou de nettoyage. D'autre part, chacun a reçu des nouvelles de France, où il semble que la vie se réorganise peu à peu. Mais un triste événement va bouleverser cette existence, somme toute, acceptable.
4. LA DIPHTÉRIE
Un matin du mois de décembre, au réveil, un camarade cultivateur, nommé Souris, se déclare malade, demande à rester couché. Le "Posten" lui dit : "Los, arbeit", et l'envoie chez son patron. Le soir, quand on rentre, il est déjà au lit où son patron l'a envoyé. Il a manifestement beaucoup de fièvre et respire difficilement. On demande un médecin à la sentinelle qui dit : "Morgen" (demain). Le lendemain, tout le monde part au travail. Quand ils rentrent le soir, ils retrouvent le pauvre Souris mort. Il est mort, seul, abandonné de tous, enfermé dans sa chambre. Le médecin arrive enfin : c'est la diphtérie. Le jour suivant, une ambulance militaire arrive, avec médecin et infirmières; ils examinent attentivement la gorge de chacun des Français et prélèvent une parcelle de muqueuse, en vue d'analyse. Cette analyse se révélera positive pour cinq d'entre eux, dont Michel et ses deux camarades périgourdins. Ils vont donc partir pour l'hôpital mais auparavant, ils vont assister à l'enterrement de leur camarade. Quatre Français, choisis parmi ceux de son pays, qui le connaissaient, portent le cercueil jusqu'au cimetière situé à l'intérieur du bourg. Le sous-officier allemand fait une allocution toute militaire. On a compris qu'il le félicitait d'être un brave soldat mort pour son pays. Aucun civil, aucun prêtre ou pasteur n'assiste à la cérémonie. Le village est certainement protestant. On n'entend jamais de cloches.
Le lendemain, les cinq porteurs de germe sont embarqués dans une ambulance qui va les emmener à l'hôpital militaire d'Ebelsbach. C'est, en fait, un camp entouré de barbelés, mais à usage sanitaire exclusivement. Il neige et il ne fait pas chaud. Les cinq porteurs de germe sont mis en quarantaine dans une toute petite baraque bien séparée des autres. Ils resteront là, trois semaines, en observation mais, à leur arrivée, on leur fait à chacun un bon sérum contre la diphtérie. Aucun d'eux n'est malade heureusement. Ils n'ont que l'ennui et la faim à supporter. La soupe journalière de l'hôpital est uniquement et régulièrement à base de feuilles de rutabagas. Comme il y en a un grand champ qu'un paysan est en train de finir d'arracher, juste de l'autre côté des barbelés, les prisonniers supposent qu'il garde les racines pour ses bêtes et vend les feuilles pour la soupe des Français. Évidemment ce régime est fait pour décourager les "tire au flanc" et ils aspirent à retourner au Kommando, ce qui arrive en effet peu avant Noël. Mais la diphtérie est une maladie sournoise. Dans le courant de janvier, un autre Français se plaindra de la gorge, en pleine nuit. Il a de la peine à respirer. Aussitôt, ses camarades appellent au secours et arrivent à réveiller la sentinelle qui dort non loin de là. Le malade va être évacué vers Ebelsbach immédiatement. Sera-t-il sauvé ? On peut en douter, car il n'est jamais revenu au Kommando. Coïncidence ou autre raison, ce prisonnier était un nouveau venu du Stalag pour remplacer Souris dans la ferme où il travaillait.
A leur retour au Kommando, les cinq reprennent leur travail, les uns à l'usine, les autres à leur ferme. Au moment de Noël, il n'y a aucun office religieux, du moins pour les prisonniers. Par contre, il y a des sapins partout, même dans l'usine qui va fermer ses portes pendant quatre ou cinq jours. Avant de partir pour leur congé, les ouvriers sont réunis dans la grande salle. Sur les tables recouvertes de nappes, il y a un cadeau bien enveloppé pour chacun des ouvriers. Sur une table à part, dix cadeaux identiques aux autres pour chacun des prisonniers. Le directeur arrive et fait une allocution. Il est à supposer qu'il souhaite aux ouvriers un bon Noël et une bonne année 1941 qui verra, n'en doutons pas, la victoire de l'Allemagne. À la fin du discours, tout le monde chante un hymne qui doit être le "Deutschland über alles".
Les prisonniers rejoignent leur baraque où ils resteront enfermés pendant cinq jours. Chacun découvre dans son cadeau un bon kilo de gâteaux variés, quelques uns très bons, des cigarettes et une bouteille de bière. Comme on commence à recevoir des colis de France, on ne souffre plus de la faim. Pour passer le temps, Michel a fabriqué un jeu d'échecs très grossier avec un vieux manche à balai et fait de longues parties, principalement avec Marchandou et Strozecki.
5. CE QUE LES PRISONNIERS FRANÇAIS À MAINBERNHEIM PENSENT DE L'ALLEMAGNE ET DE LA DÉFAITE DE LA FRANCE
Ce Strozecki n'est pas le premier venu. Plus âgé que ses camarades et ingénieur, avant la guerre, dans une usine parisienne, il est le seul à savoir bien l'allemand. Il doit savoir aussi le russe, car il a fait, a-t-il dit, des séjours à Moscou. Pour lui, le communisme est l'avenir, c'est l'évidence même. Il fait également l'éloge de l'Allemagne et des Allemands. (Il est vrai que la Russie est l'alliée de l'Allemagne, à cette époque, pour cinq mois encore). La discipline et l'organisation allemande font merveille, dit-il, ainsi que leur sens communautaire. Les agriculteurs français regardent souvent, avec envie, les maisons propres et bien meublées de leurs collègues allemands. Les champs sont très bien travaillés et les paysans sont aidés par la commune qui commande les engrais en gros, à des prix avantageux, et leur prête le tracteur communal au moment des gros travaux. D'autre part, les ouvriers allemands, même ceux de la base, sont respectés et mieux traités que leurs homologues français.
La sécurité dans le travail et les installations sanitaires sont également bien supérieures en Allemagne qu'en France. Il faut dire que le directeur de l'usine a tout de suite repéré Strozecki, et l'a pris comme adjoint dans son bureau. Il améliore, paraît-il, le rendement des machines et en invente de nouvelles. Strozecki possède un Assimil d'Allemand et il essaie, le soir et les jours de congé, d'apprendre cette langue à ses camarades. Mais il n'a que deux élèves, Marchandou et Michel. Il y a aussi le boucher breton qui a beaucoup de dispositions. Mais lui, il n'a pas besoin d'Assimil pour apprendre l'Allemand. Il le parle, toute la journée, à la boucherie-charcuterie de Mainbernheim. Double-mètre est très content de lui, et on dit que Hitler va donner l'indépendance à la Bretagne, et que les Bretons vont être rapatriés. Le soir, plutôt que d'écouter Strozecki et apprendre l'Allemand, les autres prisonniers préfèrent jouer aux cartes ou se raconter les bons tours qu'ils ont joués à leur patron pendant la journée. Quelquefois, ils demandent à l'un d'entre eux de chanter une vieille chanson sentimentale, et ils rêvent à leur famille et à leur pays.
Tous, sauf peut-être Strozecki, n'ont pas encore digéré l'amertume et la honte de la défaite. Il y a de longues conversations le soir, avant de s'endormir. Chacun raconte ce qu'il a vu et on n'est pas tendre envers les généraux et les politiciens. En conclusion, on dit : "Une pagaille pareille, aussi bien dans la préparation que dans l’exécution de la guerre, n'est pas possible; on a été vendus, trahis; les généraux sont des traîtres". A peu près seul, contre tous, Michel donne son opinion : "Le gouvernement était inefficace depuis plusieurs années, d'accord, les généraux, souvent incompétents et se reposant sur les lauriers de 14-18, c'est exact, mais le commandement n'a pas trahi, il a été débordé, submergé". Et Michel ajoutait : "Tous les soldats qui perdent une bataille crient : trahison. Cela s'est passé ainsi à Waterloo. Même les Gaulois de Vercingétorix à Alésia ou les soldats de Pompée à Pharsale se sont crus trahis".
Quelquefois, pendant ces conversations où les prisonniers remuent leurs souvenirs et leurs idées, ils entendent la petite garnison du bourg, une trentaine d'hommes, qui passe dans la rue voisine, au pas et en chantant, bien entendu. Ils admirent la beauté du chant bien rythmé par le bruit des bottes sur le pavé et disent : "Ils chantent bien les salauds".
6. NE PAS DIRE DU MAL DU FÜHRER - ADIEU MAINBERNHEIM
A l'usine, la vie continue, toujours la même. Les repas sont pris dans une salle située dans un sous-sol de l'usine et à part des autres ouvriers. Une jeune femme d'environ trente ans, appelée Hilde, leur fait la cuisine. Quatre ou cinq prisonniers, parmi les plus jeunes, font une cour platonique à Hilde et se disputent presque l'honneur de rester seul avec elle, après les repas, pour l'aider à faire la vaisselle et ranger les affaires. Hilde, ravie d'avoir tant de soupirants, fait une cuisine convenable. Les prisonniers commençant à savoir un peu d'allemand, la conversation dévie un jour sur les évènements et Hilde déclare que Hitler est un nouveau Napoléon. Un des prisonniers, un jeune, se met à rire et lui explique que Hitler n'est qu'un pantin ridicule comparé à Napoléon. C'était dangereux, évidemment, de s'attaquer au Führer. Dès le lendemain, le prisonnier en question est muté dans un Kommando très dur, sur la voie ferrée Würsburg-Berlin. Depuis ce jour, les rapports furent beaucoup plus froids entre Hilde et les Français.
Au travail à la chaîne, Michel est de plus en plus débordé par ses plaques. Le contremaître se place souvent derrière lui et le regarde avec un drôle d'air. Un matin, dans les derniers jours de mars 1941, la sentinelle lui dit de préparer ses affaires. Il ne va pas à l'usine mais à la gare où ils montent dans un omnibus qui arrive juste. Le voyage est très court. Ils font quelques kilomètres à pied pour arriver dans un village tout à fait différent de Mainbernheim. Sur la pancarte routière on peut lire: Willantzheim.
7. WILLANTZHEIM
Ici, il n'y a pas de remparts, pas de pavés. Ce n'est pas l'Alsace comme à Mainbernheim, c'est presque la Beauce. Il y a une large rue centrale, avec des fermes de chaque côté. Au centre, une place avec une église surmontée d'un clocher. Le Kommando est au bout de la rue. C'est une grande pièce avec une vingtaine de lits à trois étages. Michel pose ses affaires et le "Posten" du Kommando l'emmène sans retard à la ferme où il doit travailler. Il y a là quatre personnes : le patron et la patronne, leur fille âgée de vingt ans environ, mais qui est bossue, et un prisonnier français. Michel est content d'avoir un camarade. Il est midi, on va se mettre à table. Avant de s'asseoir, la patronne fait le signe de la Croix et dit le Benedicite en latin, mais avec un fort accent germanique. Son mari et sa fille répondent. Le repas est vite expédié, comme toujours en Allemagne. Et après, au travail.
Pour Michel, le dépaysement est complet. Son nouveau camarade s'appelle Justin Gaminade. Les Allemands et même les Français, maintenant, disent "Joustine". C'est un jeune cultivateur du Nord de la France, à peu près illettré, mais très fort physiquement et très adroit au travail. Le patron s'appelle Schiffmayer. Il a fait la guerre de 14-18 et en a certainement souffert. Bien qu'il ne parle jamais de politique, Michel, avec le temps, comprendra qu'il n'aime pas beaucoup le gouvernement actuel de l'Allemagne. Il dit souvent : "Krieg, nicht gut" ("La guerre, pas bon"), avec un air qui en dit long. Il a vite compris que le nouvel arrivant ne savait pas travailler mais était facile à commander, ce qui n'est pas le cas pour "Joustine". Celui-ci, en effet, supporte difficilement sa condition de prisonnier et l'autorité de son patron. C'est lui qui mène les chevaux et il veut faire le travail comme il l'entend.
Au début, Michel arrive assez facilement à faire ce qu'on lui demande. A l'étable, soins aux animaux, fumier à sortir, etc... Dehors, épierrer les champs, engrais à semer (à la main), pommes de terre à planter. Les journées sont encore courtes et tout marche à peu près bien. Mais vers le 15 avril, c'est l'éclaircissage des betteraves, et ce travail très long, très minutieux et assez fatigant car on travaille toujours courbé, durera une quinzaine de jours. Un beau matin, Schiffmayer emmène ses deux ouvriers attaquer l'éclaircissage du grand champ, de un hectare environ, de betteraves fourragères. Chacun prend un sillon, muni de son petit outil appelé "rasette". Et la course commence, si l'on peut dire, comme pour les pommes de terre de Mainbernheim. Michel n'avait jamais fait ce travail. "Joustine" le regarde faire d'un air amusé. Malgré ses efforts, Michel est bientôt distancé. Mais le plus ennuyeux pour Schiffmayer, c'est que "Joustine", par camaraderie envers son compatriote et peut-être ravi de jouer un bon tour à l'Allemand, se freine exprès, et les deux Français travaillent de conserve à la même allure, toute la journée. Le pauvre Schiffmayer comprend qu'il est floué, mais résigné, ne dit rien.
En dehors de "Joustine", il y a quarante-sept autres prisonniers français dans ce village, presque tous cultivateurs. En fait, ce sont eux qui font marcher les fermes. Il y a, en plus, à Willantzheim, un ancien prisonnier français de 14-18 qui est resté là et s'y est marié. Mais il évite ses compatriotes. Une seule sentinelle pour garder tout ce monde dispersé dans la nature, mais qui rentre ponctuellement tous les soirs, au Kommando; sentinelle très débonnaire, qui n'a jamais son fusil, et qui dit : "Gut nacht ("Bonne nuit”) le soir, avant d'enfermer ses prisonniers à clef.
Chez les Schiffmayer, on ne fait pas beaucoup de frais de nourriture. A peu près tout est fourni par la ferme : charcuterie, œufs, pommes de terre à tous les repas, choux. Le pain sert à faire des sandwiches au beurre ou aux confitures de myrtille qu'on emporte dans les champs, avec la bouteille de cidre.
Le samedi, chaque fermière confectionne un énorme "Kugelhof” mais qui est plat et rectangulaire, qu'elle porte sur sa plaque, chez le boulanger. Celui-ci fait une fournée spéciale, et dans chaque maison on se régale le samedi soir, le dimanche et quelquefois le lundi, s'il en reste, en le trempant dans du "café" au lait. "Joustine" et Michel, qui ont reçu des colis de France, demandent quelquefois à Frau Schiffmayer de leur faire du chocolat au lait. Celle-ci obéit, et elle a du mérite, car en général, les Français ne lui en offrent pas, alors qu'ils savent très bien que les Allemands en sont privés.
Le dimanche aussi, toute la population, sauf les Français, va à la messe. Il y a un curé résidant à Willantzhein, et même un petit couvent, avec quelques religieuses. Le matin de Pâques, de très bonne heure, la sentinelle en réveillant les prisonniers leur dit de s'habiller proprement et de se raser. Puis les emmène colonne par deux à l'église. Ils sont seuls dans l'église avec le "Posten". Le curé dit la messe, spécialement pour eux. Avant la communion, il leur donne une absolution collective et s'approche de la Sainte Table avec son ciboire. Michel se lève pour aller communier. Tous les autres, sans exception, suivent. Ensuite, on rentre au Kommando, on reprend la tenue habituelle pour aller faire le travail journalier, à l'étable. Les vaches sont nourries à l'auge et ne sortent jamais: betteraves l'hiver, fourrage vert haché l'été, foin en toutes saisons.
En mai, les sarclages sont presque terminés et la saison des foins arrive. Avec la chaleur, le travail est rendu plus pénible et les journées sont longues. Heureusement, les Schiffmayer ne demandent pas à Michel plus qu'il ne peut en faire.
Puis, le fameux 22 juin 1941 arrive. Comme tous les jours, à midi, au moment du repas, Herr Schiffmayer tourne le bouton de la radio pour écouter le communiqué : "Der oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt..." ("L'état major général de l'armée donne le communiqué suivant"). Michel comprend maintenant un peu l'allemand et il écoute attentivement. Avant, il était question de bombardements aériens sur l'Angleterre, de guerre en Yougoslavie, puis en Grèce. Mais là, il s'agit bien de la Russie. Schiffmayer et sa femme n'ont pas l'air ravi. Leur fils unique, âgé de vingt-deux ans, est soldat, et la Russie ne leur dit manifestement rien qui vaille. Le lendemain, le communiqué reste dans le vague et ne dit rien d'intéressant. Le soir, au Kommando, les Français discutent à perte de vue sur l'événement. Celui qui travaille chez le "Bauer führer" ("Chef des Paysans", sorte de fonctionnaire communal) dit à ses camarades que son patron s'est suicidé en laissant à sa famille son testament dans lequel il dit qu'il ne croit plus à Hitler. "Joustine", lui, est ravi. Il dit à Michel que les Russes ont une armée de quinze millions d'hommes et que : "Les Chleuhs sont foutus".
Hélas, quelques jours plus tard, au communiqué, on entend après des chœurs guerriers et des marches militaires, un bulletin de victoires phénoménal. En une semaine, à peine, les armées motorisées allemandes ont conquis presque toute l'Ukraine et fait des millions de prisonniers. C'est la campagne de France à l'échelle russe. Le visage des Allemands s'éclaircit, naturellement, surtout celui des femmes. Schiffmayer, vieux soldat, ne dit rien. Mais les jours suivants, quand les nouvelles sont confirmées, "Joustine" est pris d'une crise de désespoir telle qu'il prend une fourche et veut tuer un Allemand. Michel se dispute avec lui et lui arrache la fourche. Alors "Joustine" va à l'étable et passe sa colère sur une malheureuse vache. Il lui tord le cou en l'attrapant par les cornes; la vache râle, les yeux révulsés, tombe sur les genoux, et va mourir peut-être. Michel, affolé, cogne de toutes ses forces avec sa fourche sur les bras et les mains de son camarade pour le faire lâcher prise. Sous la douleur, "Joustine" reprend ses esprits et dit : "Tu m'as fait mal". Michel lui répond : "Oui, mais si tu avais tué la vache, on aurait été fusillés". Ce qui était vrai.
En juillet, la moisson arrive. "Joustine" conduit la moissonneuse lieuse tirée par trois chevaux. D'abord l'avoine, puis l'orge, puis le blé. Il fait son travail et il le fait bien. Il y prend plaisir même, surtout que la récolte est magnifique et c'est lui qui l'a semée avec Schiffmayer, l'automne précédent. Michel ramasse les gerbes derrière la lieuse et les entasse en moyettes bien alignées. La botte qui recouvre chaque moyette doit être tournée vers l'ouest : "Nach Frankreich" (vers la France) lui a dit Schiffmayer. Il prend plaisir, lui aussi, à ce travail et il pense : "Pourquoi faut-il que les hommes s'entretuent, alors qu'il serait si facile de se comprendre, en moissonnant un champ de blé, par exemple".
Fin août, début septembre, la batteuse arrive et "suit” toutes les maisons. Michel a déjà fait ce travail un jour ou deux, à Mainbernheim, en octobre dernier. Mais là, il fait plus chaud et il y a davantage de poussière. C'est à peine s'il arrive à faire passer ces grosses bottes de paille, au bout de sa fourche, par les petites trappes des greniers. De plus, il respire mal la nuit, car son lit étant juste sous le plafond, il avale l'air vicié et les fumées de cigarettes de ses quarante huit camarades. Sans parler de l'odeur de la tinette qui est dans la pièce même où ils sont enfermés.
Un après-midi, bien qu'il n'ait rien demandé, la sentinelle l'emmène chez le médecin le plus proche. Il est possible que ce soit sur la demande des Schiffmayer qui ont remarqué sa fatigue. Le médecin l'ausculte attentivement et lui fait comprendre qu'il va rentrer en France comme malade des poumons. Pour l'instant, il donne un billet à la sentinelle.
Dès le lendemain, Michel dit adieu à ses camarades et aux Schiffmayer et prend le train pour Ebelsbach, toujours accompagné d'un ange gardien, bien entendu. Là, il n'est pas mis en quarantaine heureusement, comme dix mois auparavant. L'hôpital est toujours le même mais il est beaucoup plus peuplé. Il y a en plus des Français, des Serbes et même des Australiens faits prisonniers en Afrique du Nord. Il y a aussi une bonne centaine de prisonniers russes. Ils sont séparés des autres. Ils sont absolument squelettiques et peuvent à peine se tenir debout. À vrai dire, ils font pitié. La soupe est toujours la même. C'est-à-dire minable. Michel pense qu'il a une chance d'être rapatrié comme malade, mais que, s'il l'est réellement, ce serait ennuyeux. Tout dépend du médecin qui va l'examiner. Il passe donc la visite quelques jours plus tard. C'est un capitaine médecin français, prisonnier lui aussi, qui l'ausculte aussi attentivement que l'a fait le médecin allemand cinq jours avant. Son diagnostic est formel et tout à fait opposé : il n'y a rien d'anormal. "Vos poumons étaient engorgés accidentellement par la poussière, ce qui explique le diagnostic de mon collègue. Honnêtement, je ne peux pas vous faire rapatrier. Comme vous êtes sous-officier, tout ce que je peux faire, c'est de vous faire envoyer dans un Kommando de travail léger où sont des aspirants et des sous-officiers". Michel admire, à part lui, la conscience professionnelle de ce médecin. Il ne sera donc pas rapatrié.
L'organisation pour la répartition des prisonniers suivant leurs capacités est vraiment remarquable : huit jours après environ, il est embarqué à la gare d'Ebelsbach. Quelques heures de voyage en train omnibus et il descend, toujours accompagné d'un "Posten", dans une ville appelée : "Crailsheim".
8. CRAILSHEIM - APRÈS LES GÂTEAUX, LA CONFITURE
L'usine de confiture "Bourtchousky Marmeladen-Fabrik" est située dans la banlieue de Crailsheim. Elle est moins importante que celle de Mainbernheim, une centaine d'ouvriers environ. A côté de la grille d'entrée, il y a une sorte de poste de garde, ou de conciergerie. C'est là que se trouve le sous-officier allemand responsable des prisonniers du secteur. La grande cour est entourée, d'un côté par les bâtiments de l'usine proprement dite, de l'autre par le foyer des ouvriers, les installations sanitaires et les bureaux. Au fond, se trouve la chaufferie dominée par la grande cheminée en briques de vingt-cinq mètres de haut. Derrière le foyer, se trouve la belle habitation moderne de Herr Bourtchousky et de sa famille. En face, des sortes de communs ou de garages au-dessus desquels sont logés les quinze prisonniers français. Il y a deux pièces. Dans chacune, cinq lits à deux étages avec leur paillasse. Les nouveaux camarades de Michel sont à peu près tous sous-officiers ou aspirants. Parmi eux, il y a deux ingénieurs, un représentant en vins, un pâtissier, un danseur de claquettes au Casino de Paris, un quartier-maître de la marine, un étudiant en faculté et un huissier. Ce dernier se nomme "André Dussol", et c'est avec lui que Michel va surtout se lier car il est du Périgord, de Saint-Aulaye exactement.
Tous sont arrivés le matin même, venant directement du Stalag, et n'ont pas encore travaillé. Le directeur arrive, les passe en revue dehors, et demande à chacun sa profession en le regardant attentivement. Les plus forts seront affectés à la chaufferie ou au maniement des sacs de sucre qui pèsent cent kilos. Les autres auront des travaux moins pénibles. C'est, évidemment, le cas de Michel qui, cette fois, s'est déclaré étudiant. Aussi, lui apprend-on, dès le lendemain, toutes les finesses du glaçage des fruits. Ces fruits, ce sont des cédrats coupés par la moitié ainsi que des peaux d'oranges ou de citrons. Cela se fait dans des cuves en cuivre pouvant contenir au moins cent litres de sirop. Ces cuves peuvent basculer. On peut les pencher ou même les vider avec un effort très minime. Elles sont chauffées à la vapeur. Quand le sirop est fait, on le laisse refroidir un peu. On bascule légèrement la cuve. Avec une spatule en bois, on agite le sirop sur le bord penché de manière à ce que celui-ci en se refroidissant, commence à changer de couleur. C'est à ce moment précis (c'est une question de secondes), qu'il faut verser les fruits dans la cuve où ils restent quelques minutes. Ensuite, il faut les sortir avec une grosse écumoire et les mettre à égoutter sur des claies. Quand les ouvrières les rangent ensuite pour la vente, il ne faut pas qu'ils soient collants. S'ils le sont, c'est raté et on vous regarde de travers. Comme toujours, Michel fait de son mieux et s'en tire à peu près. Là, on n'est pas à la chaîne, on peut prendre son temps. Le directeur, lui-même, vient examiner son travail et semble satisfait. Comme à Mainbernheim, les ouvriers et les ouvrières regardent les Français avec une curiosité bienveillante et parlent quelquefois avec eux, moitié en petit nègre, moitié par gestes, quand le directeur n'est pas là, bien entendu. Ce dernier est un Colosse blond, tête presque rasée. Il n'a pas l'air commode.
Les prisonniers prennent leurs repas en ville, dans un restaurant à l'écart des autres clients. Une sentinelle les accompagne et ils marchent dans les rues, (les trottoirs leur sont interdits), colonne par deux et bien en ordre. La nourriture est convenable, bien qu'un peu juste en quantité. Mais on a de la confiture à peu près à volonté, car ceux qui travaillent à l'emballage arrivent à en chaparder, ainsi que du sucre. D'autre part, les colis venant de France arrivent bien. Le soir, après le travail, ils ont libre accès aux installations sanitaires, baignoires et douches assez luxueuses; et également, la libre disposition du foyer des ouvriers, vaste salle bien chauffée avec sièges rembourrés et un poste de radio par lequel ils ont appris l'entrée en guerre des U.S.A. et du Japon. La guerre devient planétaire, son issue bien incertaine et le retour en France bien compromis.
Juste à côté de cette usine de confitures et simplement séparée d'elle par un mur, il y a une fabrique de chaussures. Là, travaillent une trentaine de Français presque tous des aspirants volontaires car, d'après la Convention de Genève, ils ne sont pas obligés de travailler. Parmi eux il y a un prêtre. Tous les dimanches, les Français des deux usines se réunissent à peu près au complet pour assister à la messe. Pour Noël, ils organiseront une messe de minuit très solennelle, avec les cantiques traditionnels, suivie d'un réveillon, arrosé de bière offerte par les directeurs des usines.
Tous les soirs, ils écoutent les nouvelles à la radio, au foyer. Même Radio-Londres à condition de faire le guet. On sait donc qu'il y a un certain Général de Gaulle avec un gouvernement et une petite armée à Londres. Pour l'instant, tous sont Pétainistes bon teint. Peu à peu le doute s'installera néanmoins dans les esprits. Les Allemands piétinent devant Moscou. La guerre va durer et son issue est de plus en plus incertaine. Quelques prisonniers pensent maintenant à l'évasion, seule manière de rentrer chez soi. Dussol est de ceux-là et, comme il ne veut pas s'évader seul, il demande secrètement à Michel de l'accompagner. Celui-ci se voit déjà arrivant tout fier à la maison. D'autre part, il a été élevé par son père dans le mépris de ceux qui restent tranquillement les pieds au chaud pendant que les autres se font casser la figure. Donc il accepte. Mais une évasion, cela se prépare. À pied, en marchant la nuit ? C'est assez romantique, mais il faut avoir une boussole et une carte, et des vivres en quantité. Comment Dussol a-t-il fait comprendre à sa femme de lui envoyer une boussole dans une boîte de conserve, car les lettres sont lues par les Allemands ? Mystère. En tout cas, en février, la boussole arrive. La carte, on pourra la voler dans la voiture du directeur, (le garage est à côté du Kommando) ; mais seulement juste avant le départ. Les vivres, c'est facile. Il suffit de prélever toutes les boîtes de pâté et toutes les plaques de chocolat qu'on reçoit dans les colis. Comme on ne partira que fin mars ou début avril, on en aura une provision suffisante. Mais il faut aussi des vêtements civils. Il est permis de s'en faire envoyer dans les colis également. Dussol et Michel reçoivent donc, début mars, chacun un complet venant de France. Mais la sentinelle marque au pochoir et en rouge un magnifique K.G. sur chaque jambe de pantalon et dans le dos de chaque veste. On passera des heures à le gratter et à mettre du crayon encre dessus pour essayer de l'effacer. La chambre étant fouillée de temps en temps par le "Posten", le stock de vivres est caché sous une planche d'une marche de l'escalier qui monte au grenier. Dussol reçoit de très beaux colis du Périgord. Surtout des boîtes de foie gras. Michel reçoit des colis beaucoup plus modestes, car il n'a pas osé écrire qu'il préparait une évasion.
Depuis quelques jours, c'est Michel qui est l'homme de confiance du Kommando. Celui qui occupait cette fonction avant était le danseur de claquettes. Quelquefois, le soir au foyer, il faisait un petit numéro. En cachette bien entendu car, au travail, il se plaignait constamment des reins et poussait un cri de douleur à chaque fois qu'il soulevait un poids. En fait il ne souffrait aucunement, mais c'était un comédien remarquable et il savait qu'il avait une cicatrice à la colonne vertébrale, visible à la radio. Finalement, il avait réussi à se faire rapatrier comme malade, les médecins allemands ayant constaté quelque chose d'anormal sur la photo. Michel ne tenait pas du tout à être homme de confiance, surtout préparant une évasion, mais le sous-officier allemand le lui avait demandé sans doute parce qu'il était discipliné. Ce sous-officier était d'ailleurs assez sympathique. Michel demande leur avis à ses camarades. Ceux-ci lui conseillent d'accepter, il n'y a pas d'autres volontaires et il sait un peu parler la langue de Goethe. D'autre part, à la radio de Londres, ils apprennent que l'armée allemande subit des pertes considérables en hommes et en matériel, devant Moscou et Leningrad, à cause de l'hiver très rigoureux. La figure des "Chleuhs" commence à se renfrogner, surtout celle de Bourtchousky. Les Français sont obligés de faire des heures supplémentaires pour balayer la neige qui bloque même les trains. Le charbon n'arrive plus et l'usine s'arrête de tourner pendant trois ou quatre jours.
C'est au cours d'une de ces corvées de neige qu'a lieu un incident avec Bourtchousky. Une dizaine de Français sont en train de déblayer la neige pour permettre la libre circulation dans la cour de l'usine. Bourtchousky les regarde faire, puis se met tout à coup dans une colère terrible. Il se précipite sur l'un d'eux qui, évidemment, ne met pas une ardeur extrême au travail. Il le bouscule et le renverse dans la neige. Puis il ramasse la pelle et la brandit au-dessus du malheureux en hurlant: "Ich töte" ("Je tue"). Sur ce, il s'en va. Aussitôt après le travail, Michel va voir le sous-officier dans son bureau et lui raconte ce qui s'est passé. Il proteste au nom de ses camarades, dit qu'il est interdit de frapper les prisonniers. Michel a l'impression que son interlocuteur l'approuve. En tout cas, Bourtchousky ne se manifestera plus dans les semaines qui suivront. En Allemagne, les prisonniers de guerre sont assez souvent protégés par l'armée, car ils dépendent d'elle, et non de leur employeur, fut-il membre important du parti nazi comme c'était le cas pour Bourtchousky. Celui-ci en représailles, sans doute, fera 1installer, dès le lendemain, une petite caisse fermée à clef autour du poste de radio du foyer. Les Français auront toujours accès à la salle et aux douches mais ne pourront plus écouter les nouvelles, le soir.
On arrive au mois de mars. Il y a un troisième candidat à l'évasion. Il s'appelle Robert Crespin et est garagiste. Ils partiront donc à trois. Dans l'atelier où il travaille, Crespin peut se procurer de la forte toile. Comme on a du fil, des aiguilles et des ciseaux, pour l'entretien de l'habillement, Crespin taille et coud trois sacs à dos. C'est remarquable comme travail et ces sacs seront bien utiles pour mettre les provisions de route. Le dimanche, à la messe, on se rencontre avec les aspirants du Kommando voisin. Certains songent à s'évader aussi. Des cartes de l'Allemagne circulent et on arrive à s'en procurer un exemplaire. Deux itinéraires sont possibles. L'un, vers la Suisse, par la boucle de Schaffouse, l'autre, vers l'Alsace, en passant le Rhin à la sortie de Karlsruhe. Les ponts à l'intérieur de l'Allemagne ne sont pas gardés. Le Neckar sera traversé à Heilbronn. Rien n'est plus excitant que de préparer une évasion. Les jours passent plus vite et cela vous remonte le moral.
Le dimanche 22 mars, on apprend que la messe est supprimée. Trois aspirants du Kommando voisin ont pris la fuite, la veille au soir. Deux sont partis à pied. L'autre, appelé Vigne, a pris le train tranquillement, à la gare de Crailsheim, en compagnie d'une jeune ouvrière tchèque qui lui avait procuré d'excellents habits civils. La surveillance est évidemment renforcée, tout est fouillé par les "Posten", mais les sacs à dos et les vivres sont tellement bien cachés qu'ils ne trouvent rien de compromettant. Puis le sous-officier arrive, une note de service à la main. C'est la traduction française d'une note venant du Quartier Général allemand lui-même. Il y est dit que tout évadé repris, français ou belge, au lieu de faire les trois semaines de "Straffkompanie" (Compagnie de discipline) habituelles, sera déporté pour un temps indéterminé au camp de représailles de Rawa-Ruska, en Galicie méridionale. Chaque prisonnier doit émarger au bas de la note.
Les trois candidats à l'évasion savent très bien qu'ils n'ont que peu de chances de réussir et ce camp de Rawa-Ruska leur fait un peu peur. Michel sent son enthousiasme faiblir, mais, par amour propre, il ne le montre pas. Dussol et Crespin ne disent rien non plus. Les autres, ceux qui restent, les regardent avec un air de doute; sans le dire vraiment, plusieurs souhaitent qu'ils renoncent; de plus, ils savent que leur vie au Kommando sera beaucoup plus dure après l'évasion, réussie ou non, de leurs camarades. Mais l'attrait de la liberté est plus fort. Si on doit aller à Rawa-Ruska, tant pis. On va partir, et dès samedi prochain, entre onze heures et minuit. Un camarade qui travaille à la forge a fabriqué une pince monseigneur. Tout est donc prêt. On ne reculera pas.
DEUXIÈME PARTIE - UNE ÉVASION MANQUÉE - SÉJOUR EN UKRAINE
28 MARS 1942 - 2 NOVEMBRE 1942
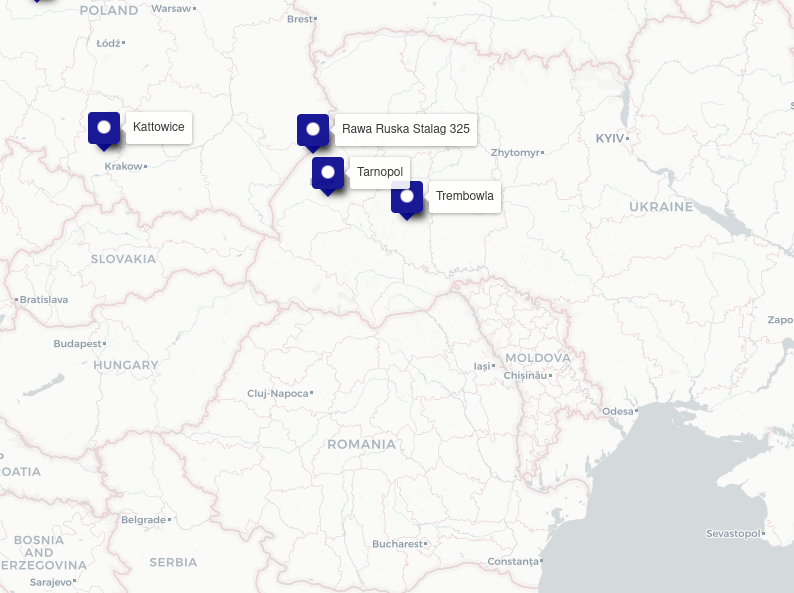
1. L’ÉVASION ET SES SUITES
Le samedi 28 mars, vers onze heures du soir, tout se passe comme prévu. Le trio se met en civil. Dussol et Michel ont trouvé une casquette au vestiaire des ouvriers. Ils ont mis double sous-vêtements. Crespin est le mieux protégé. Il a trouvé dans la belle voiture de Bourtchousky, outre la carte routière, un chapeau mou et un beau manteau, un peu trop long pour lui, mais avec l'insigne du parti nazi à la boutonnière. La pince monseigneur glissée entre le plancher et la porte est actionnée, la serrure saute. On décloue la planche de la marche de l'escalier, qui sert de garde-manger. On remplit les sacs à dos. C'est la pleine lune et elle éclaire presque comme en plein jour. Ce que Michel craint le plus, c'est d'être repris en sortant du Kommando, ou de l'usine. Il serait la risée des Allemands et même des Français. Bourtchousky n'est pas couché, on voit son ombre qui se promène à travers les fenêtres éclairées. Pourvu qu'il ne jette pas un coup d'oeil dans la cour. S'il l'avait fait, il aurait vu trois ombres avec de gros sacs sur le dos, se diriger en rasant les murs vers la voie ferrée qui longe l'usine derrière les bâtiments. Il y a là une brêche dans la clôture. Tout va très bien, pas de rencontre. On est tout de suite à la sortie de Crailsheim, sur la grand route qui va vers l'ouest. Même sans boussole, il est facile de se diriger, on voit parfaitement l'étoile polaire. On croise une seule personne : c'est un officier. Il n'est pas possible qu'il n'ait pas de soupçons. Les évadés ont leur première émotion. Il passe à un mètre d'eux. Michel est persuadé qu'il a compris de quoi il s'agissait; mais en tout cas, il ne dit rien. Maintenant, la route est absolument déserte, ils marchent d'un bon pas vers la France. C'est beau la liberté.
Avant le lever du soleil, ils quittent la route goudronnée et trouvent facilement un bois de jeunes pins assez touffus. Ils peuvent faire une halte, manger et se reposer toute la journée. Le voyage continuera ainsi pendant cing jours ou plutôt cinq nuits. Le temps reste très beau. La seule difficulté est la traversée des villages. Quand on passe dans la rue centrale, tous les chiens du pays se mettent à aboyer. Plusieurs les ont même poursuivis, et une fois, ils n'ont dû leur salut qu'à une fuite éperdue à travers champs. D'après la carte routière, on arrive près de Heilbronn. Là, il faut quitter la route. On monte les pentes boisées qui bordent la vallée du Neckar. En haut, on voit la rivière qui ressemble sous la lune à un large ruban argenté serpentant à travers la vallée. On a laissé la ville au nord et on peut voir, en bas, un gros village avec un pont. C'est là qu'on passera le Neckar, sans aucune difficulté. Celles-ci vont venir les jours suivants. Le temps change, le soleil et la lune sont cachés par les nuages. Il fait froid, et surtout il tombe, presque sans arrêt, une sorte de neige fondue. Quand les trois évadés arrivent à l'étape le matin, ils ouvrent une boîte de conserve, mangent une barre de chocolat avec des biscuits, boivent l'eau du bidon qu'on remplit dans un ruisseau et se couchent aussitôt. Ils s'endorment à cause de la fatigue. Mais une heure ou deux après, le froid et l'humidité les réveillent. Ils se serrent les uns contre les autres pour essayer de se réchauffer en se couvrant avec un vague ciré qu'a emporté Dussol, mais en général, le reste de la journée se passe à claquer des dents. Enfin, ils arrivent à deux ou trois kilomètres de Karlsruhe.
La neige s'est arrêtée, il fait un peu meilleur. Cela fait treize nuits qu'ils marchent. Leurs vêtements sont fripés et leur souliers sales. Comme il va falloir traverser la ville, la journée va se passer en partie à essayer de brosser les habits, cirer les souliers, se raser, etc... Comme vivres, ils ne gardent que quelques biscuits et quelques barres de chocolat. Dès que l'obscurité arrive, ils rejoignent la route et "attaquent" la ville. A cette heure, il y a beaucoup de monde dans les rues. Celles-ci ne sont pas très éclairées et ils ont peu de chances de se faire remarquer. Crespin, avec son chapeau mou et son beau manteau marche devant, les deux autres sont derrière. Ils ne savaient pas que Karlsruhe était une ville très étendue, avec des faubourgs industriels immenses. Il est minuit maintenant. C'est la sortie des cinémas. À un croisement, Dussol et Michel perdent de vue Crespin qui a pris de l'avance. Ils prennent sans doute la mauvaise direction et ne le retrouveront pas. Seuls, maintenant,après avoir erré deux ou trois heures, ils trouvent un endroit pour s'étendre, dans un terrain vague, non loin d'une énorme usine dont on entend le bruit sourd des machines. Le jour arrive. Ils reviennent un peu sur leurs pas, voient une flèche "Rhein Brücke" ("Pont sur le Rhin"), on est dans la bonne direction. Oui, mais maintenant, les trottoirs sont remplis des ouvriers qui vont à leur travail. Ils vont tous dans la même direction, c'est-à-dire tournant le dos au pont. Michel voit un gendarme en train de se raser dans ce qui est probablement un commissariat de police, la glace accrochée à la crémone de la fenêtre. Il voit que le gendarme les a repérés et se prépare à sortir en vitesse. "On est pris, essaye de filer". Le gendarme sort en effet en trombe, en bouclant son ceinturon, traverse la rue et dit à Michel : "Papier bitte" ("Papiers s'il vous plaît"). Michel fait semblant de chercher dans son porte-feuille. Comme il a un nom italien, il dit : "Italienische arbeiter” ("Travailleur italien"). Mais il a quelque chose de gros sous sa veste. C'est une trousse dans laquelle il y a quelques biscuits et ses affaires de toilettes. Évidemment cela semble louche au gendarme qui sort son révolver et le secoue en l'attrapant par le collet. Alors Michel dit : "Ich bin ein franzosishe krieg gefangen" ("Je suis un prisonnier de guerre français"). Là dessus le gendarme se calme un peu et dit : "Wo ist der kamerad ?" - "Ich weiss nicht" ("Où est le camarade ?" - "Je ne sais pas"). Le gendarme le fait traverser la rue en vitesse et l'enferme au violon, c'est ainsi qu'on appelle un endroit grillagé et assez exigu. Puis il sort en courant vers le pont. Une demi-heure après environ, il revient avec Dussol qu'il enferme à son tour. Et c'est ainsi que l'évasion s'est terminée. Ce qu'ils ne pouvaient pas savoir c'est que le pont était gardé, uniquement parce que le Général Giraud s'était évadé de sa forteresse de Prusse Orientale, deux jours auparavant. Mais lui, il réussira son évasion.
2. KARLSRUHE - OFFENBOURG - LUDWIGSBOURG
Dussol est ulcéré. Michel simplement résigné et éreinté. Il est vrai que c'est Dussol qui avait monté toute l'opération. Il voulait retrouver sa femme, son pays, ses occupations. Michel, célibataire, beaucoup plus jeune, s'était seulement lancé par romantisme et goût de l'aventure. Pourquoi avons-nous tourné à gauche et perdu Crespin qui est peut-être en Alsace à l'heure actuelle ? Michel le souhaite de tout cœur. Comme il grelotte toujours, il demande aux gendarmes un peu de café ersatz qui chauffe sur le poêle. Ceux-ci lui montrent sans rien dire le robinet d'eau froide au-dessus de l'évier. Là-dessus, arrive un autre grand "shupo" (gendarme) qui les fait sortir dans la rue. Ils montent dans un tramway, roulent pendant assez longtemps et arrivent devant un grand bâtiment en briques rouges très majestueux : c'est le Palais de Justice de Karlsruhe. Là, ils passent dans plusieurs bureaux où on leur demande tous les renseignements possibles, non seulement sur eux-mêmes et leur vie depuis leur naissance mais sur leurs parents et jusqu'au nom de famille de leur mère. Sans doute est-ce pour s'assurer qu'ils ne sont pas des espions. Puis, on les met sous clef dans un local sans fenêtre et toujours sans nourriture. Ils mangeront les quelques biscuits qui leur restent, boiront un peu d'eau du robinet et passeront la nuit là. Le matin de très bonne heure, c'est un soldat qui vient les chercher. Cette fois-ci, on va à la gare. La salle des pas perdus est remplie de monde, surtout de soldats attendant leur train. Quatre ou cinq de ceux-ci sont en train de casser la croûte, assis sur leur sac en buvant du café chaud. Michel, qui n'arrive pas à se réchauffer, dit à l'un d'eux qui était à côté de lui : "Ein bisschen warmer kaffee, bitte ?" ("Un peu de café, s'il vous plaît ?"). Sans rien dire celui-ci lui tend son quart plein de café bien chaud ... Ils prennent le train. Quelques autres Français, prisonniers repris comme eux, sont dans le même compartiment. Ils roulent pendant quelques heures et débarquent à la gare d'une assez grande ville : Offenbourg. Là se trouve le Stalag V A. Ils vont y passer cinq ou six jours. Leurs vêtements civils et leurs bons souliers seront confisqués. On leur donnera à la place des vieux uniformes français de la guerre de 14-18 et des claquettes à semelle de bois. Tous ces prisonniers repris sont centralisés dans une baraque à part. Heureusement, il fait beau. On voit des montagnes dans le lointain; ce sont les Vosges paraît-il. La soupe est chaude et consistante. Les cuisiniers français du camp soignent de leur mieux ces compatriotes malheureux. Michel s’assoit au soleil le long de la baraque. Le froid qu'il avait jusqu'à la moelle des os le quitte peu à peu. L'homme de confiance vient les voir et leur apporte du papier à lettre pour qu'ils puissent écrire à leur famille. Il leur dit qu'ils vont être en effet déportés à Rawa-Ruska. Le point de départ n'est pas Offenburg mais Ludwigsburg où ils arriveront vers le 16 avril. Là, finies les bonnes soupes et les rations supplémentaires de pain.
Les prisonniers évadés et repris arrivent par fournées de vingt ou trente par jour et sont entassés dans un terrain grand comme deux tennis environ, et qu'on appelle la "fosse aux lions" car il est entouré d'un mur de plus de trois mètres de haut. La première personne que Dussol et Michel rencontrent à l'arrivée n'est autre que le pauvre Crespin qui raconte ses aventures. Il a bien passé le Rhin sur le fameux pont, en pleine nuit, et a fait “Heil Hitler" quand il a croisé la sentinelle. Ensuite, il a marché sans arrêt toute la journée suivante, a pu traverser, sans encombre, l'ancienne ligne Siegfried et est arrivé en Alsace la nuit, les pieds en sang, épuisé de fatigue. Le presbytère du premier village rencontré étant fermé, il frappe à la porte d'une ferme. Le paysan le fait monter dans son grenier à foin. "Quand j'ai vu, dit Crespin, qu'il ne me donnait ni à manger, ni à boire, j'ai compris que j'étais perdu mais j'étais à bout de force, je me suis endormi immédiatement et le lendemain, j'ai été réveillé par les coups de revolver des gendarmes venus me chercher. Il ne resteront dans la fosse aux lions que cinq ou six jours, heureusement. Cela devenait intenable. Quand les cuisiniers allemands apportaient l'unique soupe de la journée, ils étaient obligés de rentrer à coups de bottes et de crosses dans la meute des prisonniers affamés qui les assaillaient de tous côtés.
A Offenburg, Michel avait pu trouver une boîte de conserve vide de un litre qui lui servait de gamelle et s'était fabriqué, avec un couteau prêté, une cuillère en bois. Quelques prisonniers dévoués essayaient et réussissaient le plus souvent à mettre de l'ordre et à veiller à ce que chacun ait sa ration de soupe et son morceau de pain.
Le 23 avril, ils sont maintenant plus de mille dans la fosse et on les fait sortir pour faire de la place à d'autres. Il faut croire qu'ils sont dangereux, car une centaine de soldats casqués et armés entourent la porte de sortie, plus une mitrailleuse en batterie et quelques chiens tenus en laisse. Ils ne vont pas à la gare tout de suite. Ils vont rester parqués encore deux jours dans de grandes écuries à la sortie du camp, où il y a suffisamment de place pour s'étendre sur le béton.
Le 26 avril, ils reçoivent chacun une boule de pain et une boîte de conserve, et en route pour la gare. Il faut traverser la ville. Les civils regardent avec un étonnement attristé cette troupe de prisonniers aux uniformes hétéroclites et chaussés de claquettes en bois. Le train est en gare. Une partie du convoi est déjà chargée de son contingent de prisonniers venant du nord de l'Allemagne. Ils vont s'entasser à soixante dans chacun des wagons restants. En plus des vigies armées, il y a des mitrailleuses sur plateforme et un wagon de voyageurs pour le capitaine commandant le convoi et l'escorte. Le voyage durera cinq jours. Il est probable qu'ils ont traversé Crailsheim de nuit, Nuremberg, Chemnitz; Michel se souvient de Dresde, Breslau, Kattowice.
Il regarde par la fenêtre grillagée au passage de l'ancienne frontière entre l'Allemagne et la Pologne et est frappé de la différence de richesse entre les deux pays. Du côté allemand, de belles maisons bien propres, des routes goudronnées etc... et comme si c'était coupé au couteau; du côté polonais, de mauvais chemins en terre battue et des maisons misérables couvertes de toits de chaume. Il y a une halte avec appel, fouille et ravitaillement tous les deux jours.
C'est dans ces régions que deux prisonniers d'un wagon voisin étant arrivés à creuser un trou au couteau dans la paroi avaient pris le large. Le wagon étant inutilisable il fallait répartir les occupants dans les deux wagons voisins. Maintenant, on est quatre-vingt dix dans un wagon fait pour quarante. La moitié peut s'étendre, serrée comme des sardines dans une boîte, pendant que l'autre moitié est debout. Une partie de ces évadés est ce qu'on appelle des fortes têtes et ont des caractères difficiles. Quelquefois des disputes éclatent, ce qui n'arrange pas les choses. Vu l'entassement, il est à peu près impossible de faire ses besoins. Les distributions de soupe ou même d'eau sont très rares. Après Cracovie, le train traverse une région un peu montagneuse. Il y a de la neige dehors et sur les sommets dans le lointain : ce sont les Karpates. Michel aperçoit même des enfants misérables qui, les pieds nus dans la neige, leur demandent du pain. Évidemment cette voie est fréquentée par les troupes qui montent au front et qui font l'aumône de quelques morceaux de pain aux gosses affamés de la région. Peu à peu le pays devient plus plat et le 1er mai dans l'après-midi le train s'arrête pour de bon.
3. RAWA-RUSKA
On entend les ordres hurlés, comme d'habitude. Les portes sont déclouées et tout le monde sort des wagons. Beaucoup sont ankylosés et n'ont pas la force de tenir sur leurs jambes. Il fait beau, mais avec un vent froid qui vous transperce. Pendant le voyage, ils ne sentaient pas ce froid, grâce à l'entassement. Bien encadrés et bien en ordre, ils traversent la ville qui paraît assez misérable : petites maisons basses couvertes souvent de tôles de zinc, rues pleines de fondrières et pour ainsi dire pas d'habitants visibles. Enfin, voilà le camp, très grand à première vue. Double rangée de barbelés, miradors équipés de projecteurs. L'entrée ressemble au quartier où Michel a fait son service à Périgueux : une grille avec un bâtiment en briques de chaque côté. Au-dessus de la porte, au lieu de "Quartier Daumesnil", on lit "Front Stalag 325". Deux cents mètres plus loin, des grands bâtiments en brique, à deux étages, tous pareils. Deux sur les quatre sont inachevés. Un grand espace libre derrière encore et ce sont les écuries, très vastes, en bois sur soubassements bétonnés.

Un premier convoi de prisonniers repris est déjà là depuis trois semaines. Il y a donc un homme de confiance et cet homme de confiance qui les accueille si aimablement, Dussol, Crespin et Michel n'en croient pas leurs yeux, c'est ... l'aspirant Vigne, celui qui avait pris le train à Crailsheim en compagnie d'une ouvrière tchèque et avec de faux papiers. Pour l'instant, Vigne est trop occupé pour qu'on puisse lui parler. Il répartit les nouveaux arrivants dans les différents "blocs" et indique où se trouve, à côté des cuisines, le seul et unique robinet d'eau. Un trait de son petit discours d'accueil touche particulièrement l'auditoire : "Un demi wagon de la Croix Rouge française est arrivé ce matin à Rawa-Ruska, mais j'ai attendu pour le faire distribuer que vous soyez arrivés". C'est ainsi que, le soir, chacun peut toucher une vingtaine de biscuits "Pétain" et quelques barres de chocolat.
Peu après, les trois du kommando de Crailsheim retrouvent Vigne et lui demandent ce qui lui est arrivé. "Tout a bien marché jusqu'à Cologne, dit-il; là, entre deux trains nous avons été abordés par un inspecteur en civil qui a vite compris que nos papiers étaient faux". Et Vigne ajoute : "Quand nous sommes arrivés ici, il y a trois semaines, il faisait froid, humide et tout était dans un état de saleté épouvantable. Il y avait, avant nous, des prisonniers russes dans ce camp (qui est un ancien Quartier de Cavalerie polonais). Nous avons même retrouvé des cadavres abandonnés de ces malheureux qui étaient plus maltraités que nous. Il n'y avait rien de prévu pour la nourriture et nous avons beaucoup souffert. Maintenant, cela va un petit peu mieux mais il n'y a qu'un robinet d'eau pour près de cinq mille hommes. Comme il n'y a pas de pommes de terre, on nous donne, pour faire la soupe, de la choucroute avariée, du millet et un peu ... de tapioca ersatz tiré du pin. Vous allez recevoir du papier à lettre et des étiquettes colis, mais vu l'éloignement, il faut compter deux mois avant qu'ils n'arrivent. Le commandant allemand du camp s'appelle le "Hauptmann" (Capitaine) Fournier, c'est un descendant de huguenots français et il sait parfaitement la langue de ses ancêtres. Au début, il a essayé de nous faire faire la "pelote". Mais comment faire courir au pas de gymnastique, dans la boue, des hommes très faibles, chaussés de claquettes en bois ?". En fait, le camp de Rawa-Ruska, c'est la saleté ajoutée à la famine, mais il n'y a pas de mauvais traitements particuliers en dehors des appels très longs et des "Posten" avec leurs chiens qui courent et quelquefois brutalisent les retardataires.
Dès le lendemain de leur arrivée, Crespin tombe malade et est admis à l'infirmerie située dans un des deux bâtiments, à l'entrée du camp. Dussol et Michel vont le voir et pour cela il faut tout traverser, car eux sont installés dans les grandes écuries, à l'opposé. Il a une broncho-pneumonie avec beaucoup de fièvre. Les malades sont très nombreux. Il y a quatre ou cinq médecins français. La plupart ont été envoyés là uniquement parce qu'ils sont Juifs. Mais il n'y a pas de médicaments, pour l'instant : ils vont arriver par la Croix Rouge. Crespin sera encore à l'infirmerie quand Michel quittera le camp, mais il guérira et viendra lui rendre visite en Périgord, sept ans plus tard. Tous les Français morts de maladie ou tués pour tentative d'évasion sont enterrés dans un petit cimetière à l'orée de la forêt de pins, à quelques centaines de mètres du camp. A chaque fois, paraît-il, le capitaine Fournier accompagne le corps avec quelques-uns de ses soldats qui rendent les honneurs.
Maintenant, le printemps arrive. Entre les appels, les prisonniers se mettent au soleil, se déshabillent, et tuent leurs poux entre leurs ongles. Mais c'est impossible de les tuer tous, et puis il y a les œufs, par centaines, dans les doublures, ensuite on va en ramasser d'autres laissés par les Russes, dans la paille. La soupe est la principale préoccupation et même le principal sujet de conversation. On s'aperçoit vite qu'il y a des prisonniers qui "resquillent", s'arrangeant pour passer deux fois à la distribution. La nuit, il faut dormir la tête sur son morceau de pain si on veut être sûr de le retrouver le lendemain. Il y a en effet, mélangés aux évadés normaux, une minorité de condamnés de droit commun que les Allemands ont envoyés là pour s'en débarrasser. Les responsables de "bloc" ou de baraque demandent aux prisonniers de se rassembler par groupes de même terroir. Les Périgourdins, les Charentais, les Vendéens, les Bretons, les Parisiens, etc... Des écussons aux armes de leurs provinces sont peints au crayon encre sur les morceaux de toile et cousus sur l'uniforme. On a une chance de repérer ainsi les brebis galeuses. Et celles-ci, ainsi séparées, se mettront dans des groupes entre elles.
Il faudrait aussi essayer qu'il n'y ait pas de coulage aux cuisines. Que les médecins et les malades aient une ration spéciale d'accord. Mais il ne faudrait pas que cela s'étende aux bureaucrates, aux postiers et aux copains des cuisiniers. Vers le 15 mai, un autre convoi de deux mille hommes arrive; on est maintenant plus de six mille à Rawa-Ruska. Vigne, fatigué, va abandonner sa fonction d'homme de confiance. Il va être remplacé par un homme plus âgé nommé Mercier, avocat dans le civil, à la voix de stentor, ce qui est bien utile.
Vers le 20 mai, on entend un grand remue-ménage dans une écurie située près des barbelés : "Posten" en colère, prisonniers fuyant dans tous les sens. Les "Feldwebels" (Adjudants) puis le "Hauptmann" en personne arrivent. Un début de souterrain a été découvert ! Aussitôt, appel avec concert de hurlements. Des mineurs du nord de la France étaient déjà sous les barbelés; quelques jours encore et çà y était ! Comment pouvaient-ils, avec des vieux bouts de ferraille et des boîtes de conserve comme outils, creuser et évacuer la terre, étayer et aérer leur boyau sur des dizaines de mètres ? En tout cas, depuis ce jour, les appels sont encore plus longs et minutieux, pendant que les soldats et les chiens fouillent un peu partout. Le Hauptmann Fournier l'a dit lui-même : l'ingéniosité des Français est extraordinaire. Il avait bien raison. D'autres souterrains seront construits par la suite à Rawa-Ruska, comme dans presque tous les camps de Pologne et d'ailleurs.
Dans le groupe des Périgourdins, il y a deux instituteurs qui se lient avec Dussol. Ils se connaissaient déjà avant la guerre. Crespin malade, Dussol accaparé par d'autres, Michel va se trouver seul, ce qui est presque impossible. Heureusement, il fait la connaissance d'un autre isolé nommé d'Halluin. Ils sont du même âge, sinon du même pays car d'Halluin est du nord. Ils passent le temps en faisant un peu d'allemand dans un assimil que d'Halluin a sauvé.
Vers le 5 juin, on apprend qu'un kommando va être formé pour aller travailler à l'extérieur. On demande mille volontaires. D'Halluin et Michel sont d'avis de quitter ce camp surpeuplé, car les arrivages continuent. Un homme, remarquable de dévouement, va prendre le commandement de ces mille volontaires; c'est un Dominicain d'une trentaine d'année : le Père Robert. Il fait comprendre à ses hommes qu'il faut absolument que tout soit prévu à l'avance de manière qu'il n'y ait pas de pagaille quand ils arriveront dans leur nouveau camp. Il choisit lui-même les futurs cuisiniers et prévient que chacun touchera intégralement sa ration. Plus tard, il demandera à une dizaine de costauds, experts en boxe ou en judo, de former un petit corps de policiers. Ces hommes, avec l'assentiment des Allemands, auront un brassard blanc avec un "P" inscrit au crayon encre. Tout voleur ou resquilleur, pris sur le fait, sera marqué au visage à coups de poing pour lui ôter l'envie de recommencer et pour que tout le monde le reconnaisse.
4. TREMBOWLA
Le 6 juin, les mille hommes embarquent en gare de Rawa-Ruska; cinquante à soixante par wagon. Peu de provisions au départ. Ils ne vont pas loin, paraît-il. Départ le soir. Dans la nuit, ils arrivent à une grande gare : Lemberg, Lvov en polonais. Ils vont y rester une vingtaine d'heures, enfermés dans leur wagon, sans rouler. Les nombreux trains de troupes et de matériels qui descendent vers l'offensive de Crimée ont priorité. Ils reçoivent, néanmoins, un bon morceau de pain et une boîte de pâté par personne.
Le 7 juin, le train roule toute la journée et s'arrête le 8 au matin dans une gare : "Trembowla". Ils ne le savent pas, mais ils sont en fait à cinq cent kilomètres d'Odessa, sur la mer Noire. Ils débarquent en espérant trouver de l'eau pour boire et se laver. Michel est dévoré par la faim, comme tout le monde, mais se porte bien et fait, sans problème, les trois ou quatre kilomètres jusqu'au nouveau camp. Le pays semble plus riche que Rawa-Ruska. La campagne mieux travaillée. Ils voient même des champs de maïs. Il est vrai qu'on a roulé vers le Sud. Mais ils ne voient aucun habitant dans les rues de la petite ville. Le camp est situé à flanc de coteau, tout près de celle-ci. Malgré les barbelés et miradors habituels, il paraît plus hospitalier que Rawa-Ruska. D'abord, il est beaucoup plus petit. On aura de l'eau à volonté. Elle coule dans la cour dans un grand baquet en ciment. L'organisation prévue par le Père Robert se met en place aussitôt et, le soir, ils auront une soupe plus consistante que celle de Rawa-Ruska. L'appel du soir est moins long, mais néanmoins très strict et très militaire. Les mille, divisés en compagnies de cent, se mettent au garde à vous sur un commandement du Père Robert, à l'arrivée du capitaine allemand commandant le camp. Celui-ci fait dire naturellement que tout prisonnier cherchant à s'évader sera abattu sans sommation. Mais déjà, les creuseurs professionnels de souterrain étudient la topographie des lieux et commencent, dans le plus grand secret, à se mettre au travail.
Les deux ou trois premières semaines à Trembowla se passent à peu près dans l'inaction, en dehors des corvées habituelles. On se lave, on s'épouille et on pense aux lettres et aux colis de France qui ne devraient pas tarder à arriver.
Le 7 juillet, un wagon de la Croix Rouge arrive. Chaque homme reçoit quarante-huit biscuits, cent grammes de chocolat et un peu de confiture : c'est la joie dans le camp.
Le jour suivant, un peu pour se distraire, un peu dans l'espoir de trouver un peu de nourriture, Michel est volontaire pour faire partie d'une corvée de cent hommes qui doit partir travailler dans les environs, le lendemain.
Le 9 juillet de bonne heure, les cent hommes sortent du camp bien encadrés par des soldats casqués et armés. Trois sous-officiers très costauds marchent devant. On traverse le village désert. Il est vrai qu'il est de bonne heure. Il fait un temps magnifique. À la sortie du village, il y a le long de la route deux grandes caisses très solides contenant des outils. Chaque prisonnier doit prendre une pioche ou une masse assez lourde. Michel préfère prendre une pioche. Ils marchent encore cinq cents mètres environ et arrivent au cimetière du pays. Celui-ci est entouré de murs; trois vieilles femmes habillées de noir avec des fichus sur la tête sont devant la porte. Elles semblent supplier les sous-officiers. Ceux-ci les écartent brutalement. La colonne entre dans le cimetière qui semble très vaste, très bien entretenu, avec quelques arbres. Les tombes sont toutes identiques : il y a une belle dalle en granit rose horizontale de un mètre sur deux, et une autre verticale exactement de même forme. Sur chaque dalle, une étoile de David est gravée, avec le nom du défunt et la date de sa mort, ceci en polonais ou en allemand. On doit parler les deux langues dans ce pays qui a peut-être été autrichien autrefois. Les prisonniers commencent à comprendre le genre de travail qu'on leur demande. C'est un cimetière juif. S'il n'y a pas d'habitants dans ce bourg, c'est qu'ils ont été déportés. Mais où ?
Ils ne comprendront la vérité exacte que quelques années plus tard. Pour l'instant, ils se regardent, personne n'ose donner le premier coup de masse. Mais les soldats remuent leurs armes en criant des ordres; l'un des Français se décide et les autres vont suivre. Maintenant qu'ils ont commencé, les prisonniers travaillent avec rage. Est-ce pour libérer leur colère ou bien y trouvent-ils un plaisir sacrilège ? Il fait très chaud. Ils se mettent torse nu et c'est un spectacle bizarre de voir ces cent forçats en sueur fracasser un cimetière, injuriés quelquefois par les soldats qui crient : "Los, arbeit, Menschen” ("Grouillez-vous, travaillez, les hommes") quand la cadence se ralentit. Ils travaillent huit ou neuf heures dans ce lieu pourtant consacré au repos éternel, avec une pause à midi où ils mangent, sur place, le morceau de pain emporté le matin. La plupart ne boiront pas, les bidons sont très rares. L'après-midi, les coups de masse sont beaucoup plus mous et espacés, le travail se ralentit de lui-même.
Vers 17 heures, les sous-officiers donnent le signal du retour au camp. Michel pense : "Si j'avais su, je ne me serais pas inscrit à cette corvée. Je n'y gagne rien. Rien à chaparder et pas un civil compatissant qui vous donne quelque chose". Si, justement, il voit en traversant le village une vieille femme sortir de chez elle, avec plusieurs morceaux de pain dans son panier à quelques mètres de lui. A la vue du pain, dix, vingt prisonniers se sont précipités, se battent, s'arrachent les morceaux. La vieille femme est renversée, piétinée. Qu'est-il advenu d'elle ? Michel n'en sait rien car les "Posten" se mettent à crier et à donner des coups de crosse pour remettre de l'ordre.
Il travaillera juste une semaine au cimetière. Les volontaires du premier jour sont forcés d'y retourner, personne d'autre ne voulant prendre leur place. Le Père Robert a écrit une lettre à la Croix Rouge Internationale protestant contre le genre de travail imposé et disant que les prisonniers français ne voulaient pas profaner des tombes, fussent-elles israélites. Il est peu probable que le capitaine allemand ait fait suivre la lettre. Mais, peu après, le Père Robert est envoyé dans un autre camp, on ne le reverra plus à Trembowla. Il reviendra en France cependant, sain et sauf, à la fin de la guerre. Un autre homme de confiance est nommé, il s'appelle Carpentier. Est-ce à la suite de la protestation du Père Robert, mais les français ne démoliront plus les tombes, ils seront employés à empierrer une route avec les morceaux de granit rose venant du cimetière. C'est une main-d’œuvre polonaise venue d'ailleurs qui termine le travail et qui transporte les blocs de pierre avec leurs petites voitures tirées par des chevaux. La chaleur est toujours très forte, et soit par faiblesse, soit autre chose, Michel se sent tourner de l’œil sur la route où il travaille en plein soleil. La sentinelle lui donne la permission de se reposer à l'ombre.
Le lendemain, il va à la visite. A l'infirmerie, il y a deux médecins français très dévoués. Le capitaine Bader, probablement israélite, et un jeune qui devait être dans un régiment colonial, d'après son uniforme. C'est ce jeune qui l'examine. Rien qu'à voir le torse efflanqué de Michel avec le cœur qu'on voit battre sous la peau, ce médecin bienveillant a compris. Il dit péremptoirement "tachycardie". Le jeune médecin allemand qui le double hésite un peu puis dit : "Richtig" ("Exact"). Il signe un papier et Michel est "leicht Arbeit" ("Travail léger"). Autrement dit, menus travaux et nettoyages à l'intérieur du camp. Quelle chance d'être débarrassé de ces corvées épuisantes à l'extérieur. Comme travail il aura deux heures de balayage par jour. Le reste du temps, il somnole sur sa paillasse entre les appels, ou il bouquine, car quelques livres en mauvais état circulent. La fonction de policier de d'Halluin est une sinécure. Après l'appel du soir qui, comme celui du matin, dure toujours une bonne heure, ils vont rendre visite, à l'infirmerie, à un camarade de régiment de d'Halluin. Il s'appelle Hubert de Galery et habite la Normandie. Gravement atteint de tuberculose, il crache le sang. Il n'a pas faim, peut avaler sa soupe mais pas son pain. Comme Michel, affamé, regarde le morceau avec envie, Galery lui dit : "Prends-le si tu veux". Michel avait conscience, et il en avait honte, que s'il allait voir Galery le soir, ce n'était pas tant pour lui que pour son morceau de pain.
5. AOÛT 1942 - SEPTEMBRE 1942
Le sous-officier allemand responsable du bloc leur dit que la Wehrmacht a pris Sébastopol et fonce sur Bakou et les puits de pétrole. L'humeur des gardiens est donc excellente. Ils laissent les Français faire leur petite cuisine avec les nouilles et les haricots reçus dans les colis qui arrivent maintenant. Les tentatives d'évasion continuent. Un prisonnier est abattu sur place alors qu'il avait plongé dans un champ de blé, au cours d'une corvée le long d'une route. Et pourtant, se voyant pris, il avait levé les bras. D'autre part, les creuseurs de souterrain ont fini leur travail. A la tombée de la nuit, trois réussissent à sortir sans être vus. Mais quand les cinq suivants tentent leur chance, ils sont pris dans le faisceau du projecteur et la mitrailleuse du mirador les abat. On les entendra appeler pendant plusieurs heures avant qu'ils ne soient relevés. Deux sont morts; les trois autres transportés à l'infirmerie pourront s'en sortir. Comme à Rawa-Ruska, les corps des Français tués sont transportés par leurs camarades dans un petit cimetière à côté du camp. Il y a une petite cérémonie assez digne, l'officier allemand disant comme toujours : "Befehl ist Befehl" ("Les ordres sont les ordres"). Comme la soupe journalière est toujours aussi pauvre, pas une seule pomme de terre, le capitaine pousse la correction jusqu'à faire afficher chaque jour la quantité totale des denrées qui la compose, avec le pourcentage de calories que cela représente pour chaque prisonnier. Cela fait environ 1500 calories par personne.
Mais les colis arrivent de plus en plus, et, comme on travaille de moins en moins, la situation s'améliore. Le bruit circule qu'on va déménager. Les malades sont d'abord évacués, probablement pour être rapatriés. H. de Galery est parmi eux. Ensuite tous ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas travailler. Ceux-là sont dirigés vers le camp de Kobiercyn, près de Cracovie. Michel se sent remis d'aplomb et d'Halluin est en pleine forme; ils se déclarent bons pour le travail. Enfin, le reste du camp est embarqué à la gare de Trembowla le 26 septembre au matin, après une fouille sévère. Le soir même, le train s'arrête à Tarnopol où ils débarquent.
6. TARNOPOL ET RETOUR EN ALLEMAGNE
Tarnopol est une petite ville qui a souffert de la guerre quand les Allemands ont attaqué les Russes, il y a quinze mois. Le camp n'est pas loin de la gare. C'est en fait une ancienne caserne entourée de murs assez hauts. Un bâtiment est réservé aux nouveaux arrivants. Il y a quelques Français dans les autres. La soupe est moins consistante qu'à Trembowla. Par contre, on peut manger du rat. Tous les jours, des débrouillards circulent le long des travées, présentent sur une planchette un gros rat déjà écorché et vidé en disant : "À échanger contre deux barres de chocolat ou un paquet de cigarettes". Et ils ne manquent pas d'acquéreurs.
Les nouveaux arrivés de Trembowla doivent tous les jours fournir une corvée de cent hommes à la gare de marchandises. Celle-ci a été bombardée. Il y a des rails et des traverses enchevêtrées. Michel ne travaillera qu'une journée sur ce chantier, mais cette journée est la plus dure de celles qu'il a connues depuis qu'il est en captivité. Il s'agit de transporter à dos d'homme des traverses de chemin de fer sur cinquante mètres environ, mais sur un terrain rempli d'entonnoirs, rendu boueux et glissant par le crachin à moitié gelé qui tombe. Ces traverses sont très lourdes. Pour les plus forts, c'est déjà un travail très pénible; pour les plus faibles, c'est un vrai calvaire. On se met à deux par traverse. Chacun prend son bout, et hop, avec ensemble, sur l'épaule. Michel essaie de choisir les plus petites, mais ces traverses en bois traité sont toutes à peu près pareilles et très longues, comme l'exige l'écartement des voies russes. Il essaie de resquiller et de se cacher dans la file sans rien porter mais, impossible, il y a une quantité de "Posten" agressifs qui n'hésitent pas à frapper à coups de crosse les récalcitrants. Une fois, comme il passe, à moitié écrasé sous le poids, croisant des camarades qui reviennent à vide, il entend un de ceux-là dire : "Ils nous font jouer les Jésus-Christ, les salauds...". Et, toutes proportions gardées, il y a du vrai. Heureusement, il ne retournera plus à ce chantier de la gare.
26 octobre 1942
On fait savoir aux prisonniers que, leur punition étant terminée, ils vont revenir en Allemagne et travailler avec la population allemande comme avant leur évasion.
28 octobre 1942
Embarquement dans l'après midi à la gare de Tarnopol. Cinquante trois seulement par wagon.
29 - 30 - 31 octobre 1942
Voyage coupé d'arrêts assez longs. Passage à Lemberg, Cracovie, Posen, Schneidemuhl.
1er novembre 1942
Arrivée et débarquement à Hammerstein, petite ville de Poméranie Orientale. Installation au Stalag II B.

TROISIÈME PARTIE - LA POMÉRANIE ORIENTALE, AGRICOLE ET FERROVIAIRE
2 NOVEMBRE 1942 - 26 FÉVRIER 1945
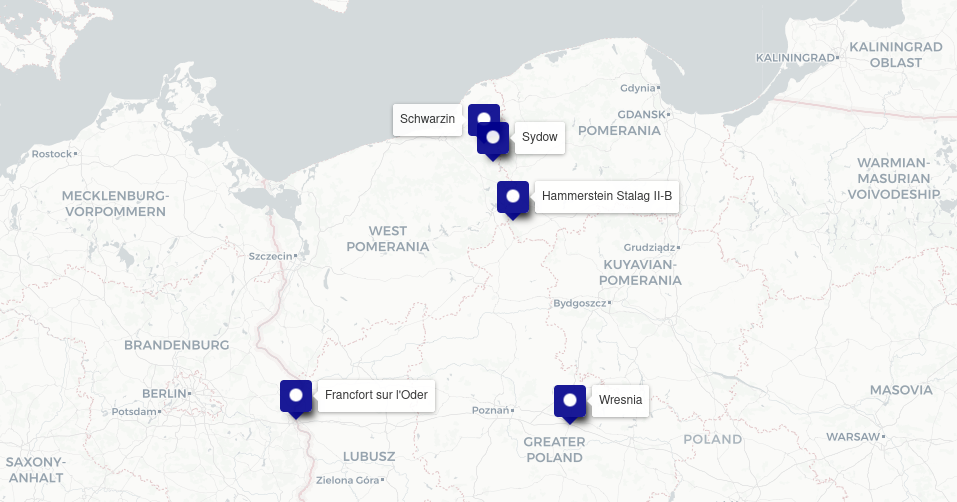
1. HAMMERSTEIN ET SCHWARZIN - UN KOMMANDO DE REDRESSEMENT - LE "CHEF" BOLT
Le 2 novembre 1942, le camp de Hammerstein (Stalag II B) paraît triste sous la neige. La veille au soir, les mille hommes venant d'Ukraine ont été installés provisoirement dans une sorte de quarantaine bien gardée avec interdiction de communiquer avec les prisonniers du camp.
À cela deux raisons :
1) Ils sont couverts de poux et les poux transmettent le typhus.
2) Ils pourraient également transmettre le virus de l'"évasionite".
Aussi, vont-ils passer d'abord à la désinfection. Cela se passe dans un bâtiment spécial, par fournées de cent. Les hommes accrochent tous leurs vêtements, linge et affaires personnelles à un patère numéroté qu'ils suspendent à des tringles dans la chambre à gaz. Pendant que les poux sont gazés -et cela dure une heure ou deux- les prisonniers prennent une douche, les poils du corps ayant été rasés, les cheveux aussi bien entendu. Il faut donc patienter une petite heure avant de pouvoir récupérer ses affaires et se rhabiller.
Ils s'occupent comme ils peuvent. Quelques-uns discutent, d'autre remuent en se donnant de grandes claques pour se réchauffer, d'autres encore jouent à la "main chaude". C'est sans doute une bonne solution car les participants à ce jeu ont l'air de s'amuser énormément. Voir des hommes de 25 à 30 ans très maigres jouer comme des enfants est réconfortant. Le comique est d'y jouer tout nu, avec des spectateurs tous nus qui rient aussi, sous les yeux étonnés du "Posten". Les prisonniers, même s'ils n'ont pas réussi leur évasion, ont certainement le moral plus haut que les autres qui n'ont pas essayé. Par leur geste, ils se sont prouvés à eux-mêmes et ils ont montré aux Allemands qu'ils ne s’avouaient pas vaincus et que s'ils étaient forcés de travailler pour leur vainqueur, c'était contre leur gré.
À propos de travail, un bureaucrate est passé ce matin, demandant à chacun son nom, son âge et sa profession. Michel a longuement réfléchi à ce problème. Il n'a aucune profession. Le travail qu'on lui fera faire sera un travail de manœuvre : la pelle et la pioche. Il n'a jamais été très costaud, maintenant encore moins, après six mois de jeûne. Rester au camp est tentant, peut-être qu'il suffit de dire qu'il est sous-officier et malade; mais le goût du mouvement et de l'aventure est le plus fort, d'autant que ce camp de Hammerstein paraît lugubre. Le typhus est dans l'annexe du camp occupée par les Russes. Trente mille sont morts depuis six mois paraît-il, ainsi qu'une dizaine de Français qui les ont approchés pour des raisons sanitaires.
Michel, avec son camarade d'Halluin, décide de s'inscrire comme chauffeur de tracteur agricole. Ainsi, ils iront à la campagne et pourront manger à leur faim. Conduire un tracteur, chose qu'ils n'ont jamais faite ni l'un ni l'autre d'ailleurs car d'Halluin est bureaucrate, ne doit pas être très fatiguant, et au moins on travaille assis.
Le lendemain, 3 novembre, les mille prisonniers propres et dépouillés, sont rassemblés sur le "marché aux bestiaux", non loin de leurs baraquements. Une cinquantaine de civils arrivent : ce sont les employeurs. Les tractations durent toute la matinée. Les prisonniers sont adjugés par lots. Comme il fait froid et que tout le monde est en manteau, il n'est pas facile de jauger la force physique d'un homme ainsi vêtu. D'Halluin et Michel préfèrent partir chez le même employeur : à deux, on se défend mieux moralement et physiquement. Finalement, un homme grand et gros avec la casquette à oreillettes que presque tous les campagnards ont dans ce pays arrive :
- "Zwei Männer Traktoriste ?"
- "Ya" .
- "Kommen Sie mit"
("Deux chauffeurs de tracteur ?" - "Oui". - "Venez avec moi".).
Il les entraîne un peu plus loin; huit autres Français gardés par un "posten" armé d'un fusil ont l'air de les attendre. Sur un ordre de celui-ci, ils se mettent en marche colonne par deux vers la gare de Hammerstein. Un train arrive, c'est un omnibus. Ils embarquent. Le voyage dure trois ou quatre heures, on va vers le Nord. Michel a entendu la sentinelle parler du lieu de destination : "Schwarzin". D'après le nom, cela ne doit pas être gai pense-t-il. Il fait noir quand ils arrivent. La réception n'est pas très agréable. Le gros homme de Hammerstein est là, qui gronde des ordres : "Los, Schweinhunde Franzosen, Rauchenverboten " ("Grouillez-vous, cochons de chiens de Français. Interdit de fumer"). Le posten ne veut pas être en reste et aboie à son tour. Dans la nuit noire, on longe de grands bâtiments; on arrive à une petite maison à étage. Le "Posten" loge en bas, les prisonniers en haut, dans une petite pièce où les cinq lits à étage ont juste la place de tenir. Il y a une petite table, deux chaises et un gros poêle en briques, avec un petit four au dessus du foyer comme on en faisait autrefois. La pièce n'est pas grande mais ils auront chaud pendant l'hiver car les murs sont épais et la petite fenêtre bien étanche. Il y a aussi une autre pièce en bas, qui sert de réfectoire avec un robinet au-dessus d'un évier pour la vaisselle et la lessive. C'est là qu'on va goûter à la soupe.
Ce sera à peu près la même pendant le temps que Michel va rester là : un mélange de pommes de terre et de pois secs avec très peu de viande dedans. On a droit aussi à un morceau de pain : 300 grammes par jour. Chacun garde une part de son pain pour tremper dans le thé ersatz qu'on a le matin avant d'aller au travail. Deux prisonniers ramènent la marmite vide à la cuisine située à 50 mètres environ. Ils remontent dans leur chambre où ils sont enfermés à clef par la sentinelle qui ne quitte toujours pas son fusil. Ce sont les ordres, il doit tirer au moindre geste de rébellion ou de fuite. Michel se couche avec un peu d'appréhension. Il a déjà travaillé d'avril à septembre 1941, dans une petite ferme de Franconie, mais l'ambiance était familiale. Il est facile de voir qu'ici tout sera différent. En effet, le lendemain, le "Posten" réveille tout le monde à 6 heures; le travail commence dans un champ assez éloigné vers 7 heures, dans l'obscurité complète au début. Il s'agit de creuser un fossé de chaque côté d'un immense silo de pommes de terre pour le protéger de la gelée. Les prisonniers ont gardé leur manteau et manœuvrent la pelle avec une certaine mollesse. Fureur du "Chef" arrivé sur les lieux. Le "Posten" donne de la voix et agite son fusil. Les manteaux sont enlevés. La matinée paraît longue à Michel, il a toujours un œil sur la sentinelle et se repose quand elle ne regarde pas dans sa direction. À midi, c'est la pause. On a une heure pour revenir au Kdo, aller chercher la soupe, la manger, faire la vaisselle. A 13 heures, le travail reprend. C'est le "Hofmeister" (Maître de cour, sorte de contremaître agricole) qui donne le signal en tapant avec une barre de fer sur un énorme soc de charrue suspendu par un câble à une branche d'arbre. Schwarzin n'est pas une ferme mais plutôt un kolkhoze avec en plus une usine, une distillerie qui transforme les pommes de terre en alcool qui sert à faire de l'essence pour les avions. Cette usine fonctionne toute l'année. Elle avale les 3/4 de la production des 250 hectares de pommes de terre semés tous les ans sur la ferme. A la fin de la journée, tous les prisonniers sont bien contents de rentrer au Kdo. Quelques-uns ont mis des pommes de terre dans leur pantalon lié à la cheville, et, une fois enfermés, ils les font griller dans le foyer du poêle sous la cendre. Le dimanche, on ne travaille pas. La journée se passe en travaux de nettoyage du logement, lessive, raccommodage. On écrit à la maison. D'Halluin et Michel font peu à peu la connaissance de leurs huit camarades. Sur les huit, sept sont cultivateurs et un est ouvrier maçon. Celui-ci s'appelle Scelessio. Ses parents ont émigré d'Italie dans le midi de la France, il y a vingt-cinq ans, au moment de sa naissance. Scelessio qui, avant son évasion, travaillait en Bavière dans un "Gasthaus" (restaurant), était devenu l'homme de confiance de son patron. Celui-ci avait une fille de dix-huit ans. Il est arrivé ce qui devait arriver. Cette jeune fille attendant un enfant a été envoyée chez des parents à Berlin pour accoucher en secret. Quant à Scelessio, il a pris la fuite. C'est ce qu'il avait de mieux à faire. Mais maintenant, il se fait beaucoup de souci pour cette femme. Il n'avait en effet rien d'un coureur de jupons. Il était sérieux, loyal et courageux. De plus, il savait très bien l'Allemand. Les sept autres prisonniers étaient tous des fermiers du Nord, assez âgés et pères de famille. Ils disaient "mi" pour moi, et "ti" pour toi. Ils détestent les Allemands qui ont déjà pillé leur pays en 14-18 et ne cherchent pas à apprendre leur langue exécrée. Au bout d'une dizaine de jours, le travail des silos de pommes de terre est terminé. Il était temps car le froid arrive. Les prisonniers vont maintenant travailler à la batteuse, ou plutôt aux batteuses car il y en a quatre. En effet, il y a plus de mille hectares de céréales dans cette ferme. A la moisson , la récolte est entassée dans de grands hangars en bois; il y en a quatre, situés aux quatre points cardinaux autour de la ferme. Dans chacun de ces hangars, il y a une batteuse fixe entraînée par un gros moteur électrique. Ce travail est beaucoup plus agréable que celui des silos. Manier des gerbes d'orge, d'avoine ou de seigle (car il n'y a pas de blé dans ce pays) à l'abri est moins pénible que de patauger, mal chaussé, dans la neige et dans la boue. Ils travaillent quelque-fois mélangés aux ouvriers et ouvrières de la ferme. Ceux-ci n'osent pas leur parler, ils ont peur de Bolt. Quand le gros "Chef" arrive, tout le monde tremble et active la cadence. On n'ose plus dire un mot. Sa voix, quand il est en colère -et cela lui arrive souvent-, porte bien à deux cents mètres. On a l'impression, peut-être vraie, qu'il a droit de vie et de mort sur tout le monde.
À ce sujet, les prisonniers en ont assez de se faire appeler "Schweinhunde Franzosen" ("Cochons de chiens de Français").
Il est inutile d'en parler au "Posten". Il a trop peur du "Chef" et craint d'être envoyé sur le front russe. Sur les dix Français, un seul aura le courage de dire à cette brute, en face et devant tout le monde, ce qu'ils ont sur le cœur. Ce sera le maçon Scelessio. En effet, d'Halluin et Michel savent un peu l'Allemand mais n'en ont pas le "culot". Un après-midi, l'occasion se présente. À la reprise du travail, à la batteuse, vers treize heures, les Français arrivent avec quelques minutes de retard. Le "Chef" est là et, de sa voix puissante et gutturale: "Immer später zum arbeiten, faül Schweinhunde Franzosen" ("Toujours en retard pour travailler, fainéants, cochons de chiens de Français").
Scelessio sort des rangs, se campe devant le gros boche et hurle en bon allemand devant les ouvriers stupéfaits d'une telle audace : "Nous ne sommes pas des "cochons de chiens de Français", nous sommes des prisonniers de guerre et des hommes comme vous. Si nous sommes en retard, c'est que nous n'avons pas le temps en un heure d'aller manger, faire la vaisselle et revenir ici". L'Allemand est sans doute impressionné par l'attitude fière du Français car il ne répond pas. Il parle un peu à voix basse avec la sentinelle et s'en va. Depuis ce jour, plus jamais les Français ne seront injuriés. Et leur prestige auprès des ouvriers est nettement augmenté. Ils arrivent à parler de temps en temps en cachette avec eux. Le "Chef" s'appelle Bolt. Il n'est pas propriétaire de Schwarzin, mais chef de culture et membre du parti nazi. Le propriétaire, Mr Von Rohn, est un neveu du Maréchal Von Hindenburg; il est officier de carrière en ce moment sur le front russe. On voit d'ailleurs, à travers les arbres d'un petit parc, un château de style Louis XV, non loin de la petite maison où logent les prisonniers.
Cette maison était certainement autrefois habitée par un jardinier ou d'autres serviteurs. Le château semble maintenant à peu près à l'abandon. À l'opposé du château par rapport à la cour, se trouve le hameau de Schwarzin : une quinzaine de maisons assez modestes d'apparence dont les habitants doivent tous travailler sur la ferme. Ils ont toujours un jardin, un cochon, des volailles. C'est un peu le système du kolkhoze soviétique. Les prisonniers peuvent se bourrer de pommes de terre le soir à la veillée. Celles-ci ne manquent pas car un des "Chtimi" est chargé d'alimenter la distillerie. Il fait toute la journée le va et vient avec son "gummiwagen" (chariot à 4 roues sur pneu) traîné par des chevaux. Il faut dire qu'il y a quarante-cinq chevaux de trait à Schwarzin. Ce sont eux qui font tout. Il y a bien trois gros tracteurs, ils ne servent que dans les périodes de presse, pour économiser le carburant sans doute. Il y a aussi près de deux-cents cochons de tous âges et au moins cent vaches laitières noires et blanches, sans compter les élèves.
Justement un soir, le "Posten" entre dans la chambre et dit : "Morgen früh, zwei Männer zum die Kühen milken" ("demain matin, deux hommes pour traire les vaches"), puis il sort en ajoutant : "Halb fünf anfangen" ("commencer à 4h30"). Qui va y aller ? C'est certainement un travail pénible car, après la traite, il faut donner à manger, faire la litière, etc... En plus, se lever à 4h30 n'est pas très agréable. Les sept cultivateurs du Nord savent très bien traire les vaches mais ne veulent absolument pas y aller. "Mi, j'irai pas traire leü vâques" disent-ils avec énergie. Les trois autres Français voudraient peut-être à la rigueur, mais ne savent pas traire. Le "Posten" revient. On lui dit que personne ne sait traire. Il n'est pas dupe et sort en disant que si dans une demi-heure, il n'y a pas deux volontaires, cela ira mal pour tous. Les "Chtimi" sont toujours inébranlables. Alors d'Halluin et Michel, qui n'ont jamais touché au pis d'une vache de leur vie, se présentent quand le "Posten" revient. Celui-ci, satisfait, dit simplement : "Morgen, halb fünf, aufstehen" ("Demain, debout à 4h30"). En effet, le lendemain à 4h30, le vacher appelle à la fenêtre, ouvre la porte et les emmène à l'étable. Il leur donne à chacun un tabouret à un seul pied qui s'attache par une courroie autour des reins, un seau, et leur montre les vaches. Les deux Français expliquent qu'ils ne savent pas. Le vacher lève les bras au ciel, fait asseoir Michel près d'une vache sans doute connue pour son bon caractère et lui montre comment faire. Michel obéit et est étonné de voir que son seau se remplit facilement. Pour d'Halluin, c'est pareil. Les vaches suivantes sont peut-être moins faciles, mais enfin les Français se sont bien débrouillés. Le vacher est content, on porte les bidons de lait remplis à la laiterie et là ils ont droit à un demi litre de lait tout chaud qu'ils avalent en vitesse. Mais maintenant, le plus dur reste à faire: il faut donner à manger les betteraves. A l'extrémité de l'étable, il y en a un tas énorme. Un gros hachoir entraîné par un moteur électrique est à côté. Celui-ci est mis en route. Les quatre hommes, deux Français, le vacher allemand et un ouvrier polonais, suffisent à peine à l'alimenter. En 20 minutes, une tonne environ est hachée et mélangée avec un peu de balle d'orge. Deux baquets, carrés avec des brancards comme une civière, sont remplis. Deux hommes se mettent à chaque baquet. C'est lourd les betteraves et chacun a bien 60 kilos au bout des bras. Avec ce chargement, il faut déambuler devant le nez des vaches et, sans s'arrêter, en verser un peu dans l'auge, à chaque pas. Michel n'a pas les reins assez solides pour un tel travail; il le fait, mais mal. Son coéquipier, le vacher allemand, comprend que ce n'est pas par mauvaise volonté de sa part et ne dit rien. Il faut faire environ cinq voyages par équipe pour que les cent vaches aient leur ration. Après, les vaches ont une soupe de pulpe de pommes de terre venant de la distillerie. Le vacher n'a qu'une vanne à ouvrir et la pulpe rouge et tiède coule d'elle-même dans les auges. Après, il faut faire la litière. Un traîneau tiré par deux bœufs passe dans l'allée centrale. Le fumier est chargé dessus et ensuite vidé sur l'immense tas situé au milieu de la cour de la ferme. Il est près de 11 heures lorsque le travail est fini, et le soir on recommence de 15 heures à 20 heures. Ce travail plaît assez à michel, mais il se demande s'il tiendra le coup à cause de la civière à betteraves. En effet, 15 jours après, un matin, il est pris d'un malaise cardiaque en portant cette civière. Il est obligé de s'asseoir. Les autres terminent le travail à sa place. Deux jours après, d'Halluin et Michel quittent les vaches et le vacher. Ils sont affectés au chantier de forage, dans la cour de la ferme. Deux fermiers du Nord ont compris la situation, reviennent sur leur serment de ne jamais traire les vaches allemandes et les remplacent à l'étable.
2. TRAVAIL AU FORAGE - ADIEU SCHWARZIN
Le travail de forage était plus en rapport avec le gabarit physique de d'Halluin et surtout de Michel. Il y avait depuis quelques jours un derrick installé dans un coin de l'immense cour de Schwarzin, non loin de la distillerie. En effet, celle-ci a besoin d'eau en grande quantité. Pas de cours d'eau ni de lac dans les environs, il faut donc aller chercher l'eau dans la nappe souterraine. Celle-ci est à cent mètres de profondeur paraît-il. D'où ce matériel de forage arrivé de Berlin en ce début de décembre 1942, convoyé par un spécialiste. Celui-ci a quarante ans environ. S'il n'avait pas ce chantier, il serait mobilisé; alors il a intérêt à ne pas aller trop vite, sans que cela se voie, à cause de Bolt qui surveille. Le derrick est haut d'au moins dix mètres et est formé de quatre montants en bois, des grands pins du Nord. Ils se rejoignent en haut, là où est accrochée la poulie qui soutient le câble juste à l'aplomb du trou à creuser. Sauf au tout début, il n'y a pas de travail à la pelle et à la pioche, heureusement. Des cylindres métalliques guidés par un autre cylindre d'un diamètre un peu plus grand et rigoureusement vertical, s'enfoncent dans le sol par leur propre poids. Un petit cylindre à soupape suspendu au câble descend dans ces tubes; le moteur le soulève et le laisse retomber de manière qu'il se remplisse de terre et de cailloux dans le fond du trou. Le moteur le sort, il est vidé de son contenu, et on recommence ainsi toute la journée. La colonne de tubes vissés les uns aux autres s'enfonce de plusieurs mètres par jour au début. Le travail n'est pas trop fatiguant. L'homme de Berlin est plutôt sympathique et ne semble pas aimer Bolt.
Noël arrive dans ces conditions et passe presque inaperçu. Pas de sapin, pas de festivités. Les gens sont tristes. Les nouvelles de la guerre doivent être mauvaises pour eux. Il est impossible de savoir ce qui se passe dans le monde.
Janvier 1943
Les tubes du forage s'enfoncent de plus en plus lentement dans le sol caillouteux. Le cylindre à soupape se heurte à du rocher qu'il faut briser avec un trépan. Celui-ci est fixé à un longue colonne de tiges métalliques de 10 centimètres de diamètre environ, vissées les unes aux autres et qui s'enfilent à l'intérieur des tubes jusqu'au fond. Celui-ci est bien à 40 mètres maintenant. Le travail devient plus dur car il faut faire tourner ce trépan pour qu'il se visse en quelque sorte dans le rocher. Aussi, d'Halluin et Michel tournent-ils toute la journée comme des chevaux de manège, agrippés au levier du cabestan; on gagne 30 à 40 centimètres par jour, et Bolt n'est pas content. Le spécialiste change de trépan. Le câble, actionné par le moteur, le descend au fond, les deux prisonniers vissent les tiges au fur et à mesure que le trépan descend. Celui-ci y est presque quand tout casse. Ou plutôt, le crochet qui maintient la poulie en haut du derrick ayant cédé, la poulie tombe au sol ainsi que le câble. Michel est touché par un éclat de métal et par le câble; il est par terre inanimé. Il est transporté aussitôt dans la chambre des prisonniers. Il se réveille une heure après, tout étonné de se voir couché en plein jour dans un lit avec deux têtes de camarades inquiets au dessus de lui, qui lui disent : "Eh bien, on te croyait mort". La ferraille l'a éraflé près de l'arcade sourcilière, et le câble en tombant lui a démis le bras gauche. D'Halluin et l'Allemand n'ont rien. Bolt fait appeler un "gummiwagen" et convoie lui-même Michel installé sur quelques bottes de paille jusqu'à la petite ville voisine, Pollnow, à 6 kilomètres environ. Là se trouve une clinique avec un vieux médecin qui fait un pansement à la tête et remet le bras démis en place. Il n'a pas senti grand chose car il était endormi.
Mais le retour et les deux ou trois jours suivants seront plus douloureux. Il ne peut pas commander son bras, qui pend inerte, mais il peut ouvrir et fermer le poing. On lui dit de serrer avec celui-ci le montant de son lit, de faire un pas en avant, un pas en arrière de manière à forcer les nerfs de l'épaule et du bras à se rééduquer. Ce qu'il fait. Il sent peu à peu son bras lui obéir. Trois semaines après l'accident, il reprend le travail au forage.
Février 1943
Un jour, d'Halluin et Michel se trouvent seuls avec un ouvrier allemand qui déteste certainement le régime qui les gouverne car il leur dit en petit nègre et d'un air réjoui : "Stalingrad kaput, Hitler kaput, Ruski kommen" ("Stalingrad kaput, Hitler kaput, les Russes arrivent").
Cet homme est une exception, c'est le seul en cinq ans de captivité qu'il aura vu se réjouir de la défaite future de son pays. Un dimanche, ils sont tous les deux réquisitionnés pour aider à nettoyer la porcherie. Pendant qu'ils travaillent, un lieutenant, accompagné d'une femme assez élégante, arrive et semble inspecter les lieux d'un air triste et comme absent. Quand ils sont partis, l'ouvrier allemand avec lequel les Français travaillent leur dit : "Ce sont Mr et Mme Von Rohn". Eux aussi ne doivent pas aimer beaucoup le régime qui les commande. Michel pense que peut-être ils ont déjà le pressentiment de ce qui attend leur pays, que ce domaine sera envahi par les barbares slaves, en fait il le sera exactement deux ans après, et que toutes ces régions de Poméranie Orientale et de Prusse orientale que leurs ancêtres ont conquises au temps des chevaliers Teutoniques, cinq siècles auparavant, seront perdues à tout jamais pour la culture germanique.
Mars 1943
Il y a toujours de la neige, bien qu'il fasse moins froid. Ceux des Français qui ne sont pas occupés au forage ou aux vaches sont tous au fumier. Ils le chargent dans des charrettes anciennes à quatre roues, tirées par des chevaux et le vident, par petits tas, dans ces immenses champs qui entourent la ferme. Les ouvrières - car les ouvriers sont rares - étalent ce fumier sur la neige. Un soir, cinq nouveaux Français, des prisonniers repris eux aussi, arrivent d'Hammerstein. Ils sont installés dans une petite pièce à côté de celle des dix autres.
Avril 1943
La neige est fondue. La terre sablonneuse se ressuie vite. Les trois tracteurs, conduits par des Allemands se mettent en action. Ils labourent jour et nuit avec des charrues à cinq socs. Des attelages, en majorité conduits par des prisonniers, hersent ces centaines d'hectares. La plupart du temps, d'Halluin et Michel travaillent au forage. Il arrive quand même qu'on leur confie un attelage de chevaux avec une herse. En fait, Michel ne conduit pas les chevaux, ce sont les chevaux qui le conduisent. Au bout du champ, ces animaux bien dressés tournent d'eux-mêmes, se mettent dans l'alignement et tirent droit leur outil sur 1 km de long sans dévier d'un mètre. Il faut quand même faire semblant, tenir les rênes et suivre à grands pas. Michel a de mauvaises chaussures à semelles raidies et percées. Il préfère marcher pieds nus. Fin avril, c'est la plantation des pommes de terre. Des engins tirés par des chevaux font des trous de 10 à 15 cm de profondeur à intervalles réguliers dans les champs bien nivelés. Au bout du champ sont les charriots remplis de sacs de pommes de terre de semence. Une douzaine d'ouvrières prend le départ car c'est une véritable course. Chacune porte en sautoir un sac rempli de 20 kgs environ de semence; à chaque pas, sa main libre prend une pommnme de terre et la jette dans le trou sans s'arrêter. Quand le sac est vide, un prisonnier arrive et la ravitaille. Une dizaine de prisonniers se coltinent les sacs de patates toute la journée sur des kilomètres.
Mai 1943
Michel ne fait qu'entrevoir, une journée, ce chantier bien organisé. Un matin, le "Posten" lui dit de rester à la baraque et de se préparer à partir. Trois autres prisonniers parmi les nouveaux arrivés sont dans le même cas. Il les emmène à Polinow par le train. Là, ils passent de la gare à une autre petite gare d'intérêt régional. Un autre "Posten" les attend, et après une attente de deux heures, les fait grimper tous les quatre dans un des wagons, en route pour une destination inconnue, comme toujours. Le voyage ne dure pas longtemps. Le "Posten" interrogé leur dit qu'ils vont travailler sur la voie du "tacot". Ils ne seront plus cultivateurs mais cheminots. Michel, qui a fait beaucoup de métiers différents depuis bientôt trois ans, se demande si ce sera le dernier.
3. SYDOW - HERR RAGUSE ET LA KLEINBAHN
L'endroit où les quatre Français descendent s'appelle Sydow. C'est un petit village assez ancien semble-t-il. Il y a un temple avec un petit clocher sur la place centrale. La gare, minuscule, est à l'extérieur du village. Les prisonniers sont conduits dans un camp miniature entouré de barbelés. Plusieurs baraques, mais une seule est occupée par une vingtaine de Français qui travaillent sur la voie. Est-ce le fait de se promener tous les jours d'un endroit à un autre, ou bien que le pays légèrement vallonné avec un très joli lac entouré de forêts de pins semble plus accueillant, mais ils sont assez contents d'avoir quitté Schwarzin et l'autorité despotique de Bolt. De plus, c'est le printemps. Le temps de punition après l'évasion est terminé. Les barbelés autour du camp ne sont là que pour la forme. Le dimanche, Michel peut sortir et se promener dans les bois de pins. C'est un sentiment de liberté extraordinaire qu'on éprouve quand on peut marcher seul sans être surveillé par quiconque. Il faut en avoir été privé pendant plus d'un an pour pouvoir s'en rendre compte. Enfin, ils ne sont pas surveillés militairement pendant le travail. Le contremaître qui les commande, qui est en même temps le chef de gare de Sydow, s'appelle Raguse, et il est aussi doux et poli que Bolt était brutal et grossier.
Juin, juillet, août 1943
Il fait chaud à travailler sur la voie. Heureusement, une fois le travail fini, les prisonniers peuvent aller se baigner dans le lac distant de cinq cent mètres environ. Il y a une plage de sable fin assez grande pour qu'ils puissent avoir un coin à eux, à l'écart des gens de Sydow. Le fond augmente vite. Il y a soixante mètres d'eau au centre paraît-il. Ce lac a bien trois kilomètres de long sur deux cents mètres de large à peu près.
Septembre 1943
Le travail à la carrière de sable est arrêté et les vingt Français qui chargent les wagons s'en vont ailleurs. Il ne reste que cinq Français à Sydow. Le petit camp entouré de barbelés est trop grand pour eux. Ils sont installés près de la gare, dans une baraque collée au hangar de la locomotive, où couche le mécanicien. En entrant dans cette baraque, Ils retrouvent le décor habituel : trois lits doubles avec leur paillasse, une table au milieu, deux bancs, et au-dessus du chambranle de la porte, la photo en couleur du Maréchal Pétain, toujours la même. Le Vieux soldat est toujours avec eux et leur rappelle la gloire passée de la France. Il leur a dit souvent de loin qu'ils n'avaient pas démérité, qu'il fallait savoir courber la tête, provisoirement, mais que les mauvais jours passeraient. L'aide qu'il leur apportait, n'était pas seulement morale, mais matérielle. Tous les mois, les prisonniers français touchaient chacun un kilogramme de biscuits de guerre, c'est ce qu'on appelait les "biscuits Pétain". Ces biscuits étaient accompagnés d'une plaque de chocolat ou d'une boîte de conserve.
Ces envois, en plus de ceux de la Croix Rouge, ont sauvé la vie de beaucoup. Surtout de ceux qui avaient la malchance de tomber dans de mauvais kommandos, ou qui n'avaient pas de famille pour leur envoyer des colis. Il arrivait aussi que certains employeurs ou sentinelles allemandes se conduisent de manière brutale ou vexatoire. Le prisonnier maltraité avait le droit d'envoyer une réclamation, en général par l'intermédiaire de l'homme de confiance du kommando, à la Croix Rouge Internationale qui la transmettait à la mission Scapini. Celle-ci faisait une enquête avec les autorités militaires allemandes qui donnaient raison, dans les cas d'irrégularité manifeste, aux prisonniers français.
En plus des distributions de biscuits, il y avait les distributions de vêtements et de chaussures, en général une fois par an. C'est ainsi qu'en janvier 1944, le "Posten" dit un soir à Michel : "Demain, tu iras à Köslin, chercher des vêtements pour tes camarades; prépare la liste de ce qu'il faut". Un des camarades de Michel, Breuilly, qui a un gros appétit et qui aime bien le beurre et le pain blanc lui dit : "Puisque tu descends à la gare de Köslin, où est la direction de la Klein Bahn, tâche d'aller voir le directeur et de lui demander les rations de travailleurs de force; comme on décharge au moins dix wagons par semaine, on y a droit". Michel lui répond qu'il fera son possible, mais se dit en lui-même qu'il a bien peu de chances d'être reçu par le directeur de la Klein Bahn, homme important certainement et qui ne sera peut-être pas à son bureau. Le lendemain donc, le "Posten" vient le chercher et ils prennent le train pour Köslin. À Pollnow, trois ou quatre hommes de confiance des kommandos voisins se joignent à eux. Michel sait qu'il est inutile de demander au "Posten" la permission d'aller voir le "Chef" de la Klein Bahn. Aussi, en débarquant sur le quai de la gare de Köslin, il demande tout simplement la permission d'aller aux W.C., ce qui ne se refuse pas en général. Il fait semblant de se diriger vers l'édicule en question, voit que la sentinelle est occupée avec les autres prisonniers et le perd de vue. Il change de direction dans la foule et se dirige rapidement vers ce qui semble être le bureau du Chef de gare. Par la porte vitrée, il aperçoit des dactylos, il entre et dit la phrase qu'il avait préparée : "Verzeihen sie mir, Kann ich zum Herr Raas sprechen ?" ("Excusez-moi, puis-je parler à Mr Raas ?"). L'une de ces jeunes femmes entre dans le bureau voisin, et revient en lui faisant signe d'entrer. Michel entre, se met au garde à vous en portant la main à son képi et dit :
- "Ich bin der Vertrauen Mann arbeit Kdo von Sydow. Wir müssen die Schwerarbeit Karten haben."
- "Warum den ?"
- "Umladen".
- "Wie heist Ihr Chef ?"
- "Herr Raguse"
- "Gut, ich werde sehen"
("Je suis l'homme de confiance du Kdo de Sydow. Nous devons avoir les cartes de travailleurs de force". "Pourquoi donc ?" "Décharger les wagons". "Comment s'appelle votre chef ?" "Herr Raguse". "Bon, je vais voir").
Michel, tout étonné du succès de sa démarche, sort après avoir salué. Il rejoint des camarades au portillon de la sortie, mais là, il reçoit la plus belle engueulade de sa vie de la part de la sentinelle qui se demandait où il était passé. La suite de la journée se passe sans incident. Ils traversent la ville pour aller à la caserne où est le dépôt des vivres et vêtements distribués dans tous les kommandos du "Kreis" (canton). Là, un sous-officier français qui est l'homme de confiance cantonal donne à chacun ce à quoi il a droit. Ils peuvent même voir par la fenêtre les jeunes recrues allemandes faire l'exercice dans la cour de la caserne; elles n'ont pas l'air de s'amuser. Depuis ce jour, ils toucheront tous les dimanches une ration supplémentaire de "Würst" (saucisson), un peu de lait et du pain blanc.
La sollicitude de la mission Scapini va jusqu'à faire circuler dans les kommandos de prisonniers en Allemagne une troupe de théâtre de Paris. Un après-midi de novembre 1943, tous les Français de la région de Pollnow, une centaine peut-être, arrivent à pied accompagnés de leurs "Posten", au théâtre de la ville, là, ils assistent à une représentation. Essentiellement des chants et des danses. Cela fait un drôle d'effet de voir des Français et surtout des Françaises, qui eux sont libres, rentreront en France demain ou dans huit jours, retrouveront leur famille. Les prisonniers regardent avec de grands yeux ces gens si différents. Un monde les sépare. D'ailleurs, interdit de communiquer. Ils retrouveront leur paillasse ce soir avec un peu d’amertume.
Une autre fois, un dimanche, c'est un aumônier français, prisonnier comme eux du camp de Hammerstein qui est venu à Sydow. Ceux qui l'ont voulu ont pu se confesser et communier. Ils ont offert à ce prêtre, très sympathique d'ailleurs, un déjeuner comme il n'en avait certainement pas mangé depuis longtemps : conserves variées, civet de lapin, pudding au chocolat.
Il ne reste plus que six Français à Sydow. L'un travaille chez le boulanger et on ne le voit presque plus, un autre a remplacé le chauffeur de la locomotive du tacot, mobilisé; un autre fait marcher une ferme du pays avec la fermière devenue veuve, mais il revient tous les soirs au kommando; les trois derniers travaillent sur la voie. Les mois succèdent aux mois et ce n'est qu'en décembre 1944 que la guerre montrera qu'elle n'épargnera pas ce coin perdu de Poméranie.
4. DERNIÈRES SEMAINES DE CAPTIVITE A SYDOW
Décembre 1944
"Halt, Mozieurs, ein bischen arbeit hier" ("Halte Messieurs, un peu travailler ici"), dit Herr Raguse aux trois prisonniers français qui poussaient la draisine depuis quatre kilomètres. On n'était pas loin du terminus du "tacot" "Klein Bahn" disent les Allemands. La voie surplombait légèrement le lac, le "Kaminsee", et longeait la route goudronnée à travers des forêts de pins. Il faisait assez froid et les quatre hommes, car Raguse travaillait lui aussi, se mirent à racler la neige avec des pelles en vue de changer deux traverses à un endroit où la voie était légèrement affaissée. Vers dix heures trente, le plus jeune Français, Michel, demande à Raguse :
- "Feuer für Suppe ? " ("Du feu pour la soupe ?").
- "Ya, ya", dit Raguse tranquillement.
Michel descend vers le lac au milieu des pins couverts de neige dans le but de trouver des morceaux d'écorce pleins de résine : c'est l'idéal pour faire démarrer un feu dehors. Avant de remonter avec son chargement, Michel jette un coup d’œil sur le lac dont la rive opposée est bordée comme celle-ci de pins à perte de vue. Pas une maison, pas de vent, c'est le silence complet dans une lumière très tamisée. C'est bien le paysage décrit par P. Benoît dans son roman "Axelle" pense-t-il; mais là s'arrête la comparaison, car il n'a pas la chance d'être le secrétaire d'un vieux général et le chevalier servant de sa fille. Néanmoins, il préfère travailler ici plutôt qu'à Berlin ou dans les mines de la Ruhr. Soudain, il voit, se détachant sur la glace couverte de neige qui borde le lac, le cadavre d'un beau lièvre. Ce lièvre congelé a des chances d'être bien conservé. On le dégèlera ce soir à la baraque et cela changera des lapins que Breuilly prend au collet, en cachette bien sûr, et presque au péril de sa vie, car dans ce pays le braconnage est un véritable crime.
Michel rejoint ses camarades; on le félicite pour la découverte du lièvre. La soupe à base de pommes de terre est vite cuite. Raguse sort de son sac ses sandwichs et son bidon qu'il fait réchauffer au feu et tout le monde s'installe autour de la marmite avec sa gamelle.
Ces prisonniers étaient tous les trois des évadés repris et avaient, de ce fait, des uniformes disparates. Michel était en bleu horizon avec un képi; cà c'était les vieux stocks de 14-18. Breuilly, de son prénom Auguste, avait un manteau américain et un calot anglais. Adrien Col avait un uniforme verdâtre, tchèque peut-être. Raguse, lui, était impeccable dans son uniforme de chef de gare, bleu foncé avec parements rouges et boutons dorés, et sa belle casquette à pont qui ne le quittait jamais.
Comme ils étaient en train de manger, on entend un grondement dans le lointain, vers le Sud, et qui se prolonge pendant une dizaine de minutes. Des bombes d'avions évidemment. Les Français se mettent à parler entre eux, et Raguse, toujours impassible, essaye de comprendre ce qu'ils disent. C'est la première fois, depuis plus de deux ans qu'ils vivent dans ce pays perdu, que la guerre se manifeste à eux. Quand ils vont à Pollnow, la petite ville voisine, décharger des wagons, Raguse achète toujours le "Ost Pommern Zeitung" (Journal de la Poméranie Orientale) qu'il lit et prête pendant le casse-croûte à Michel qui sait un peu l'allemand. C'est ainsi qu'ils ont appris le débarquement en Normandie et qu'ils savent que l'Armée Rouge s'approche de la Prusse et de la Poméranie Orientale. Ils savent aussi qu'un certain Général de Gaulle a formé une petite armée de volontaires en Angleterre qui aide les Alliés à libérer la France. Quant aux résistants intérieurs, ils sont présentés comme des "terrorists", ramassis de bandits qui ne méritent aucune considération, ni de pitié. A la fin du repas, le plus hardi des Français, Breuilly, que les Allemands admiraient à cause de sa force et de son adresse, met son poing fermé au-dessus de sa tête et dit en souriant à Raguse : "Bald Staline hier, du nicht Heil Hitler aber Heil Staline Sagen" ("Bientôt Staline va arriver ici, il ne faudra plus dire Heil Hitler mais Heil Staline"). "August, August" répond seulement Raguse d'un ton de reproche attristé. Et le travail reprend...
Il faut dire que Raguse, quoique membre du parti nazi, n'a rien d'une brute autoritaire. Non, c'est un homme civilisé et bien élevé, marié et père de famille, propriétaire d'une petite ferme avec un cheval, une vache, des cochons, etc... Il méprise un peu les Polonais et surtout les Russes qu'il juge barbares, et n'aime pas les Juifs qui volent le pauvre monde. Il a certainement voté pour Hitler, il y a onze ans et a applaudi, comme la majorité du peuple allemand, à l'ordre revenu et au côté social du National-Socialisme. Maintenant, en décembre 1944, comme la majorité des Allemands, il sait que la guerre est perdue, mais ne le dit pas.
Depuis près de deux ans qu'il travaille avec ces trois Français, il les connaît parfaitement et s'entend très bien avec eux. Et pourtant, au début, il avait une certaine inquiétude car on lui avait dit que ces Français étaient des évadés repris. Il avait craint d'avoir à faire à de fortes têtes décidées à lui en faire voir de toutes les couleurs. Il avait vite compris que ces Français, qui en effet avaient essayé de s'évader en mars-avril 1942, qui avaient fait six mois dans le camp de punition de Rawa-Ruska et six mois dans un kommando de "redressement” à quinze kilomètres de là, ne souhaitaient maintenant qu'attendre tranquillement la fin de la guerre sous l'autorité plutôt bienveillante de Herr Raguse.
Bien sûr, il fallait donner de temps en temps un coup de collier, spécialement pour décharger les wagons, à Pollnow, ce qui arrivait trois ou quatre fois par semaine. Bien sûr, c'était un travail pénible et très salissant; ces wagons, en général remplis de charbon, houille ou coke, arrivaient par la grande ligne et il fallait les transborder dans les wagons du tacot. Dans l'autre sens, c'était les pommes de terre, principale production agricole des ces grandes plaines sablonneuses du Nord-Est de l'Allemagne, qui passaient des petits wagons du tacot dans ceux de la grande ligne.
Souvent, d'autres ouvriers allemands venaient en renfort car il fallait que tout soit prêt à l'heure dite. C'était une sorte de travail d'équipe. La voie sur laquelle était le wagon à décharger surplombait d'un mètre et se trouvait à un mètre environ en face de celui qu'on devait remplir. Un plan incliné en bois reliait les deux, porte à porte; deux hommes étaient dans le wagon du haut et jetaient la marchandise sur le plan incliné. Celle-ci était reprise en bas par les deux autres. Chaque homme devait donc remuer la moitié du poids total du chargement. Les wagons de la grande ligne contenaient en général vingt tonnes pour le charbon, un peu poins pour les pommes de terre. Il fallait deux petits wagons du tacot pour un de la ligne normale.
Tout était bien organisé et on ne perdait pas de temps. En général, Michel le plus faible, faisait équipe avec Auguste Breuilly le plus fort. Adrien Col et Raguse étaient à peu près de même force. Chacun mettait de vieux habits en toile pour protéger ses vêtements. Quand c'était de la chaux ou de l'engrais en vrac, il fallait se nouer un mouchoir sur le nez et la bouche. Celui qui portait des verres était obligé de les enlever. Michel légèrement myope, avait cassé ses lunettes le 1er novembre 1942, en arrivant à Hammerstein, et n'avait pas pu les remplacer depuis. Cela ne le gênait pas. Ce qui le gênait, c'était qu'il était moins fort physiquement que les autres et qu'il était le seul des quatre à n'avoir jamais travaillé à cette cadence. Néanmoins, chose qui l'étonnait lui-même, il faisait son possible pour tenir sa place et y arrivait presque. Son camarade Breuilly, petit cultivateur à La-Haye-du-Puits près de Ste-Mère-l'Eglise dans le Cotentin, était un véritable colosse. Il avait déjà trente-six ans, était marié et père de deux enfants. Il aidait discrètement et sans jamais rouspéter son camarade plus faible quand il était en difficulté.
Une camaraderie sincère et éprouvée unissait les Français pourtant différents par l'âge, le métier et le milieu social. En effet, si Breuilly était un cultivateur normand, Adrien Col était un ouvrier typographe de St Etienne, petit, brun et trapu, il avait trente ans, et s'était marié juste avant la guerre. Il n'avait pas son pareil pour accommoder dans une vieille cuvette émaillée, qui servait aussi à la toilette, les nombreux lapins que Breuilly prenait avec ses collets. Avec les oignons et la farine que sa femme lui envoyait dans ses colis, il mijotait d'excellents civets. Naturellement, les colis étaient mis en commun, et ils ne manquaient pas de nourriture, surtout avec les pommes de terre qu'ils prélevaient dans les wagons. Le plus jeune des trois prisonniers, Michel habitait dans le Périgord, était fils d'officier, avait étudié sans succès les mathématiques et s'était engagé en 1937. Comme il savait un peu mieux l'allemand que ses camarades, c'était lui qui se chargeait des rapports avec Raguse et le "Posten" qui les enfermait à clef tous les soirs dans leur baraque.
Justement ce soir de décembre, où pour la première fois ils avaient entendu les avions alliés bombarder, dans le lointain, les trois prisonniers décident que demain on mettrait Raguse au pied du mur pour la question du savon. "Demain, dit Breuilly à Michel, tu dis à Raguse que s'il ne nous donne pas du bon savon, on ne décharge pas le wagon de charbon". D'accord, répond Michel un peu inquiet mais fataliste. C'est vrai qu'il était logique qu'après un travail très salissant, on donne du savon; d'ailleurs Raguse et les ouvriers allemands ont du vrai savon, pourquoi pas nous ? On verra bien. Le lendemain, au lever du jour, Raguse arrive à la baraque et dit simplement : "Aujourd'hui Pollnow, décharger wagon de charbon". "Herr Raguse, dit Michel, si nous n'avons pas ce bon savon promis depuis si longtemps, nous ne déchargerons pas le wagon". "C'est le chef de gare de Pollnow qui doit vous le donner, on va le lui demander en arrivant. Ce savon est très rare et il faut des bons spéciaux pour en avoir".
Les trois prisonniers sortent de la baraque et se mettent à pousser la draisine dans la direction opposée à celle de la veille. Pollnow est une petite ville de dix mille habitants environ, mais un noeud ferroviaire relativement important. Raguse donne un coup de main pour pousser la draisine car la voie monte à l'intérieur d'une tranchée. Arrivés en haut, tout le monde embarque, Raguse se met au frein et il n'y a plus qu'à se laisser glisser jusqu'à Pollnow, ou presque, car le dernier kilomètre est sur le plat. Là, Raguse s'engouffre dans le bureau du chef de gare, après avoir dit aux Français d'aller au wagon, à la gare des marchandises. Ce qu'ils font. Mais au lieu de commencer le travail, comme d'habitude, ils s’assoient tranquillement. Cinq minutes après, Raguse et le chef de gare arrivent : "Un wagon, disent-ils ne peut pas attendre, il faut qu'il soit déchargé immédiatement, vous aurez le savon après". "Nous voulons le savon avant, dit Michel, cela fait déjà quatre ou cinq fois que vous ne tenez pas vos promesses". Raguse regarde les trois Français d'un air perplexe; depuis dix-huit mois qu'il travaille avec eux, c'est le premier ennui sérieux qu'ils lui causent. Les deux Allemands sentent bien que c'est un coup monté, rien d'autre à faire que de téléphoner à qui de droit. Ils retournent vers la gare. Auguste, Col et Michel attendent toujours assis et un peu inquiets, la suite des événements. Au bout d'un quart d'heure, un bruit de moto, c'est un side-car conduit par un sous-officier. Il est tout seul. "Pourquoi ne voulez-vous pas travailler ?". "Le travail est très sale, dit Michel, cela fait trois mois que nous demandons du vrai savon". Le sous-officier le regarde avec un étonnement grave, il sort lentement son revolver de son étui et dit sans élever la voix : "Vous allez décharger le wagon immédiatement, vous aurez le savon plus tard". Les trois prisonniers se consultent du regard : on ne peut pas aller plus loin. Ils se lèvent donc sans avoir l'air de trop se presser mais exactement en même temps. Et se mettent à décharger le wagon. Le sous-officier remonte sur sa moto et repart.
Deux jours après, le savon en question arrivera. Le sous-officier a certainement fait un rapport donnant raison aux Français. Après cet incident, la vie reprend son cours. Maintenant qu'on a du savon, on ne manque de rien, tout au moins au point de vue matériel, car au point de vue moral on se fait du souci.
Depuis bientôt six mois, les lettres n'arrivent plus de France. Breuilly se demande si sa famille a survécu dans la bataille terrible qui a eu lieu en juin dans la région de Sainte-Mère-l'Eglise où il habite. Michel aussi est un peu inquiet. Le Périgord a eu les honneurs d'un article de l'"Ost Pommern Zeitung" où il était question de "terrorists" et de règlements de compte entre partisans du Maréchal Pétain et du Général de Gaulle.
Les trois Français sont fiers qu'il y ait un général et une armée de leur pays qui contribuent à la victoire et efface l'humiliation de 1940. D'un autre côté, ils ne retirent pas leur affection et leur respect pour le "Vieux Pétain" dont la photographie en couleur, barrée de bleu, blanc, rouge orne toujours leur Kdo avec cette dédicace du Maréchal : "La patience est la plus belle forme de courage". Ils le remercient de les avoir soutenus de loin par son prestige de vieux soldat respecté des Allemands. Les prisonniers ont eu de la chance dans leur malheur: le Maréchal Pétain les a protégés, ainsi que bien d'autres Français d'ailleurs, quand les Allemands étaient les maîtres; maintenant, ils ont une chance d'être épargnés, quand les Russes arriveront, grâce à de Gaulle. Cela, les Allemands de Sydow le sentent. Ils savent qu'ils seront tous exterminés avec leurs familles quand l'Armée Rouge arrivera. Ils se doutent que les prisonniers français seront épargnés et même rapatriés, grâce au fait que maintenant la France est l'alliée officielle de la Russie. Un des sous-ordres de Raguse, du nom de Plaak, le dira d'ailleurs assez méchamment à Michel dans quelques jours : "Pétain ist ein alt Fuchs, wir haben viel zugut für Franzosen gewesen" ("Pétain est un vieux renard. Nous avons été bien trop bons pour les Français").
Vers le 20 décembre, le visage de Raguse s'éclaire d'une lueur d'espoir en lisant le journal à la pause de neuf heures. Michel, qui a la permission d'y jeter un coup d’œil, lit: "Le Maréchal Von Rundstedt écrase complètement le front américain dans les Ardennes, prend Valenciennes et fonce vers Paris". Propagande ou réalité ? Le journal est naturellement plein de nouvelles faites pour leur remonter le moral. Il y est question des fusées V1 et V2 qui écrasent Londres, et d'autres armes plus terrifiantes qui vont sauver l'Allemagne. En attendant, les Russes se rapprochent. Les réfugiés de Prusse Orientale affluent. Surtout des femmes et des jeunes filles qui défilent dans Pollnow la pelle sur l'épaule, en chantant. Elles aident de nombreux travailleurs à creuser des fortifications et un énorme fossé antichar qui zigzague à travers champs. Comme il faut loger tout ce monde, des baraquements préfabriqués arrivent démontés par la grande ligne. Il arrive aussi du ciment et des pavés, sans doute pour construire des blockhaus, des wagons de carottes, de choux et même de pain. Naturellement les prisonniers Français et les Allemands se cachent à peine pour en prélever une petite partie pour leur usage personnel.
Le jour de Noël, on sent que c'est le dernier Noël allemand à Pollnow. Un énorme sapin est planté, comme tous les ans à cette date, sur la place centrale de la ville. Mais cette fois, il n'est orné d'aucune guirlande.
Janvier, février 1945
L'offensive Von Rundstedt a échoué. Raguse garde toujours un flegme poli mais la lueur d'espoir que lui et ses compatriotes ont eue pendant quelques jours a disparu. Les travailleurs défilent toujours le matin, mais Michel a l'impression que leurs chants s'arrêtent au fond de leur gorge. Les explosions qu'on entend dans le lointain sont de plus en plus fréquentes et se rapprochent semble-t-il. Un matin, les trois Français sont en train de travailler sur la voie en remblai, à l'entrée de Pollnow. Raguse est là avec avec sa belle casquette et un grand levier déborde à l'avant de la draisine, braqué justement dans la direction du Sud. Michel, le premier, voit deux avions légers, des chasseurs, venant du Sud et se dirigeant droit sur eux. Ils sont à cinquante mètres de hauteur environ. Avec ensemble, l'avant des avions s'incline et il voit des lueurs de chaque côté des hélices. Un saut de côté et il se laisse débarouler en bas du remblai, ses camarades et Raguse en font autant. Deux autres avions passent en mitraillant, et deux autres encore. Cela va très vite, mais cela paraît très long. Personne n'est touché mais ils l'ont échappé belle. Les avions s'occupent maintenant de mitrailler Pollnow. Au bout d'un quart d'heure, ils s'en vont. Il n'y aura, officiellement du moins, que quelques blessés légers et un cheval tué. Ce raid ne change pas l'attitude de la population. Ils ne verront pourtant aucun avion de chez eux, mais cela n’a pas l'air de les affecter outre mesure. Chacun est à son poste et travaille comme si de rien n'était. Les trains roulent et arrivent à l'heure. On peut lire inscrit en grosses lettres blanches sur le noir des locomotives et des tenders : "Rader müssen rollen für den Sieg" ("Les roues doivent rouler pour la victoire").
Ces gens qui se savent perdus gardent une attitude digne et résignée, devant les prisonniers surtout. Ceux-ci continuent aussi. Que faire d'autre ? Fuir est impossible en cette saison, et refuser le travail équivaut à la mort. Raguse lui-même l'a dit à Michel, un jour où celui-ci avait l'air de se moquer de lui : "Tu n'es pas encore rentré chez toi". Et il ne plaisantait pas. Et pourtant, Michel ne va pas travailler pendant trois ou quatre jours. En effet, un matin, après une nuit sans sommeil, il montre son pouce gauche tout enflé à Raguse : c'est un panaris qu'il faut ouvrir. Pas de médecin à Sydow et aujourd'hui on ne travaille pas à Pollnow, d'autant plus qu'il y a une belle tempête de neige. Les congères obstruent la voie et les aiguillages par endroit, et le tacot ne peut rouler. Il faut attendre que le chasse-neige déblaye. Une seule solution : aller à pied à la clinique de Pollnow. Raguse signe un "Ausweiss" (permis de circuler). Michel le met dans sa poche et part dans un vrai blizzard. Après deux heures d'effort, il arrive à la clinique de Pollnow qu'il connaît déjà. En effet, c'est là qu'on l'a soigné il y a deux ans après son accident à la ferme de Schwarzin. Il sonne, on ouvre. Une infirmière paraît. Michel montre son doigt et baragouine quelque chose en Allemand.
- "Vous êtes Français" dit l'infirmière sans aucun accent.
- "Oui".
- "Moi aussi, je suis Française".
- "Comment est-ce possible ?" dit-il abasourdi.
À ce moment arrive le vieux médecin qui lui a remis son bras en place il y a deux ans, suivi de deux médecins militaires très jeunes. Ils regardent le pouce malade et disent qu'il faut endormir et ouvrir. Michel qui veut montrer son courage devant les médecins allemands et l'infirmière dit que ce n'est pas la peine d'endormir pour si peu. Ils se mettent tous à rire. On le fait étendre sur le billard, un tampon de quelque chose sous le nez, et quinze minutes après il se réveille. L'infirmière est en train de lui faire un gros pansement avec des bandes de papier. On est seul, on peut parler. "Comment êtes-vous ici ?" demande-t-il. Les explications sont embarrassées. Michel comprend qu'elle est infirmière dans l'armée allemande depuis le début de la guerre qui l'a surprise alors qu'elle était en stage à Berlin.
Quel drame ou quel roman se cache-t-il là dessous ? Il ne faut pas trop insister. On donne à Michel un bol de café et un morceau de pain. La tempête est calmée. Il remercie et s'en va vers la gare de Pollnow. Le tacot roule maintenant. Il est content de retrouver ses camarades et même Raguse. Tout le monde le blague et il restera pendant deux jours à la baraque à tremper son pouce dans l'eau chaude pour finir de le guérir. Quelques jours après, c'est Auguste Breuilly qui tombe malade. Il a de la fièvre et reste huit jours alité à Pollnow; c'est une crise d'hématurie. Le médecin lui donne des pilules qui semblent faire bon effet. Heureusement, car ce n'est pas le moment de tomber malade.
Février 1945
Maintenant, une cinquantaine d'uniformes verts de gris sont cantonnés à Sydow. Ils ont même l'écusson S.S. sur le col. Et pourtant, ils ont l'air assez débonnaires. Ce sont des volontaires lettons qui n'aiment pas les Russes. Comme armes, ils n'ont que leurs fusils et des mitrailleuses. Les hommes âgés qui restent à Sydow et dans les environs sont rassemblés et armés de vieux fusils. Ils portent un brassard blanc avec deux lettres peintes en noir : V.S. C'est la "Volk Sturm” (littéralement : "Ouragan du peuple"). Il est douteux que cette troupe hétéroclite, qui semble vraiment manquer d'enthousiasme et de moyens matériels, puisse longtemps arrêter l'Armée Rouge. Les trois Français sentent que les prochains jours décideront de leur vie ou de leur mort. Ils pensent à leurs familles dont ils n'ont plus de nouvelles depuis plus de six mois maintenant, mais chacun garde ses pensées pour soi. Seul le quatrième Français qui loge avec eux à la baraque de Sydow ne s'en fait pas. Il s'appelle Brunier et est ouvrier agricole dans la Brie. Sa famille, s'il en a une, il n'en parle jamais. Illettré, il est d'une force et d'une habileté extraordinaires. Il n'aime pas les "Chleus" mais aime bien la fermière, veuve de guerre, chez laquelle il travaille depuis deux ans. Assez souvent, il la rejoint la nuit. Comme la porte de la baraque est fermée à clé, il passe par le toit dont il a habilement déjointé les panneaux préfabriqués.
Un matin de ce mois de février, il revient de son équipée nocturne avec un casque allemand à la main. C'est celui d'un soldat letton de garde qui a essayé de l'arrêter. Brunier l'a assommé à coups de poing, et, tout content, nous ramène le casque comme preuve de son fait d'arme. Breuilly et Michel cachent le casque qui sera enterré subrepticement derrière la baraque dans la journée suivante non loin du ceinturon et de la baïonnette qu'il avait chapardés à la sentinelle l'été précédent, alors que celle-ci les avait déposés à la lisière d'un bois où il était rentré en galante compagnie.
C'est aussi pendant l'été dernier que Brunier avait ramené dans un sac une dizaine de grosses carpes qu'il avait pêchées en une demi-heure dans le petit étang du châtelain du village. Il avait fabriqué une ligne très rudimentaire mais bien suffisante pour prendre ces poissons allemands sans méfiance. Mais Brunier avait été vu et dénoncé. Il s'en était suivi un avertissement sévère donné à Michel par les gendarmes venus fouiller la baraque, sans succès d'ailleurs.
Une autre fois, Brunier avait ramené de sa ferme un cochon de vingt kilogrammes environ, ligoté dans un sac. Mais le cochon était vivant et les liens défectueux. Le cochon, affolé, avait galopé dans la baraque en poussant des hurlements, poursuivi par les quatre prisonniers. La chasse avait duré dix bonnes minutes au bout desquelles le cochon, finalement attrapé, avait été saigné et découpé en morceaux cachés soigneusement. Le chauffeur de la locomotive, qui logeait non loin de là, avait entendu le bruit. Comme il n'aimait pas les Français, il a prévenu les gendarmes qui sont revenus, ont fouillé, mais de nouveau sans succès. Michel leur a juré ses grands dieux qu'il n'y avait jamais eu de cochon. Évidemment, il ne fallait pas que Brunier ni sa patronne n'aient des ennuis. Les gendarmes sont repartis pas très convaincus, en disant : "Passen mal auf, Menschen" ("Faites attention, êtres humains").
Si les Russes n'étaient pas arrivés, il est possible que Brunier soit resté à Sydow une fois la paix revenue. En France, il n'avait rien; là, il avait une ferme et même un foyer. Il avait voulu, d'ailleurs, passer travailleur civil 18 mois auparavant pour ne pas être bouclé le soir et pouvoir circuler librement dans le pays. Mais Michel le lui avait fortement déconseillé pour des raisons patriotiques. Maintenant que les Russes étaient presque là, Brunier se félicitait d'avoir écouté ses conseils.
Les Russes sont presque là en effet; ce ne sont plus des bombardements d'avions mais bien de l'artillerie ou des chars qu'on entend tirer dans le lointain. La "Volk Sturm” fait des barrages avec des arbres sur la route du Sud de Sydow. La voie du "tacot" est minée à 1'emplaceqent du fossé antichar qui protège Pollnow. Il semble qu'il y ait moins de wagons à décharger; les prisonniers balayent la neige et dégèlent les aiguilages bloqués par la glace.
Une de ces dernières journées de travail à Sydow, en mangeant au bord de la voie, Raguse, toujours calme, dit de son ton doux habituel aux trois Français : "Dans quelques jours, les Russes seront ici et nous serons tous tués. Pourquoi les Américains, les Anglais et les Français ne font-ils pas la paix avec l'Allemagne qui les défend contre les Russes ? Nous allons être tous anéantis, mais plus tard ce sera votre tour". Comme Raguse s'était comporté depuis deux ans plutôt en "gentleman" qu'en ennemi avec eux, Michel lui dit, sans le croire beaucoup d'ailleurs : "Il y aura un premier moment difficile à passer, mais peut-être après un ordre nouveau s'installera et il pourra sauver sa vie et celle de sa famille". Breuilly lui conseille de fuir, au dernier moment, dans la forêt, avec sa femme et son fils, s'y cacher pendant un mois s'il le faut, et reparaître au moment propice. Il est certain que Raguse, comme tous les Allemands sensés, comme Rommel, Stauffenberg et des milliers d'officiers avaient tenté de le faire en juin 1944, pense que la seule manière de sauver l'Allemagne et les Allemands, ceux de l'Est surtout, est de faire une paix séparée avec les puissances de l'Ouest, même au prix de la mort de Hitler. Oui mais celui-ci n'avait pas été tué. Ils allaient payer maintenant pour les rêves sanguinaires et orgueilleux de leurs dirigeants. Sans aucun doute, et tous les habitants de la région le savaient, les Russes allaient se venger de la barbarie avec laquelle ont été traités la population et les prisonniers de leur pays envahi au moment de l'avance allemande de 1941-1942.
5. 26 FEVRIER 1945 - JOUR DE L’ARRIVÉE DES RUSSES A SYDOW
La matinée se passe en menus travaux devant la petite gare de Sydow qui est une simple baraque en bois de trois mètres sur cinq mètres peut-être. Quatre ou cinq "Bauers" (paysans) avec leur brassard de la "Volk Sturm" déchargent un wagon de traverses. Un retardataire arrive : "Heil Hitler" dit-il bien fort mais d'un ton ironique. La blague est un peu grosse, les autres n'ont pas l'air de la goûter et ne répondent rien. On entend le bruit des obus à quelques kilomètres. Les prisonniers qui savent qu'ils ne le seront bientôt plus, rentrent prendre leur repas de midi dans leur baraque située à cinquante mètres environ de la gare. A 13h30, ce n'est pas Raguse qui vient les chercher mais son adjoint Plaak, homme hargneux et antipathique. Les prisonniers sortent sur la voie déserte. Celle-ci longe le village mais n'y entre pas. Du côté opposé au village, ce sont des champs labourés et plus loin de grandes forêts de pins. Dans ces champs, à cinquante mètres peut—être, ils voient un beau geyser de terre mélangée de neige et ils entendent, un dixième de seconde après, le bruit de l'éclatement de l'obus. Plaak dit simplement : "Kein Arbeit heute" ("Pas de travail aujourd'hui"), et disparaît en courant vers le village. Le char qui à tiré est bien visible sur la voie, à l'entrée Sud de Sydow. Les Français se demandent ce qu'il faut faire. Le char va-t-il tirer sur la voie et sur la gare? Ils pensent à partir dans la forêt. Un autre obus tombe dans le labour un peu plus loin, cherchant à atteindre une voiture de paysan tirée par un cheval, filant au galop vers la forêt. Sur la voiture, ils reconnaissent Raguse, sa femme et son fils âgé de dix ans et un gros chargement de vivres et de vêtements évidemment. Raguse arrivera à la forêt; les trois Français ne sauront jamais s'il aura pu sauver sa vie. Le char ne tire plus sur Raguse invisible maintenant, mais sur le village. Les trois Français rentrent dans leur baraque, préparent leur sac avec vivres, vêtements, couvertures, etc..., et attendent les évènements. Maintenant, le bruit n'arrêtera pas pendant une bonne heure.
Évidemment, c'est la route qui traverse le village qui intéresse les Russes. C'est là que se trouvent les barricades et leurs quelques défenseurs. La baraque, là où elle est située, ne risque pas grand chose. Par prudence, les Français se couchent par terre, tout en jetant un coup d’œil par la fenêtre pour voir ce qui se passe.
Bientôt, on n'entend plus que des rafales de mitraillettes qui se rapprochent. Ils font sortir les gens de leurs maisons et de leurs caves, pensent-ils. En effet, ils voient une quinzaine de soldats en jaune sale qui arrivent vers la gare, en venant du village. Avec leur teint jaune et leur bonnet fourré, ils ressemblent étrangement à des Mongols. Michel qui connaît son Jules Verne par cœur, pense à la capture des deux journalistes dans le bureau de poste, dans le livre si connu "Michel Strogoff". Il n'est pas journaliste mais il écrira néanmoins le détail des ces petits évènements, près de quarante ans après.
Les Mongols en question tirent à travers la baraque qui sert de gare. Un grand individu tout de noir habillé en sort rapidement. C'est le mécanicien de la locomotive du "tacot". Il est en vêtement de travail, avec sa casquette pleine de suie. Maintenant, ils se rapprochent. Sans attendre qu'ils tirent, les trois Français sortent de leur baraque, Breuilly le premier sorti. Sortis en catastrophe, ils laissent le sac, évidemment, et lévent les bras pour montrer leurs intentions pacifiques. Les soldats parlent avec volubilité, gesticulent avec leurs mitraillettes, et les fouillent. En un clin d’œil, les Français sont délestés de tout ce qu'ils ont : cigarettes, portefeuilles, briquets, couteaux de poche, montres surtout. Puis, ils les poussent vers le village en criant : "Davaï, davaï" ("vite, vite").
Le mécanicien semble apprécier d'être avec les Français, au moins lui n'était pas avec la "Volk Sturm" qui a tiré contre les Russes et peut-être pourra-t-il sauver sa peau. Tous les habitants sont rassemblés sur la place du village. Les femmes et les enfants devant le temple représentent au moins cinquante personnes; les hommes, une douzaine seulement, plus deux Français, Brunier et l'autre Français qui travaille chez le boulanger, à l'autre bout. Il y a aussi deux gros chars très modernes avec les tankistes perchés dessus en train de casser la croûte avec du pain blanc, plus une trentaine de soldats avec leurs mitraillettes et un lieutenant qui commande le tout.
Personne ne pille, ils n'ont pas le temps; ils font la guerre et vont probablement continuer tout de suite vers Pollnow. Tout le monde est silencieux. Le lieutenant paraît calme. Il se dirige vers le groupe des hommes. Michel se dit que c'est le moment de lui expliquer qu'ils sont des prisonniers de guerre Français, ce qui, à cause des uniformes qui n'en sont plus, n'est pas évident. Il dit à ses quatre camarades de se séparer des Allemands, et en les désignant à l'officier, dit le seul mot Russe qu'il connaît : "Franzouski". Est-ce l'accent défectueux ou la peur nettement visible dans les yeux du Français, un sourire amusé détend la figure du lieutenant. Il ne dit rien, mais fait un signe à ses soldats. Ceux-ci ont l'air de savoir ce que cela signifie.
Quatre d'entre eux se détachent, entourent les Allemands et avec des vociférations leur font prendre un chemin qui mène vers les bois. Une sorte de grondement de révolte et des gémissements s'élèvent du groupe des femmes. Les soldats tirent quelques coups de mitraillette en l'air, le silence se rétablit.
Alors, le lieutenant Russe se tourne vers les cinq Français, leur indique d'un geste du bras de filer, et vite, par la grande route qui va vers le Sud, cette route par où cette armée dont il est l'avant garde fonce vers la Baltique pour encercler Dantzig. Les Français ne se le font pas dire deux fois.
Ils quittent ce lieutenant dont ils n'ont même pas entendu la voix mais dont l'autorité est incontestable. Impossible de repasser par la baraque prendre des vivres et des couvertures. Ils se servent donc dans les dernières maisons du village dont celle de Raguse, et en avant vers la liberté...
QUATRIÈME PARTIE - LIBÉRÉS... ENFIN...
1. PÉRÉGRINATIONS DANS LES ARRIÈRES D'UNE ARMÉE RUSSE
Ils sont libres, en effet. La route est déserte, il n'y a qu'à la suivre et rejoindre si possible les autres Français à Hammerstein. Ils n'ont pas de carte, mais ils savent que c'est à peu près la direction. Le monde dans lequel ils ont vécu pendant cinq ans vient de s'écrouler. Un autre les attend, un peu mystérieux et inquiétant. Le premier cadavre en uniforme allemand qu'ils voient est étendu au bord de la route, à deux cents mètres de Sydow à peu près, un cheval de trait à côté de lui. Si ce guetteur letton attendait vraiment les chars russes sur ce cheval blanc et armé seulement d'un fusil, il y a du panache là-dedans pense Michel. Ils verront pas mal de cadavres étendus dans la neige les jours suivants. Les Russes avancent trop vite, ils n'ont pas le temps de les ramasser. Par contre, ils ne verront aucun cadavre de l'Armée Rouge.
Après une heure de marche environ, la nuit tombe déjà. Une ferme se devine sur la droite. Comme elles sont assez espacées, il faut en profiter. Ils vont donc y passer leur première nuit d'hommes libres. Tout est calme. La ferme est déserte, intacte; les animaux comme les habitants ont disparu. Ils cherchent quelques victuailles; la récolte est maigre, mais c'est surtout de sommeil dont ils ont besoin. Ils savent que la journée suivante il faudra faire connaissance avec leurs libérateurs, et pensent que ce serait idiot de se faire descendre maintenant.
Ils entendent pendant la nuit le roulement des colonnes motorisées sur la route, à cent mètres de la ferme. Le jour venu, la route est de nouveau déserte. Le temps est gris, mais il ne neige pas. Il n'y a qu'à continuer vers le Sud et espérer qu'on se trouvera en face d'hommes à pied. En effet, ils savent que les blindés tirent par principe sur tout ce qu'ils voient en face d'eux. Ils craignent les "Panzerfaust" (arme individuelle anti-char). Pendant une heure, les Français continuent à marcher. Il y a quelques bois de temps en temps, mais heureusement la route est assez droite en général et permet de voir loin. Venant vers eux d'un chemin sur la droite, ils aperçoivent quatre silhouettes. Ce ne sont pas des Russes mais deux prisonniers français comme eux et deux jeunes slovaques S.T.O. (Service du Travail Obligatoire) dont une jeune fille blonde assez élégante vu les circonstances. Manifestement, elle a pris sa tenue la plus propre. Si elle avait su ce qui l'attendait, elle se serait déguisée en homme. Son compagnon est son fiancé; il parle un peu le français, est ingénieur de son métier. Enfin, ils voient facilement reconnaissables avec leur "chapka”, leur grand manteau et leur mitraillette, une troupe de soldats russes. Comme ils l'ont fait la veille à Sydow, mais de plus loin, les Français lèvent les bras en l'air et les laissent s'approcher. De plus, Brunier a la bonne idée de crier "hourra, hourra !". Les Russes ont compris. Ils se contentent de fouiller consciencieusement tout le monde et continuent leur route.
Peu après, deux prisonniers français comme eux, mais morts ceux-là, sont étendus le long de la route. Michel se penche vers eux pour prendre leurs papiers de manière à pouvoir prévenir leur famille en rentrant en France, mais ses camarades l'en empêchent en criant : "Attention, les voilà". C'est en effet le gros de l'infanterie de cette armée qui arrive, et pas seulement sur la route. Cette grande plaine blanche est devenue toute grise et a l'air de se déplacer lentement vers le Nord. Aussi loin que la vue peut porter, à droite et à gauche de la route et sur trois cents mètres de profondeur peut-être, on ne voit que ces milliers et ces milliers de soldats, avançant sans ordre apparent. Hier, les Français ont vu l'armée motorisée, avec chars et matériel moderne, d'ailleurs de construction américaine. Là, c'est la vieille armée venue des steppes qui ressemble à celle d'Attila ou de Gengis Khan. Leur travail est de ratisser le pays, forêts comprises, de manière à ne laisser derrière eux aucun "Volk Sturm" (Ouragan du peuple, sorte de milice) rescapé.
Ils n'ont pas de cuisines roulantes ni de camions de ravitaillement avec eux. Ils vont donc vivre sur le pays, piller et massacrer dans les fermes comme les Français s'en rendront compte par la suite. Pour l'instant, ils se rangent au bord de la route, pas très rassurés. La Slovaque au milieu d'eux passe inaperçue. Seul Brunier, très décontracté en apparence, pousse des "hourras" et fraternise avec les soldats russes. L'un d'eux pour s'amuser envoie une rafale de mitraillette sur une buse qui plane à soixante mètres, juste au-dessus d'eux. Le tireur est vraiment adroit car le grand oiseau tombe sous les applaudissements de l'assistance.
Une fois le gros de la horde passé, les Français continuent leur route et arrivent dans un gros village rempli de soldats très occupés à piller. Ils voudraient bien trouver, eux aussi, quelque chose à manger mais c'est très difficile, il y a trop de concurrence. Michel trouve quand même un œuf, il le gobe aussitôt. Il entre dans ce qui devait être la poste. Le sol est jonché de billets. Ses camarades en fourrent dans leurs poches. Mais à quoi cet argent peut-il servir maintenant ?
Dans la grande rue centrale, le spectacle est étonnant. Plusieurs soldats ont découvert des bicyclettes et essaient de rouler dessus. La plupart du temps ils tombent rapidement. L'un d'eux, furieux, arrose la bicyclette d'une rafale de mitraillette. On en voit qui sortent des maisons avec des volailles diverses. Un autre mange un pot de confiture, tout en marchant pour ne pas perdre de temps. Les Français, ils sont huit maintenant, plus les deux Slovaques, entrent dans une maison dans l'intention de se reposer un peu. Il y a une belle pièce parquetée qui donne directement sur la rue. Ils posent leurs sacs et s'étendent sur le plancher ou sur le grand lit qui est au milieu. Michel a trouvé une pièce minuscule attenante et s'étend sur le lit d'ailleurs un peu trop petit pour lui.
Soudain, il entend à côté des ordres criés en russe, un brouhaha. En risquant un œil par la porte entrebâillée légèrement, il voit un officier avec une casquette verte ordonner à ses camarades de vider les lieux. Ils doivent laisser là leurs affaires. La jeune femme veut sortir aussi, mais il l'arrête au passage, et ferme la porte qui donne sur la rue. Naturellement, il n'a pas vu Michel qui comprend maintenant, mais un peu trop tard, ce qui va se passer et referme discrètement la porte. L'officier sort cinq minutes après environ, une fois arrivé à ses fins. Michel reste toujours caché jusqu'à ce que ses camarades reviennent. Tout le monde a compris. Le Slovaque a l'air sombre. Il parle un peu avec sa fiancée qui sanglote doucement. Michel aurait pu lui certifier, pour le consoler, que sa fiancée avait opposé une résistance honorable.
Il est préférable, maintenant, de quitter ce village, surtout dans l'intérêt de la jeune femme. C'est ce qu'ils font. À la sortie, deux chasseurs allemands, qu'on n'avait pas vu arriver, prennent la grande rue en enfilade en mitraillant. On n'a que le temps de se mettre à l'abri, le long des murs et sous les porches des maisons. L'alerte passée, ils repartent. Le soir venu, ils repèrent une ferme isolée à cent mètres de la route. Ils entrent, tout est sens dessus-dessous, dans la cuisine. Brunier et Breuilly entrent dans la chambre à côté et ressortent aussitôt avec un drôle d'air. Ils disent : "Ne restons pas ici". Les autres vont voir et comprennent, il vaut mieux s'en aller en effet.
Ils continuent donc à marcher sur la grande route. Un petit chemin conduit à une autre ferme. Il faut bien se mettre à l'abri pour la nuit. La maison d'habitation est plus grande. Elle n'est pas trop en désordre et il n'y a pas de cadavres. La porte d'entrée donne sur un couloir. Il y a une chambre à gauche, une chambre à droite, chacune avec un grand lit et des couvertures. Tout le monde s'installe, les uns sur les lits, les autres sur le plancher et ils commencent à dormir. Mais bientôt, ils entendent un bruit dehors. On cogne violemment à la porte, fermée à clef de l'intérieur, en criant des ordres. Ce sont des Russes; le plus sage est d'ouvrir. Pourvu qu'ils ne tirent pas dans l'obscurité les prenant pour des Allemands. Brunier et Breuilly, les plus courageux, crient avant d'ouvrir : "Hourra Camarades".
Une dizaine de soldats entrent. Malgré leur apparence de guerriers Mongols, ils ont l'air pacifiques. Ils font comprendre qu'on leur laisse une des deux chambres. C'est normal, et on s'exécute rapidement. Ils s'installent à la lueur de deux ou trois bougies. Celui qui paraît être le chef, sort un violon caché dans son paquetage et se met à jouer, et d'une manière remarquable semble-t-il. Cela doit être son métier, et il a emporté son violon pour ne pas perdre la main. Ses camarades écoutent ces airs qui leur rappellent leur lointain pays. Les Français écoutent avec eux. Ils ne s'attendaient pas à un concert de cette qualité dans de telles circonstances et dans un tel décor.
Le lendemain, la fraternisation entre Français et Russes est complète. On se partage un excellent café américain d'une boîte que quelqu'un a sauvé des différentes fouilles. Puis, on repart, chacun de son côté, après de grandes démonstrations d'amitié.
Mercredi 28 février 1945
Sur la route, les détachements à pied qu'ils croisent deviennent rares. Ce sont plutôt des colonnes de camions ou des pièces d'artillerie. De loin en loin, un cadavre en uniforme "feldgrau" (couleur de l'uniforme allemand) étendu dans la neige rappelle qu'il y a eu par endroit un essai de résistance. Quelquefois, près des maisons la neige est teintée de rouge. Michel regarde à l'intérieur d'un char allemand incendié, on distingue à peine une forme humaine toute noire, haute de cinquante centimètres environ. Ils traversent des villages. Même quand les maisons sont intactes, les habitants ont disparu. Cela fait presque trois jours qu'ils marchent, ils n'ont pas vu un seul Allemand ou une seule Allemande en vie, tout au moins. L'explication, ils vont l'avoir.
À un passage à niveau, un train de marchandises passe lentement, allant vers l'Est. Ce sont des wagons découverts, et dans ces wagons, il y a des femmes et des enfants entassés. Staline exécutait le plan du partage de l'Europe de l'Est, arrêté entre les trois grands à Yalta : il fallait vider entièrement de leurs habitants ces régions de l'Est de l'Allemagne pour pouvoir y installer les Polonais, qui eux, viendraient de l'Est de la Pologne.
Le soir venant, il s'agit de trouver une ferme, un peu à l'écart de la route. A trois cents mètres environ, on devine un bâtiment caché dans quelques arbres. C'est une maison d'habitation assez aisée. Et chose curieuse, les propriétaires sont là, bien vivants, mais terrorisés à l'arrivée de cette petite troupe. Les Français font comprendre qu'ils ne demandent que le gîte et le couvert si possible, et ils se rassurent. Il y a là, trois femmes d'âge différent et un homme de cinquante ans environ. Tous s'empressent de les installer du mieux qu'ils peuvent, après leur avoir donné un peu à manger.
Jeudi 1er mars 1945
Le lendemain, ils peuvent, grâce à leurs hôtes, se raser, boire un café ersatz, puis ils partent. Ils rejoignent la grand route. Une dizaine de soldats russes sont là. Leur chef qui voit la direction d'où ils arrivent, désigne la maison d'un air interrogateur. Brunier répond en secouant la tête négativement de droite à gauche, lui faisant comprendre qu'il n'y a rien à piller là-bas. Il faut dire que dans ces circonstances, c'était souvent Brunier qui décidait ce qu'il y avait à faire. En tout cas là, il a sauvé, au moins provisoirement, la vie à une famille allemande, car les Russes s'en vont dans une autre direction.
Au bout d'une heure de marche environ, une agglomération recouverte de fumée apparaît. C'est Hammerstein. À l'entrée de la ville, il y a une sorte de poste de garde installé dans un immeuble en béton. Des soldats les entourent, les fouillent, puis les font descendre dans un sous—sol, où sont déjà une trentaine d'hommes. Les Slovaques sont emmenés ailleurs. Ils vont rester dans ce sous-sol au moins 24 heures pendant lesquelles ils se demanderont ce que leur réserve l'officier qui commande le poste. En tout cas le logement est froid et peu confortable, et on ne leur donne rien à manger. Sur leur trente compagnons, une dizaine sont des prisonniers russes, dont le moral est très bas. Ils font comprendre à leurs camarades français qu'ils seront probablement fusillés ou, tout au moins, envoyés en Sibérie.
Vendredi 2 mars 1945
Enfin, l'officier russe relâche les Français. Il faut traverser Hammerstein et prendre la direction de Bromberg et Thorn, qu'on appelle maintenant Torun. Hammerstein est traversé au pas de course, car les maisons brûlent. Quelques-unes sont écroulées et, dans les décombres, Michel trouve un blaireau et un rasoir mécanique dont il avait besoin. Ils marchent maintenant vers l'Est sous la neige qui tombe en abondance. Ils arrivent le soir à une sorte de grange où se trouvent déjà une vingtaine de Français et autant d'Italiens dans leurs uniformes gris-bleu. Ces anciens alliés de l'Allemagne avaient changé de camp en 1943, après le coup d'état de Badoglio contre Mussolini. Enfin, là, un service d'accueil est prévu; heureusement, il y a une roulante; on leur donne un morceau de pain très noir et un liquide chaud qui ressemble au thé.
Samedi 3 mars 1945
Le lendemain, ils prennent la route, mais sont bientôt arrêtés par un officier russe qui, avec ses hommes, est occupé à boucher des entonnoirs faits par des bombes d'avions. Il faut leur donner un coup de main. Presque toute la journée se passe à réparer la route. Le soir, l'officier les fait embarquer dans des camions qui les emmènent à la petite ville voisine : Zempelburg. À la gare, un train de munitions est garé et il faut commencer à décharger. Ce sont principalement des obus et des caisses de cartouches. Il n'est pas question de lambiner. "Davai, davai" disent les Russes. Le travail s'arrête à la nuit, et tout le monde est épuisé. On leur distribue une soupe chaude avec du riz et un morceau de pain. Pendant deux jours, ils vont travailler à transborder le contenu des wagons dans les camions qui monteront ravitailler les troupes vers Dantzig. Ils sont heureux de contribuer ainsi, même modestement, à la victoire contre les envahisseurs de leur pays. Michel se disait qu'une fois l'Allemagne vaincue, l'Europe sera déséquilibrée en faveur de la Russie.
Lundi 5 mars 1945
Tout le contenu du train est déchargé. L'officier russe leur dit que demain d'autres camions les emmèneront plus loin vers l'Est.
Mardi 6 mars 1945
En effet, quelques camions vides arrivent au petit jour. Ils embarquent. Ils vont rouler presque toute la journée. Ils traversent Bromberg sans s'arrêter. Le soir, vers seize heures, ils arrivent dans une grande ville, c'est Torun. Il y a un grand fleuve qui charrie des glaçons, c'est la Vistule. Le pont a été démoli en partie, mais une arche provisoire en bois permet de passer quand même. Les camions les déposent sur une place de la ville, puis repartent. Il neige abondamment. Tout le monde est gelé et affamé. La place est déserte, ils n'ont aucune instruction et se demandent où aller loger. Heureusement, deux ou trois jeunes filles de la Croix Rouge arrivent et conduisent les Français par groupes dans des immeubles voisins. Breuilly, Col et Michel sont logés dans un grenier où ils peuvent dormir après avoir avalé une boisson chaude.
Mercredi 7 mars 1945
Il ne neige plus. Michel descend dans la rue, histoire de se promener et peut-être d'aller à la poste demander si on peut écrire en France. Tout a l'air mort et désert. À la fin, il rencontre une passante assez âgée qui sait un peu le Français et qui lui dit que le courrier ne marche pas.
Les jeunes filles de la Croix Rouge leur donnent une boisson chaude, un peu de pain, et leur indiquent le chemin de la gare. Ils repassent la Vistule et arrivent à la gare. Vers 14 heures, ils embarquent dans un train de marchandises, roulent pendant trois ou quatre heures et arrivent à la nuit dans la gare d'une petite ville : "Alexandrovo". Là, ils sont encore accueillis par des jeunes filles de la Croix Rouge qui les entassent dans la salle d'attente et leur servent du café ersatz avec du pain. C'est d'autant plus méritoire de leur part que ces gens n'ont plus rien, ayant été pillés plusieurs fois déjà par les Allemands et par les Russes.
Jeudi 8 mars 1945
Il faut repartir, à pied cette fois. La neige est tombée en abondance les jours précédents, recouvrant la route et la campagne d'un manteau uniforme. Pour ne pas se perdre, il faut suivre les poteaux téléphoniques. Au bout de deux heures de marche environ, une petite ville apparaît. Comme ils l'apprendront bientôt, son nom est Ciechocinek; il y a une grande rue centrale bordée de beaux immeubles style 1900. Ces immeubles sont des hôtels et la ville est, ou plutôt était, une ville d'eau. C'est maintenant une sorte de cité sanitaire remplie de soldats russes blessés ou en convalescence. En effet, les soldats qu'ils rencontrent sont soit manchots, soit avec des béquilles, soit avec des pansements divers. Les nouveaux arrivants sont accueillis par leurs camarades dont certains sont déjà là depuis un mois. Un convoi est déjà parti pour la France, disent-ils, via Odessa.
Brunier, Breuilly, Col et Michel restent ensemble. Ils se logent dans une chambre qui fut peut-être luxueuse avant la guerre, mais qui, maintenant, vidée de son contenu, le plancher et les murs abîmés, offre tout de même des châlits superposés, toujours les mêmes où l'on peut s'étendre sur de vagues paillasses. À Ciechocinek, la vie est bien organisée. Il y a une soupe à onze heures et à dix-sept heures, que l'on va chercher à la roulante. Une sorte de thé et un morceau de pain le matin. C'est l'ordinaire des soldats russes. On les laisse absolument libres de se promener et ils ne sont tenus à aucun travail en dehors des corvées de nettoyage. Seul inconvénient, la liaison avec les Russes est assurée par une dizaine de Français en uniformes assez propres qui ont constitué une sorte de tribunal. Ils recherchent parmi leur camarades ceux qui ont collaboré avec les Allemands. Ces gens prennent des airs importants et tout le monde les évite et les craint. Ils sont installés dans la pièce voisine. Michel et ses camarades vont découvrir un monde qu'ils ne connaissaient pas jusque là. Celui de la délation et de la haine entre Français.
Dans le groupe qui vient d'arriver, il y a un jeune civil de dix-huit ans peut-être; pour quelles raisons ce tribunal s'arroge-t-il le droit de l'interroger, puis de le torturer pendant des jours ? Personne ne le sait. Quel crime a donc commis ce malheureux pour qu'on l'entende hurler de douleur à travers la cloison et supplier ces bourreaux ? Mystère complet. Au bout de deux jours, les plaintes s'arrêtent. On apprend qu'il est mort et enterré dans la cave de l'immeuble. Chose curieuse, cette "mafia" inquiétante et qui travaillait peut-être en liaison avec la police politique russe, disparaîtra quelques semaines après.
Dans la même pièce où loge Michel, il y a un jeune Alsacien, mobilisé de force dans l'armée allemande, dont il porte les bottes et la culotte. Plus tard, on les appellera les "malgré nous". Des milliers d'entre eux ont été tués sur le front russe, d'autres ont été faits prisonniers et ont passé le restant de leur vie perdus et oubliés sans pouvoir revenir. Ce "malgré nous", adopté et rassuré par l'équipe de Sydow, leur dit que ce sont des Français de la Division Charlemagne qui ont combattu dans la région d'Hammerstein. Michel pense que, parmi ces hommes qu'il a vus étendus dans la neige, en uniformes allemands, il y avait peut-être des Français comme eux, morts en croyant défendre une cause juste. Ils apprennent aussi par un camarade qui travaillait dans les environs de Pollnow, que le fossé antichar qu'ils ont vu construire par les jeunes réfugiées avait arrêté les chars russes pendant deux ou trois jours. Il y a eu une vraie bataille et Pollnow est détruit entièrement. Heureusement, la "mafia" arrête ses jugements sommaires. Les jours passent. La neige fond peu à peu. Quelqu'un dans la pièce a un vieux jeu de cartes. Michel apprend à jouer au bridge à Breuilly et à deux autres, et ce sont des parties interminables.
Vendredi 16 mars 1945
La neige est fondue. Il fait beau. L'équipe de Sydow et quelques autres sortent de la ville pour visiter le pays. Ils ne voient personne travailler dans les champs, et tout semble à l'abandon.
Samedi 17 mars 1945
Visite des établissements de bains et piscine, vides bien sûr. Ce qui est curieux, c'est un aqueduc haut de sept ou huit mètres, et long de plus d'un kilomètre entièrement construit en bois de pin. Les soldats russes convalescents se proménent eux aussi, mais ne cherchent pas à entrer en contact avec les Français. Peut-être ont-ils des ordres pour cela. Des demandes pressantes ont été faites pour que du courrier puisse être acheminé vers la France, jusque là sans résultat. Il n'y a aucun journal, aucun communiqué officiel. On sait seulement que les Polonais sont divisés entre résistants de droite, partisans du gouvernement en exil à Londres depuis 1939, et résistants de gauche soutenus par les Russes. Ce sont ces derniers, dont le siège est à Lublin, qui l'emporteront naturellement et qui imposeront, sans jamais faire d'élections libres, un régime communiste à la Pologne.
Samedi 24 mars 1945
C'est demain les Rameaux. Un aumônier militaire Français qui passe dans la chambre nous le rappelle. Il demande aussi des volontaires pour remettre à sa place la cloche de l'église de la ville. Cette cloche avait été descendue par les Allemands qui voulaient la faire fondre paraît-il. Les autorités sont d'accord pour qu'elle soit remise en place et que les offices religieux de Pâques aient lieu. Cette cloche est lourde, mais une vingtaine de Français tirent sur la corde qui, au moyen d'une poulie installée en haut, la hisse peu à peu jusqu'à sa place normale. Le lendemain, jour des Rameaux, Michel sert la messe de l'aumônier, non dans l'église car elle ne sera rendue au culte que le jour de Pâques, mais dans une pièce de l'immeuble où ils logent.
Dimanche 1er avril 1945
Messe solennelle à l'église de Ciechocinek. Celle-ci est archicomble. Ce sont surtout des femmes qui se mettent à genoux à même le sol, car il n'y a pas de chaises. Assez peu de Français y assistent.
Mercredi 4 avril 1945
Chacun a le droit d'écrire un mot très bref à sa famille, pour dire uniquement qu'il est vivant et en bonne santé.
Samedi 7 avril 1945
Les Russes embarquent les Français et les Italiens dans quelques wagons à bestiaux, mais le train ne démarre pas.
Dimanche 8 avril 1945
Le train démarre. Il va à Odessa paraît-il, via Varsovie. Il roule très lentement.
Lundi 9 avril 1945
Le train arrive dans une ville du nom de Kutno. Là, tout le monde descend. Un autre train arrive dans l'autre sens. La locomotive a une belle étoile dorée sur le poitrail et les Wagons sont deux fois plus grands que les wagons français ou allemands. Ils sont déjà remplis de civils. Ce sont des familles entières de paysans polonais. Les Français s'entassent comme ils peuvent et le train repart vers, l'Ouest cette fois. Ces familles viennent de régions proches de la frontière russe, bien à l'Est de Varsovie et vont être installées en Poméranie Orientale. Le soir, le train s'arrête dans une gare : Wresnia. Tous les Français doivent descendre. Ils traversent une petite ville et arrivent à une grille gardée par des fonctionnaires russes en armes. Il y a un grand bâtiment sur la gauche. C'est la salle des fêtes de la ville, et autour ce qui était le jardin public. On les fait entrer dans cette grande salle d'où les fauteuils ou les chaises ont été enlevés. Il faut se serrer pour avoir une place. Il n'y a pas de paille, et cela vaut peut-être mieux car en général, elle est pleine de poux. Ils couchent donc à même le plancher. Dans la bousculade, Brunier a disparu. Breuilly, Col et Michel sont toujours ensemble. Ils s'installent sur la scène et dominent ainsi la situation. Deux officiers français arrivent. Ils expliquent aux nouveaux arrivants que les Russes n'ont pas encore d'instructions pour le retour en France. La guerre n'est pas finie. La poche de Dantzig vient juste de tomber. Tous les prisonniers américains et beaucoup de Français ont été abattus par les Allemands juste avant la reddition. Des corvées en ville sont organisées tous les jours. Eviter les incidents avec les soldats russes et saluer leurs officiers.
Ces officiers Français font bonne impression. L'un d'eux sait le Russe, paraît-il, et c'est un colosse. Il s'appelle le lieutenant Vergès.
Mercredi 11 avril 1945
Le lieutenant Vergès annonce que les autorités russes ont décidé de faire assister les Français et les Italiens à une séance de cinéma. Il faudra traverser la ville en bon ordre, au si possible et en chantant. Le lieutenant Vergès ajoute : "Tâchez de faire honneur à l'armée française".
Hélas, le défilé en ville n'est pas brillant. Les premiers rangs, derrière les officiers, marchent à peu près au pas, mais ensuite, c'est la débandade. Pour le chant, ils essayent "la Madelon", mais sans beaucoup de succès. D'ailleurs, personne ne connaît les couplets. Il est vrai que, dans l'armée française, on n'avait pas l'habitude, avant la guerre, de chanter en groupe. Par contre, les Italiens, moins nombreux il est vrai, se sont bien débrouillés paraît-il. C'est un peu humiliant. Au cinéma, on verra deux films. Le premier, français, assez médiocre, se passe principalement dans des boîtes de nuit à Paris; l'autre, russe sous-titré en français est beaucoup plus élevé au point de vue moral.
Les jours suivants, Michel va en corvée en ville, un jour sur deux à peu près, soit à la gare, soit dans une minoterie. Le travail est assez dur, mais heureusement ils sont très nombreux pour le faire.
Mercredi 24 avril 1945
Un autre courrier part pour la France. Les jours de repos, Breuilly et Michel ne peuvent plus jouer au bridge car ils ont perdu leurs partenaires qui avaient le jeu de cartes. Par contre, ils ont fait la connaissance de leurs voisins, trois jeunes gens déportés du travail. Deux d'entre eux, sont frères et habitent Marseille, l'autre est Breton. Ils sont habillés de vieux vêtements civils plus ou moins en loques et les Russes ayant fait une distribution de manteaux, Michel se débrouille pour en avoir un. Il le garde pour lui et donne son manteau français à l'un des deux frères qui n'avait même pas de veste. Le soir à la veillée, il arrive souvent que des chanteurs amateurs se fassent applaudir. Ils montent sur la scène et chantent, quelquefois très bien, de vieilles chansons populaires comme "Je sais une église au fond d'un hameau - Le temps des cerises - La paloma - Le béret - Les montagnards sont là..." et bien d'autres. Le jeune Breton, voisin de l'équipe de Sydow, est spécialiste des chansons de Botrel. Il chante de tout son cœur "Les petits mouchoirs de Cholet" ou "La chanson des blés d'or".
Sur ces entrefaites, ils apprennent que deux jeunes Français, S.T.O. également, se sont fait blesser gravement en manipulant une grenade qu'ils avaient ramassée à l'extérieur du camp. Ils sont soignés à l'hôpital militaire russe de la garnison et meurent peu après.
Le lendemain, trois officiers russes et une vingtaine de soldats en armes arrivent dans le camp. Les deux officiers français sont avec eux. Tout le monde doit se ranger en ligne devant le bâtiment et torse nu. Un des officiers russes est médecin. Il passe devant chaque homme et lui fait lever le bras gauche à la verticale. Il regarde attentivement sous l'aisselle et fait sortir du rang un homme de temps en temps. Sur les mille Français à peu près, une douzaine sont ainsi mis à part et, parmi eux, les deux frères de Marseille et le Breton, amis de Breuilly et de Michel. Alors, le lieutenant Vergès explique : "Ces douze hommes ont fait partie de la Division Charlemagne et ont combattu, sous uniforme allemand, nos alliés les Russes". Encadrés par des soldats russes, les douze Français passent, raides et dignes, devant leurs camarades. Et comme quelques cris hostiles s'élèvent, Michel entend le jeune Breton répondre à haute voix : "Notre drapeau à nous est sans tâche". S'il voulait dire par là qu'ils avaient essayé de défendre un idéal élevé, Michel les connaissait assez pour savoir que c'était vrai. Les officiers français obtiendront des Russes qu'ils rendent ces douze hommes. Ils ne furent pas maltraités, mais astreints à des corvées à l'intérieur du camp, gardés par d'autres Français armés de fusils prêtés par les Russes.
Michel souhaitait qu'en rentrant en France, ils ne soient pas fusillés, mais qu'on leur donne la chance de servir leur pays qu'ils aimaient certainement. Ce qui mit la puce à l'oreille du commandement russe, c'était que les deux blessés français qu'ils avaient soignés étaient porteurs, sous l'aisselle, d'un tatouage indiquant le groupe sanguin. Et ce tatouage n'existe que dans l'armée allemande.
2. QUELQUES SEMAINES DE VACANCES - RETOUR EN FRANCE
Mardi 1er mai 1945
C'est la fête du travail et on ne travaille pas. Ils ne travailleront d'ailleurs plus maintenant. Deux cent cinquante hommes, dont Breuilly, Col et Michel, prennent la route avec leurs sacs, encadrés par quelques Russes. A dix kilomètres de Wresnia environ, ils arrivent dans un petit château de style Louis XV situé dans un parc. À l'extérieur du parc se trouvent une grande ferme et quelques maisons couvertes de chaume. Il y a aussi une petite église en bois très couleur locale. A côté de l'église, une reproduction de la grotte de Lourdes avec sa vierge bleue et blanche dans sa niche. Tout le monde s'entasse comme il peut dans les pièces du château dont il ne reste plus rien du mobilier et des tapisseries. Cette propriété s'appelle "Wolkowitz".
Pendant dix-sept jours, les deux cent cinquante Français vont vivre la vie de château avec la liberté absolue de se promener dans le parc dont les massifs et les arbres commencent à fleurir, et même dans la campagne environnante. Michel et ses camarades ne s'en privent pas, d'autant plus que le temps est magnifique. La ferme et les chaumières sont désertes. La campagne aux alentours, est complètement plate et sans arbres. Ils ne voient à l'horizon qu'un grand moulin à vent dont les ailes sont arrêtées. Un jour, ils décident de visiter ce moulin. Il faut marcher une bonne heure pour l'atteindre. Mais c'est un très beau moulin en bon état de marche comme ils peuvent le constater en visitant l'intérieur. Les engrenages du mécanisme sont en bois, et sur l'énorme meule de pierre, il y a gravé : "...é - Angers". En revenant, ils croisent trois hommes avec des piquets et des chaînes d'arpenteur. S'agit-il d'un nouveau découpage des terres ?
Vers le 15 mai après-midi arrivent sur la pelouse devant le château une dizaine de Polonais et Polonaises en costumes de ville, cravate pour les hommes, robe un peu folklorique pour les femmes. L'un d'eux a un accordéon. Pendant une heure, ils vont danser sur la pelouse des danses et des rondes, quelque-fois acrobatiques. Michel se dit que le retour en France est pour bientôt; les Russes se mettent en frais pour que l'on garde un bon souvenir du "paradis soviétique".
17 mai 1945
Retour à Wresnia. Il fait très chaud. Michel a les pieds blessés par ses chaussures très dures qui n'ont pas été graissées depuis longtemps. Il est obligé de marcher pieds nus. Le soir, en rentrant au camp, les camarades disent que la guerre est finie depuis neuf jours. Les Russes ne l'ont pas dit encore officiellement, mais ils ne disent jamais rien, ou avec beaucoup de retard. De fait, la nouvelle va être confirmée par le lieutenant Vergès et son camarade le lieutenant X. En effet, ils ont été invités à participer à un banquet monstre organisé par les officiers russes de la garnison de Wresnia, pour fêter la victoire sur l'Allemagne. Le lieutenant X dira le lendemain à un petit groupe de Français, dont Breuilly et Michel, que ce banquet était remarquable, surtout par l'alcool qu'il fallait ingurgiter et le nombre de verres cassés. Il ajoutera cette boutade : "Ils ne commencent à savoir se servir d'une fourchette qu'à partir du grade de Commandant". En tout cas, le lieutenant Vergés a, paraît-il, bien défendu l'honneur de la France : il est resté le dernier debout, tous les autres étant par terre, ivres-morts.
Fin mai, début juin 1945
Il fait très chaud. Les Russes ont abandonné depuis plus d‘un mois la chapka et le manteau pour le calot et le blouson en toile qui s'enfile par la tête. Les Français prennent des bains de soleil et vont à la piscine de Wresnia. Cette piscine a beaucoup d'amateurs, surtout des soldats russes qui se baignent sans caleçon de bain, mais avec leur chemise. On parle toujours de retour en France, soit par Odessa, soit par Berlin, mais rien n'arrive.
11 juin 1945 au matin
Le régime alimentaire est de plus en plus maigre. Il paraît qu'un fermier des environs troque du beurre contre des lainages. Michel se fait indiquer la direction et trouve la ferme à cinq kilomètres environ. Il donne un bon chandail tricoté à la main que sa famille lui a envoyé il y a un an ou deux contre une livre de beurre, et revient sans se presser, pour constater que tout le camp déménage vers la gare de Wresnia. C'est l'embarquement, le vrai cette fois. Il retrouve Breuilly et Col qui l'attendaient un peu inquiets et qui le blaguent en lui disant qu'ils pensaient qu'il avait trouvé une Polonaise, ce qui est réellement arrivé d'ailleurs à un ou deux de leurs camarades. Mais eux trois n'ont pas du tout l'intention de rester à Wresnia. Ils se dépêchent de monter dans un wagon. Le train reste encore plusieurs heures en gare. Il s'ébranle enfin, vers l'Ouest, à 21 h 15.
12 juin 1945, 6 h 30
Posnan.
13 juin 1945, 2 h 30
Lissa.
14 juin 1945
Schwieburg. Reppen.
Le train roule très lentement, s'arrête souvent pendant des heures. On fait à peu près deux cents kilomètres par jour. Comme il fait très beau temps, beaucoup s'installent sur le toit des wagons pour dégager l'intérieur et mieux voir le paysage.
15 juin 1945
Francfort-sur-l'Oder.
Le passage de l'Oder se fait à l'allure d'un homme au pas sur un pont de fortune. On a l'impression que ce pont ne va pas tenir le coup tellement il est léger. Mais il tient bon, heureusement. Par contre, la ville de Francfort est entièrement détruite.
16 juin 1945
Berlin.
Ils mettront presque une journée pour traverser Berlin qui est une ville très étendue. Mais ce n'est qu'un immense champ de ruines. Du centre, il ne reste rien que des murs noircis, déchiquetés, aux fenêtres béantes. Des monceaux de gravats dans les rues presque désertes. Le train s'arrête plusieurs heures dans un faubourg sud de la ville. C'est un quartier résidentiel assez aisé. Les maisons sont propres, avec des petits jardins et des fleurs autour. Pas de traces de pillage. Tout est intact. Comme une nuée de sauterelles, les mille voyageurs se précipitent dans les maisons en laissant quelques guetteurs pour les avertir du départ éventuel du train. Michel se joint à eux par curiosité. Il entre dans une assez belle villa qui doit appartenir à un officier car il y a dans le salon, suspendu au mur, un beau sabre-poignard moderne avec sa dragonne argentée. Il a envie de le décrocher et de le ramener comme trophée dans son pays. Mais il y renonce en se disant : "Si c'était sur un champ de bataille, après un combat, d'accord ; mais là, c'est du vol". Il a d'ailleurs le temps, avant de quitter la pièce, de voir un de ses camarades décrocher et embarquer la pièce en question. Bientôt, le train siffle et tout le monde rejoint son wagon en courant avec son petit butin.
17 juin 1945
Brandebourg, puis Magdebourg.
Là, tout le monde descend. C'est la fin du secteur soviétique. Le train s'est arrété sur la rive droite de l'Elbe. La rive gauche est en secteur britannique. Sur le pont, un écriteau : "Friendship Bridge" (le pont de l'amitié). Une colonne de camions attend. Des soldats en uniforme kaki, tenant à la main un instrument bizarre, sont à côté. En s'approchant, ils voient que ces instruments sont de gros fly-tox. Avant de monter dans les camions, tout le monde est copieusement fly-toxé à l'extérieur et à l'intérieur de ses vêtements.
18 juin 1945
Les camions anglais leur font traverser l'Elbe. Ils descendent non loin de la gare, mais ils ne partiront que demain. Un officier français des forces françaises libres leur fait une assez longue allocution. En fait, c'est un discours politique qui se résume à ceci : "Le Maréchal Pétain et le gouvernement de Vichy sont des traîtres qui ont collaboré avec les Allemands et qui vont être châtiés. La France a été sauvée par le Général de Gaulle, la Résistance intérieure et l'aide de ses alliés". Michel est un peu attristé par ce sectarisme un peu mesquin. Et il n'est pas le seul. Mais personne ne dit mot et personne n'applaudit.
19 juin 1945
Départ de Magdebourg à 18 h dans des wagons de voyageurs.
20 juin 1945
Ils roulent toujours en Allemagne et toujours très lentement. Ils traversent Hanovre, Krefeld, Wiersen.
21 juin 1945 à 21 h 15
C'est la frontière de Hollande. Le dernier village allemand s'appelle Herzogenrath.
22 juin 1945 à 3 h 45
Maestrich.
A 4 h 30, passage de la frontière hollando-belge. Le train va un peu plus vite.
A 11 h, Liège.
A 14 h, Namur.
A 18 h 15, Charleroi.
A 20 h, Jeumont, première gare française.
A 23 h, Valenciennes. Ils dorment dans un centre d'accueil et on leur donne leur premier verre de vin depuis cinq ans. Breuilly est dirigé vers Cherbourg.
23 juin 1945 à 10 h
Départ pour Paris. Arrivée gare du Nord le soir. Ils sont installés dans un centre d'accueil. Ils y resteront trente-six heures. Triages, formalités administratives.
25 juin 1945
Col part avec un groupe vers la gare de Lyon; Michel vers la gare d'Austerlitz. Voyage de nuit. Changement à Limoges. Arrivée à Périgueux le 26 juin vers huit heures. Michel est le seul rapatrié qui descend sur le quai de la gare. Il s'assoit sous une tente installée à l'extérieur de la gare et où on lui sert une boisson chaude. Au bout d'une demi-heure, une jeune fille entre, ayant l'air de chercher quelqu'un. Michel la regarde de loin, pense que c'est peut-être Boustic mais n'en est pas sûr. Aurait-elle tellement changé ? La jeune fille s'approche et le regarde sans rien dire. Michel se lève et lui dit : "Tu es Boustic ?" (Boustic était le surnom que l'on donnait à la sœur de Michel quand elle était enfant).
CONCLUSION
Marie-Gabrielle, car c'est bien elle, me rassure d'abord sur l'état de toute la famille, puis m'entraîne vers un taxi dont la mission est de ramener chez eux les rapatriés. Je n'avais plus de nouvelles depuis plus de dix mois, aussi avait-elle beaucoup de choses à m'apprendre. Le taxi nous a déposés à la grille du Nord de la Closerie, et nous sommes entrés dans le parc. Un peu après le tennis, et en voyant la maison, j'ai eu envie de m'arrêter et de pleurer, mais j'ai eu honte de ma faiblesse; j'ai fait semblant de prendre un air dégagé et suis allé embrasser papa et maman qui étaient sortis devant la cuisine.
Les jours suivants, j'apprendrai peu à peu que même en Périgord la vie n'a pas été toujours facile; que le 6 juin 1944, Antonne a failli être incendié et les habitants fusillés par les troupes allemandes qui remontaient vers la Normandie, et que cela a été évité grâce à papa qui était maire de la commune à ce moment-là.
Deux jours après, je reverrai Rolande. Elle est venue en taxi de l'Escauderie avec René son mari. Leur bonheur à tous les deux fait plaisir à voir. Ils ont déjà trois garçons : François, Michel et Gabriel (1 mois et 1 jour). Le quatrième, Alain, arrivera un peu plus tard.
Quelques jours après, j'irai avec Marie-Gabrielle aux Sables d'Olonne où se trouvent Raymond, Marguerite et leurs trois enfants : Roselyne, Jean-Philippe et Bertrand. Raymond avait pris le maquis peu après le débarquement en Normandie. Il est maintenant instructeur de jeunes futurs officiers. Il partira bientôt en occupation en Allemagne.
Enfin, quinze jours après, Marie-Gabrielle me fera faire la connaissance de Gabrielle de Reviers, réfugiée avec son frère Alain sur une petite ferme à Sarlac-sur-l'Isle. J'aurai l'occasion de les revoir plus tard, mais cela est une autre histoire...
Les Charmettes, avril 1985.
Michel Storelli, 1918 – 1998